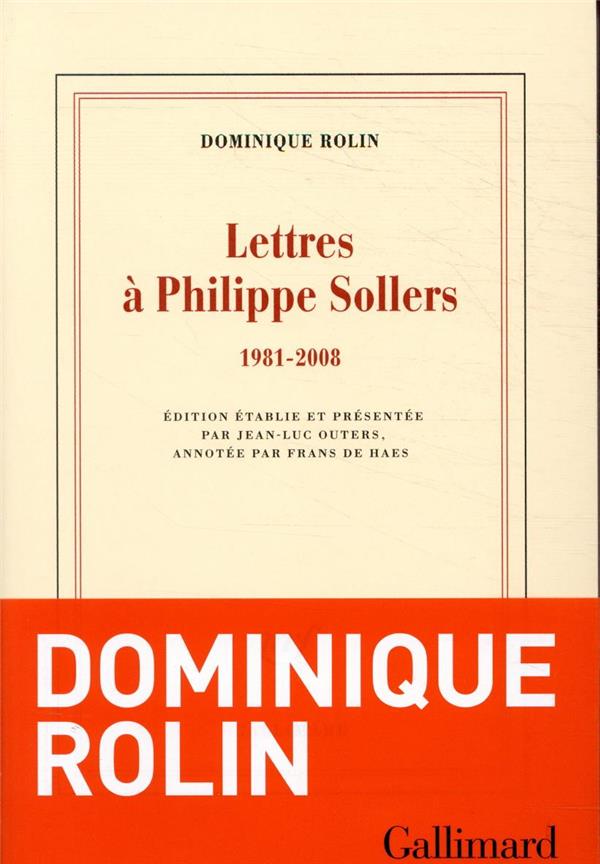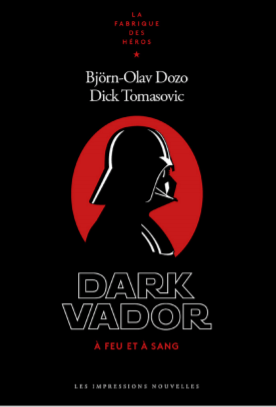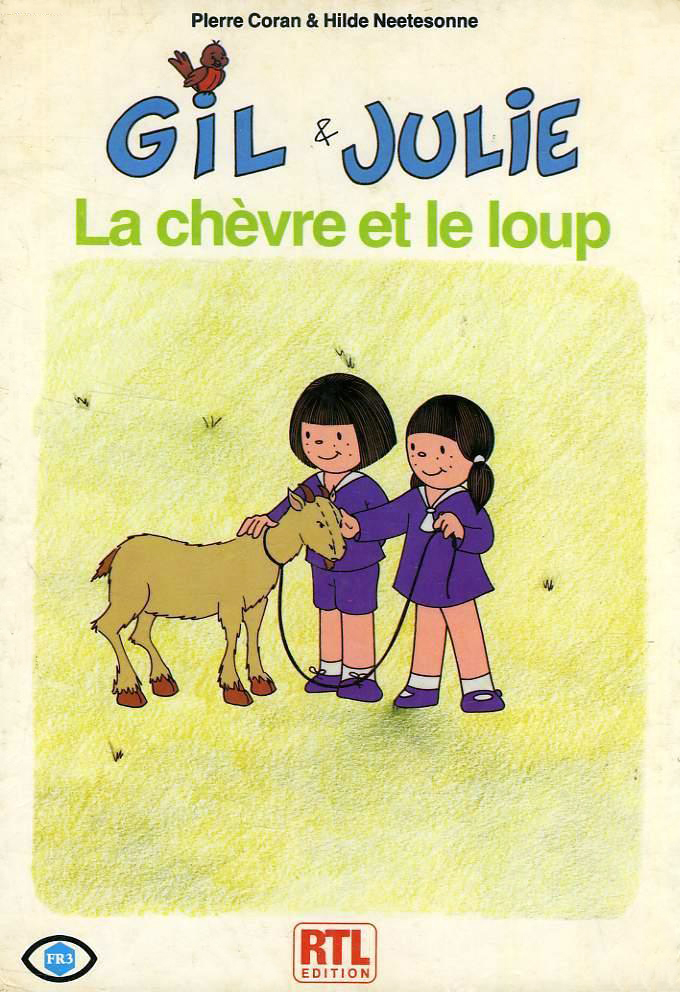111 films. Chroniques de cinéma (1970-1983)
RÉSUMÉ
Chroniques de l’hebdomadaire bruxellois Spécial, rassemblées, éditées et préfacées par André SempouxÀ propos du livre
Quand un grand écrivain assiste, pour des raisons journalistiques, à l’effervescence d’une des époques les plus excitantes de l’histoire du cinéma, il n’en reste pas moins un grand écrivain, même dans la pénombre d’une salle…
DOCUMENT(S) ASSOCIÉ(S)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Guy Vaes
Auteur de 111 films. Chroniques de cinéma (1970-1983)
Guy Vaes fut longtemps l'auteur d'un livre, qui se nimba bientôt d'une aura mythique : Octobre, long dimanche. Il parut en 1956, l'auteur avait trente ans. Il y avait été préparé par une enfance et une jeunesse dans le milieu des intellectuels francophones d'Anvers, en avait écrit les premières pages au lendemain de la deuxième guerre. D'emblée, Vaes avait compris que l'écriture demande une longue maturation.
Né le 27 janvier 1927, Vaes est le fils d'un fonctionnaire de la commission d'assistance publique de la cité scaldéenne. Très lettré, il était collaborateur de la revue Lumière dirigée par son beau-frère Roger Avermaete. Le fils de ce dernier, devenu sous le nom d'Alain Germoz homme de lettres et journaliste, deviendra l'ami et complice de toujours de son cousin. Les livres abondent dans la maison familiale : Jules Verne et Stevenson s'imposent comme auteurs de prédilection, et le resteront. Plus tard, Vaes s'en expliquera : «Pour éliminer la psychologie et aborder la métaphysique, on peut être amené à utiliser la couverture d'un genre traditionnel : l'allégorie, le policier ou le fantastique.»
L'exode, puis l'occupation, sont une nouvelle occasion de se gaver de lectures : Kafka, Woolf, Melville, Faulkner, qui fourniront plus tard la matière d'analyse d'un superbe essai sur le temps, La flèche de Zénon. Une certaine conception d'un présent absolu s'y précise, que l'on suit comme un fil d'Ariane dans les romans.
Un service militaire pas trop absorbant dans l'immédiat après-guerre, puis un long congé de maladie, quelques autres périodes de disponibilité réparties sur une dizaine d'années favorisent l' écriture d'Octobre long dimanche qui, dès sa parution chez Plon, suscite des commentaires très élogieux, de Pascal Pia à Julio Cortazar, et devient, au fil des années, une livre-culte.
D'autant que le roman suivant va se faire attendre longtemps. Les besognes alimentaires, en l'occurrence journalistiques, empêchant de se consacrer en suffisance à l'écriture, la photographie va, durant plus de vingt ans, compenser le manque. Londres en est le point focal : un livre de méditation urbaine, Londres ou le labyrinthe brisé va être complété par un album où textes et clichés alternent, Les cimetières de Londres.
En 1983 paraît enfin le deuxième roman, L'Envers, et le flux fictionnel repart pour de bon avec ce livre qui sera couronné la même année par le prix Rossel. Bruno s'y refuse à revoir son ami Broderick, dont il lui est dit qu'il aurait survécu à la chute fatale qu'il a faite au pied d'une falaise de Skye. Il capte pourtant son message, celui de l'inexistence du temps, qui ne serait qu'une perception de la conscience.
Le tempo de parution des romans, dès lors, s'accélère relativement. L'Usurpateur paraît en 1993 avec une préface de l'auteur flamand Hubert Lampo, qui suggère de qualifier le réalisme pratiqué par Vaes non pas de magique, comme on le fait d' ordinaire, mais plutôt de mythique : le roman de s'inspire-t-il pas du labyrinthe et de son Minotaure?
Guy Vaes s'est éteint le 26 février 2012.