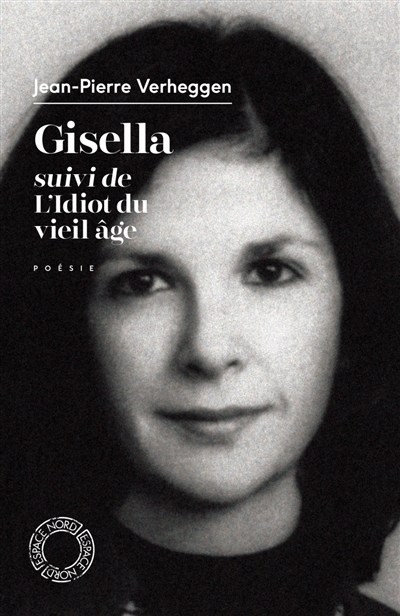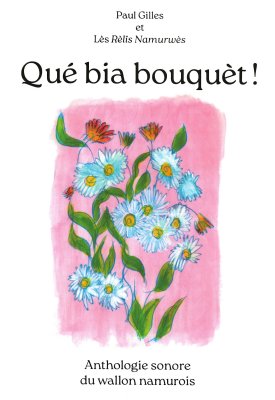
Qué bia bouquèt ! Anthologie sonore du wallon namurois
Il est tentant de recourir à la métaphore martiale après avoir parcouru les notices biographiques qui clôturent cette épaisse anthologie de la littérature en wallon namurois. On y trouve en effet une proportion inhabituelle de militaires de carrière ou de gendarmes : 9 sur les 64 auteurs et autrices réunis dans l’ouvrage. Le fait, qui s’explique en partie par la personnalité de Lucien Léonard, président des Rèlîs Namurwès de 1968 à 1989, ne se marque pas tellement dans le contenu de l’anthologie : il s’avère que les écrivains en uniforme ne sont pas les derniers à signer des poèmes bucoliques. Mais qui sont-ils, au fond, ces Rèlîs ? Le verbe rèlîre signifie « trier », « sélectionner », mais rèlî peut aussi vouloir dire « type à part », voire « simplet ». À la fondation de cette société littéraire, en 1909, le nom fut adopté, parait-il, en réaction à une remarque du professeur de néerlandais, qui répondit, lorsqu’on lui demanda pourquoi l’on n’apprenait pas le wallon à l’école : « Vos ’nn’ èstoz, dès rèlîs, vos-ôtes ! » [ « Vous en êtes, des originaux, vous autres ! » ] Les premiers Rèlîs n’avaient pas vingt ans ; ils fréquentaient l’Athénée royal, et — que l’on souhaite voir en eux des élus ou des barjots – leur projet allait faire florès.115 ans plus tard, la diversité des talents qui se sont succédé dans le groupe est manifeste. Si l’on repère rapidement certaines tendances — la poésie sentimentale, l’inspiration chrétienne, les souvenirs de guerre —, le présent bouquet a aussi ses fleurs exotiques ou extravagantes, comme un récit de combat naval (une tentative peut-être unique en littérature wallonne, signée Roger Prigneaux) ou une réinterprétation drolatique de la guerre des Gaules (un extrait de Li Bataye dès Nèrvyins de Joseph Pirson).Faut-il déduire, face à cette dispersion, que les Rèlîs ne forment pas une véritable école littéraire ? Ce serait aller vite en besogne car, s’il est vrai que, hormis la langue, il n’existe pas de commun dénominateur entre les autrices et auteurs de l’anthologie, on perçoit aisément des rapports d’influence. Et ce, particulièrement parmi les poètes les plus exigeants : Jean Guillaume, Émile Gilliard, Victor George, Joseph Dewez, Laurent Hendschel…Si le sommaire réunit nombre de noms bien connus, il faut saluer les efforts entrepris pour rendre cette littérature accessible au plus grand nombre : chacune des 94 œuvres est traduite en français et les enregistrements fournis sont une aide précieuse pour celles et ceux qui seraient peu familiers des usages de transcription de la langue wallonne. Au reste, ces lectures permettent un bon aperçu de la variation phonologique rencontrée même dans l’aire restreinte du wallon central — d’aucuns s’étonneront peut-être de rencontrer, par exemple, le én (é fermé nasalisé) moustiérois ou liernusien, un son inexistant en français.Les premiers enregistrements ayant été réalisés dès 2002, on est aussi émus de découvrir ou de réentendre la voix de certaines personnalités aujourd’hui disparues. Nous songeons à la cadence majestueuse du père Guillaume lorsqu’au milieu de vers libres, il introduit soudain un parfait alexandrin ( « Apwârtez-m’ dès-èfants èt dès frûts à brèssîyes » [ « Qu’on m’apporte des enfants et des fruits par brassées » ]) ; à la facilité avec laquelle Lucien Somme négocie un vers plein d’allitérations ( « Quand on vaurin vos l’ vint rauyi » [ « Quand un vaurien vient l’arracher » ])…C’est donc un vrai défilé qu’offre Qué bia bouquèt ! au long des accents et des inspirations. Dans cette abondance, les pièces les plus intéressantes (c’est chose courante en wallon) sont peut-être celles qui revêtent le mieux les atours de la langue parlée et du style direct. Il en va ainsi de ce poème méconnu d’Alexandre Bodart, merveille de concision et de sous-entendu : C’èst vêci, tin, qu’il a moru,Li grand Polite qu’aveûve misére,Ou avièr-ci, dji n’ sé d’dja pus.Portant, c’èst mi què l’a v’nu r’qwêre. Qui ça passe rade lès-ans, lès djoûs !On n’a qu’ saquants quârts d’eûre po braîre.Mèlîye sèreûve dèdja dju d’doû ?Combin gn-a-t-i qu’il è-st-è têre ? [C’est ici, tiens, qu’il est mort, / Le grand Hippolyte, le miséreux, / Ou par ici, je ne sais plus. / Pourtant c’est moi qui suis venu le chercher. // Que ça passe vite, les ans, les jours ! / Si vite qu’on n’a pas le temps de pleurer. / Le deuil d’Amélie aurait-il pris fin ? / Quand l’a-t-on mis en terre ?] Dans la bataille pour la langue wallonne, les Rèlîs viennent d’aligner un beau canon ! Et d’autres pièces suivront, gageons-le.À la fin de sa préface, Jean Germain glisse qu’une Anthologie contemporaine en wallon namurois du 21e siècle mériterait aussi de voir le jour ; on abonde dans son sens, d’autant que certains derniers venus chez les Rèlîs Namurwès , tous écrivains talentueux, sont absents du présent livre : Jean Colot, Jean Hamblenne, Xavier Bernier, Françoise Evrard… Pour l’heure, on peut au moins les lire dans Les Cahiers wallons , le bimestriel des Rèlîs auquel — oserions-nous…
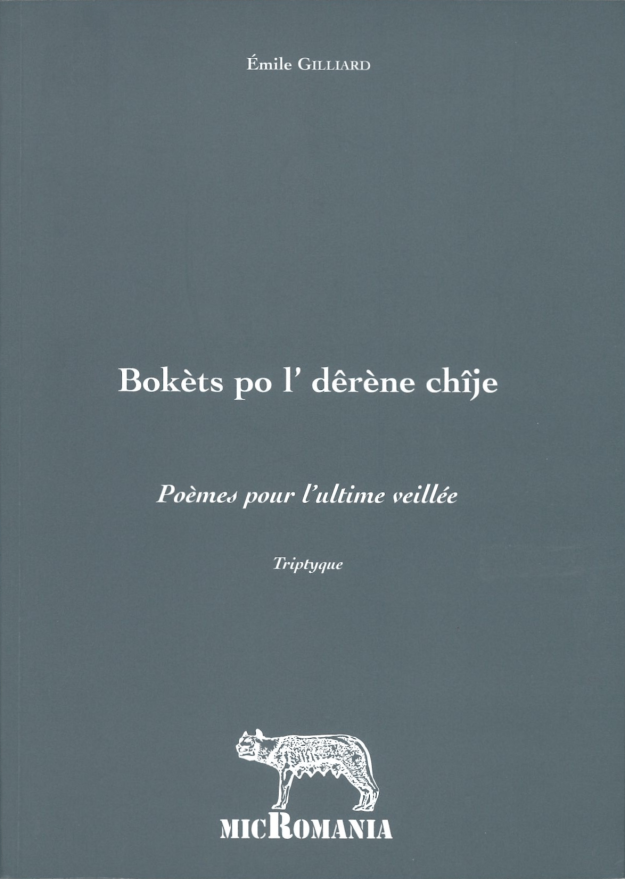
Bokèts po l’ dêrène chîje. Poèmes pour l’ultime veillée
Émile GILLIARD , Bokèts po l’ dêrène chîje. Poèmes pour l’ultime veillée , CROMBEL, coll. « micRomania », n° 39, 2023, 159 p., 16 €, ISBN : 978-2-931107-08-9Peu de temps avant son décès, le grand écrivain wallonophone Émile Gilliard avait transmis à son éditeur les épreuves corrigées de Bokèts po l’ dêrène chîje . La première édition de cette œuvre — une édition artisanale en 50 exemplaires, aujourd’hui introuvable — lui avait valu le prix triennal de Poésie en langue régionale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2005 et était vue comme un incontournable de sa bibliographie. Sa réédition dans une collection de plus large diffusion et avec des adaptations françaises est donc une initiative bienvenue. Si cette réédition fait œuvre de justice en permettant à la poésie d’Émile Gilliard d’atteindre des lecteurs qu’elle n’a jamais pu toucher auparavant, soulignons qu’elle fait aussi œuvre utile. En effet, elle fournit aux amateurs une réalisation exemplaire, témoin de la richesse du wallon sous la plume d’un auteur qui le possède pleinement, mais aussi des voies audacieuses empruntées par la poésie d’expression régionale depuis le milieu du 20e siècle.Émile Gilliard est en effet un héritier de la « génération 48 », qui a renouvelé cette poésie par la recherche de formes nouvelles et l’exploration de thèmes actuels. Ces jeunes poètes et leurs continuateurs visaient l’universalité, à travers des œuvres qui ne reniaient en rien leur attachement à leur région ni leurs origines souvent modestes.Dans Bokèts po l’ dêrène chîje , Émile Gilliard applique fidèlement ces principes, suivant une route d’abord tracée par Jean Guillaume, son maitre en poésie. Écrites dans les années qui ont suivi son départ à la retraite, les trois séries qui composent ce recueil explorent le regret lié au temps perdu, l’amertume d’avoir dû travailler pour d’autres, la fatigue physique et mentale… Au fil des poèmes, le lecteur découvre une langue particulièrement souple, riche d’adjectifs aptes à traduire, par exemple, les nuances de ce dernier sentiment : nauji [ « lassé » ], scrandi [ « fatigué » ], nanti [ « exténué » ], odé [ « lassé » ], skèté mwârt [ « éreinté » ]…Par endroits, le poète renoue avec la colère qui s’exprimait à plein dans certaines œuvres précédentes ( Vias d’mârs´ en 1961 , Come dès gayes su on baston en 1979) : ’L âront scroté nos tëresèt nos cinses èt nos bwès,à p’tits côps, à p’tits brûts,[…] come dès fougnantsk’on wèt todis trop taurdcand leû jèsse a stî fêteèt k’ tot-à-fêt a stî cauvelé. Dès-ans èt dès razansk’on a cauzu ovré d’zos mêsse,[…] dissus nos prôpès tëres. [Ils auront dérobé nos terres, / fermes et forêts, / peu à peu, sans fracas, / (…) comme des taupes / qu’on détecte toujours trop tard, / quand elles ont accompli leurs méfaits / et qu’elles ont tout creusé. // Une éternité / qu’on a quasi œuvré / sous tutelle, / (…) sur nos propres terres.] Ailleurs, il reprend les questionnements d’ordre métaphysique qui traversaient À ipe , cette autre œuvre importante, rééditée dans la collection micRomania en 2021. Èt si nosse bole âréve bukéconte one sitwale ? […] Èt nos-ôtes bèrôderèt r’nachî à non-syinceaprès l’ dêrène ruwale ? [Et si notre globe / avait cogné une étoile ? (…) // Nous aurions erré, / cherché inutilement / une ultime issue ?] Ces deux veines majeures de l’œuvre gilliardienne — le questionnement sur l’homme et son environnement, la défiance envers l’exploiteur, en communion avec tous les exploités — trouvent un point de rencontre dans les pages les plus fortes du recueil. C’est alors la métaphore de la maison qui exprime la détresse du « je » (non, du « dji » ) face aux communs massacrés au bénéfice de quelques-uns. ’L ont rauyî djustotes lès pîres dissotéyesèt lès tchèssî au lon,à gros moncias.Èt c’èst cauzucome s’il ârén´ ieû v’luchwarchî è vike,chwarchî è m’ pia.Come si l’ maujoneâréve ieû stîon niër, on burton d’ mès-oûchas. [Ils ont arraché / toutes les pierres descellées / et les entasser au loin, / et c’est quasi comme / s’ils avaient voulu / m’écorcher vif, / charcuter ma peau, / comme si la maison eût été un nerf, / un moignon de mes os.] De manière plus explicite, Émile Gilliard fait le lien avec le désastre écologique dans le poème d’épilogue, écrit spécialement en vue de cette deuxième édition. Vêrè ként’fîye on djoûki l’eûwe ni gotinerè pus wêre foû dès sourdants.On s’ capougnerè po sayî d’ ramouyî sès lèpes.Vêrè ki l’ têre toûnerè à trîs et tot flani,ki nos maujones si staureront su nos djoûs,èt nosse lingadje ni pus rén volu dîre. [Peut-être viendra-t-il un jour / où l’eau filtrera à peine de la source. / On s’empoignera pour se rafraîchir les lèvres. / Une terre stérile fera flétrir les plantes. / Notre maison s’écrasera sur nos jours, / et notre langue n’aura plus de sens.] Au possible effondrement des équilibres naturels fait écho ici celui d’une langue. Bokèts po l’ dêrène chîje est aussi traversé des préoccupations d’un homme qui a donné tous ses loisirs à la langue wallonne et laisse parfois libre cours à son pessimisme : « po ç’ k’il è d’meûre : / on batch di cindes èt dès spiyûres, / sacants scrabîyes / k’on îrè cheûre èt staurer sul pî-sinte » [ « pour ce qu’il en reste : / un bac de cendres, des déchets, / des escarbilles / à secouer et à répandre sur le sentier » ]Et c’est en cela que cette réédition prend une valeur supplémentaire : en redonnant à lire des poèmes qui ne taisent pas son sentiment de lassitude et d’isolement, elle nous rappelle que leur auteur a toujours su le dépasser. Émile Gilliard, en effet, n’a jamais cessé d’écrire dans sa langue première et a consacré ses dernières années à d’importants travaux philologiques. Ce livre prend donc, en creux, la valeur d’une ode à sa résilience et à son formidable engagement. Julien Noël Les traductions offertes ici sont les adaptations littéraires de l’auteur. Plus…