
Exploration du langage de la bande dessinée. Rencontre avec Thierry Van Hasselt
Thierry Van Hasselt est auteur de bande dessinée, plasticien, scénographe, installateur, graphiste et professeur à Saint-Luc. Il est aussi l’un des membres fondateurs du Frémok, plateforme d’édition indépendante bruxello-bordelaise menée par un collectif et issue de la rencontre d’artistes passionnés. Depuis vingt-cinq ans, les livres publiés par le Frémok proposent une bande dessinée qui sort du cadre, repousse sans cesse ses frontières avec l’art plastique et la narration littéraire. * Que ce soit au niveau du format de ses livres (parfois très petits ou très grands, épais ou minces), par les techniques plastiques utilisées pour les réaliser, les sujets traités, le Frémok n’est jamais là où on l’attend. Formé dans les années nonante par un groupe d’étudiants en art réunis par des aspirations et projets communs, le Frémok, qui s’appelle alors Frigo Production, puis le Fréon, a commencé en créant des ouvrages faits maison, à la photocopieuse, en sérigraphie ou en gravure. De la microédition artisanale à tout petit tirage. Dès cette période, la conscience des moyens de production et la volonté de dépasser une qualité standard constituent la pierre angulaire de leur travail. Ultra-exigeant sur la qualité d’impression, le collectif investigue en particulier ce champ technique. Thierry Van Hasselt, un des membres les plus actifs du Frémok, y publie une œuvre singulière, qui commence avec la parution de Gloria Lopez. Dans ses albums de bande dessinée, on entre en immersion dans l’image, dans une narration tout sauf classique, on perd ses repères pour mieux se laisser happer. Il a récemment reçu le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée pour son ouvrage Vivre à Frandisco, réalisé avec l’artiste Marcel Schmitz, créateur d’une ville imaginaire. Thierry Van Hasselt, comment a commencé votre parcours dans la bande dessinée? J’ai aimé la bande dessinée très jeune et j’ai voulu très tôt en faire mon métier. Après une scolarité un peu douloureuse, j’ai commencé la bande dessinée à Saint-Luc à Bruxelles. Cela a été une période de découverte, de liberté et d’ouverture vers des univers dont je ne soupçonnais pas l’existence. Alors qu’au départ je m’intéressais à de la bande dessinée plutôt classique, j’ai découvert le travail de Lorenzo Mattotti, qui a provoqué en moi un déclic : il était possible de connecter la peinture, la grande littérature et la bande dessinée. Mattotti a été le passeur qui m’a permis d’autres découvertes comme celles de la bande dessinée espagnole, de la revue d’Art Spiegelman Raw, du travail d’Alex Barbier, de José Muñoz… J’ai ensuite rencontré le groupe Moka, constitué par des étudiants de Saint-Luc un peu plus âgés que moi, parmi lesquels il y avait Éric Lambé ou Alain Corbel, et qui avait créé une revue. Nous nous sommes au départ clairement inscrit dans la prolongation de ce groupe qui n’a pas duré mais dont nous avons récupéré l’énergie. Nous avons repris le flambeau en créant d’abord le groupe Frigo Production puis, après une restructuration du groupe, les éditions Fréon. Plus tard, nous avons rencontré les gens d’Amok à Paris et avons décidé de travailler ensemble, ce qui a donné naissance au Frémok. Nous investissons beaucoup dans la production et la fabrication. C’est notre terrain d’expérimentation. Nous travaillons de près avec un photograveur qui lui-même collabore étroitement avec un imprimeur. Notre manière de travailler est hors norme, nous utilisons une technique d’impression tout à fait nouvelle. Aujourd’hui, ce sont souvent les auteurs qui scannent leurs propres illustrations. Or, ils ne sont pas formés pour le faire. L’évangile doré de Jésus Triste (réalisé avec La « S ») a été imprimé avec deux noirs pour obtenir une saturation d’encre proche de celle de la linogravure. Le Frémok travaille avec La « S » Grand Atelier qui propose des ateliers de création pour des artistes mentalement déficients. Qu’est-ce qui vous a mené à collaborer sur des projets collectifs puis sur Frandisco? C’est Anne-Françoise Rouche, directrice de La « S », qui est venue vers nous. Ils organisent des résidences d’artistes dans le cadre de leur projet de mixités entre artistes mentalement déficients et artistes contemporains. Ils souhaitaient travailler dans le domaine de la bande dessinée, et le côté expérimental du Frémok, ses libertés par rapport aux normes de la bande dessinée canonique, leur ont donné envie de venir nous chercher. Après une première réaction de perplexité, car on s’interrogeait sur ce vers quoi cette collaboration allait nous mener, nous avons accepté. Cela nous motive toujours d’aller vers l’inconnu et là où on ne nous attend pas. Très vite, ce travail de collaboration s’est révélé être transformateur pour nous. Cela a en fait bouleversé nos pratiques de la bande dessinée, puis donné lieu à la création d’une plateforme d’édition commune, Knock Outsider, dédiée à l’art brut contemporain et à la recherche autour de cet art. En quoi cela a-t-il bouleversé les artistes du Frémok? Nous sommes des artistes plutôt cérébraux, avec une conscience théorique. Nous avançons dans une autoréflexion constante de nos pratiques. Nous nous sommes soudain confrontés à des artistes qui n’étaient pas dans cette intellectualisation du travail, mais plutôt dans une grande liberté par rapport au médium. Ce télescopage-là a amené une sorte de choc esthétique, puis une autorisation de partir dans des directions dans lesquelles, encombrés par notre théorie ou notre culture, nous ne serions pas allés seuls. Je pense notamment au projet que j’ai réalisé avec Marcel Schmitz : quand je travaille seul, le ton est beaucoup plus grave, avec un rapport au monde présentant plus d’angoisse, de pesanteur. Avec Marcel, je suis parti dans une espèce de jubilation, de joie de vivre, des choses beaucoup plus élémentaires, aussi bien dans la façon d’aborder le dessin que dans le sujet, qui est la découverte d’un monde heureux, ludique, même si une certaine gravité est aussi présente. Nous sommes heureux de travailler ensemble et c’est aussi ça que je raconte. Jamais je n’aurais pensé faire un travail dans l’optimisme, l’humour et la légèreté tout en posant des questions fondamentales et profondes. Je n’en reviens toujours pas, à vrai dire, d’avoir fait une telle bande dessinée. Parallèlement, je continue à travailler seul et c’est alors un travail beaucoup plus sombre, écorché. Votre style graphique évolue sans cesse. De Gloria Lopez à Vivre à Frandisco, votre technique diffère. Comment expliquez-vous cela? Je n’ai pas une mais plusieurs techniques de prédilection. Je me pose d’abord la question du sujet : de quoi est-ce que je veux parler ? Qu’est-ce que je veux convoquer dans un récit ? La technique suit. Je vais trouver un outil qui me permettra, de la façon la plus adéquate, d’en parler. Pour Gloria Lopez, qui traite de perception mentale et de flou de conscience, j’ai utilisé la technique du monotype, où l’image n’est jamais fixée et semble toujours pouvoir se diluer. Pour traiter cette question d’apparition/disparition du sujet, c’était la plus appropriée. Pour un autre de mes projets, lié à la danse, avec la chorégraphe Karine Ponties, qui parle de ces mouvements mentaux, j’ai utilisé la même technique, en continuité avec Gloria Lopez. Pour Vivre à Frandisco, qui traite de la ville, j’avais envie d’utiliser un outil d’architecte et de revenir à quelque chose de très simple. Je n’avais jamais travaillé au trait. C’était pour moi un très grand déplacement graphique et esthétique, mais qui correspondait bien au déplacement du sujet. Je suis donc parti sur cet outil que je n’avais qu’à peine expérimenté…
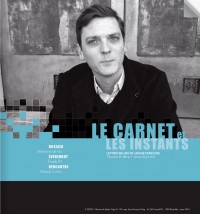
Le Pari (s) littéraire du Centre Wallonie-Bruxelles (in Vues d'ailleurs)
Au cœur de Paris, à deux pas de Beaubourg et du Marais, la culture belge de langue française a son îlot de visibilité, d’exposition, d’animation et de convivialité : le Centre et la Librairie Wallonie-Bruxelles. Ils offrent une vitrine exceptionnelle aux écrivains et aux éditeurs de notre pays. Une vitrine comme à Saint-Nicolas et à Noël, mais toute l’année. L’histoire commence en 1976, quand le Ministère de la culture acquiert un immeuble de mille mètres carrés pour y promouvoir l’art et la culture francophones de Belgique. Une belle intuition. Un geste heureux. Trois ans plus tard, le 26 septembre 1979, le Centre culturel de la Communauté française de Belgique, devenu par la suite le Centre Wallonie-Bruxelles, ouvre grand ses portes. Il y présentera les créateurs belges francophones de tous horizons et de toutes disciplines : danse, théâtre, chanson, jazz, cinéma, littérature, on en oublie sûrement. Y recevra le public venu les découvrir. Les applaudir. Et répandre la bonne nouvelle, à Paris et ailleurs : la culture belge francophone est vivante, bien vivante. Il faut compter avec elle. Comme toutes les institutions culturelles, le Centre a pris ses inclinations, ses couleurs, en fonction de ses directeurs et de ses directrices, de leur personnalité, de leur style. Il a évolué avec le monde institutionnel et politique, s’est transformé sous l’impulsion des artistes et des écrivains qu’il a accueillis. Aujourd’hui, il est un endroit incontournable pour la diffusion, la découverte et le rayonnement du patrimoine et de la création contemporaine de Wallonie-Bruxelles en France. Parmi les artistes qui s’y sont produits, ont vu leurs films projetés, leurs pièces jouées ou dansées, leurs livres lus et discutés, leurs œuvres exposées, citons, en toute subjectivité : Luc et Jean-Pierre Dardenne, Stéphane Lambert, Annie Cordy, Henry Bauchau, Steve Houben, Vera Feyder, Hergé, Dominique Rolin, Claudio Bernardo, William Cliff, Chantal Akerman, Jean-Marie Piemme, Pietro Pizzuti, Guy Goffette, Marion Hänsel, Patrick Roegiers, les Irréguliers du langage et les plus réguliers, les primés du prix Rossel et les recalés, les poètes oraux et ceux qui écrivent dans le silence... * Le Carnet et les Instants oblige, nous n’évoquerons que les activités littéraires du Centre et celles de la Librairie. Plus précisément : les activités organisées par la présente équipe. Nous avons rencontré Anne Lenoir et Pierre Vanderstappen , respectivement directrice et conseiller littéraire du Centre Wallonie-Bruxelles, et Muriel Collart , responsable de la Librairie. Ils nous ont expliqué les enjeux et les missions du Centre, de la Librairie. Ce qu’ils n’ont pas dit, et que l’on peut entendre dans leurs mots, c’est l’enthousiasme qu’ils mettent à préparer et proposer les rencontres avec les écrivains, à promouvoir et vendre leurs livres. À créer un climat de convivialité lors des brunchs ou des bistrots littéraires, des lectures spectacles ; d’un conseil à la librairie. Avec eux, la littérature, (devenue) art de la solitude, tant pour l’auteur que le lecteur, (re-)devient un moment de vivre ensemble, d’amitié et de partage. Une expérience commune. - Anne Lenoir, femme d’ouverture Directrice passionnée et chaleureuse, Anne Lenoir a presque toujours travaillé à diffuser la culture belge francophone, notamment à Wallonie-Bruxelles international. Présente à toutes les manifestations du Centre, elle dévore les livres de chaque écrivain invité. Elle aime tant lire qu’elle voudrait être interdite de Librairie Wallonie-Bruxelles, comme on est interdit de casino, parce qu’elle ne peut résister à la tentation... Qu’avez-vous fait avant de diriger le Centre Wallonie-Bruxelles ? Après mes études en philosophie à l’Université de Liège, amoureuse des philosophes présocratiques, je suis partie enseigner le français, le latin, la morale et la philosophie au Congo, le Zaïre à l’époque. J’ai dirigé ensuite le centre culturel de l’ambassade de Belgique. J’ai eu l’occasion d’y organiser des concerts et des expositions notamment de Mulongoy Pili Pili, un artiste de l’école de Lubumbashi, décédé maintenant. C’est là que m’est venue la passion de la culture. J’ai ensuite travaillé au Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Quand je suis rentrée dix ans plus tard, Roger Dehaybe m’a demandé de m’occuper de la partie audiovisuelle du service culturel de Wallonie-Bruxelles international. Puis s’est ajoutée la Foire du livre, enfin la direction du service culturel. Vous n’êtes pas la seule à avoir fait vos études à Liège, Pierre Vanderstappen et Muriel Collart aussi. Est-ce que cela s’explique ? C’est un hasard de circonstance. En même temps, on peut remarquer que dans la programmation figurent aussi beaucoup de Liégeois. Je pense qu’il y a un vrai dynamisme culturel dans cette ville. La programmation le reflète, à juste titre. Je ne connaissais pas bien Pierre en prenant mes fonctions, Muriel pas du tout. Je ne dirai jamais assez le bonheur que j’ai de travailler avec eux. D’avoir cette empathie. Pour eux comme pour moi, travailler c’est rechercher, se dire que rien n’est jamais acquis, essayer d’aller plus loin, ailleurs. Je vois maintenant comment, pour nos événements littéraires, la fréquentation du public a augmenté. Pour le bistrot littéraire, il y a jusqu’à septante personnes. D’ailleurs on ne sait plus comment faire, ou mettre le public... D’où vient ce succès ? Le bouche à oreille fonctionne bien. Il y a, évidemment, la qualité intellectuelle de Pierre, de ses échanges, il est particulièrement doué. Il travaille énormément. Combien d’heures de lecture, de préparation pour présenter le Dictionnaire amoureux de la Belgique de Jean-Baptiste Baronian, pour arriver à cette qualité d’entretien ? Pierre valorise les écrivains que nous recevons et cela mérite de l’audience. Nous travaillons à trouver le public. À chaque fois, nous nous demandons quel doit être l’angle d’attaque pour promouvoir tel écrivain, où dénicher un public qui n’est pas encore familier du Centre. Après avoir travaillé à l’international, ne travailler qu’à Paris, n’est-ce pas un rétrécissement de votre champ d’action ? Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas nomade. Je vis dans la ville, travaille dans un petit îlot dans la ville, mais grâce au réseau mis en place, cet îlot est un lieu d’ouverture. Mon pari est le partenariat et la collaboration avec les opérateurs français. Créer un réseau est important pour la mise en vente, la diffusion des créateurs. Quel pari formidable ! Quel est le public du Centre ? Il est majoritairement français. Nous ne nous regardons pas le nombril entre Belges, même s’il est important d’avoir, à certaines occasions, la présence de nos autorités. Quelle est votre touche personnelle dans l’organisation du Centre ? Avant tout, la notion d’ouverture vers les partenaires français. Lorsque je suis arrivée, on ne parlait pas de partenariat, de collaboration. Monter des projets avec d’autres institutions, d’autres maisons, rend plus fort, plus visible. Mobiliser l’attention de professionnels français plus performant. J’ai cette envie d’ouvrir les portes, de respirer, d’aller voir ailleurs. Mais aussi d’accueillir le public. Communiquer, parler, échanger avec lui est important. J’aime la chaleur et la convivialité, ce qui est très liégeois. J’aime cultiver cela dans mes rapports. D’ailleurs les Français apprécient beaucoup. - Pierre Vanderstappen, le goût du partage Que ce soit sur la scène du théâtre ou l’espace de son bureau, Pierre Vanderstappen, conseiller littéraire du Centre, ne semble avoir qu’une ambition : mettre en lumière les œuvres littéraires belges, ainsi que leurs auteurs. En partager…
