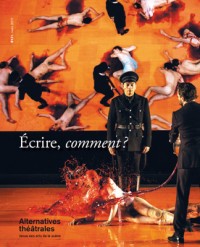
Derniers figurants d’une ville fantôme À propos de Zvizdal
(Tchernobyl – si loin si proche), collectif Berlin Le point de départ des spectacles de Berlin se situe généralement dans une ville ou une région de la planète. Fondé en 2003 par Bart Baele, Yves Degryse et Caroline Rochlitz, le collectif anversois se caractérise par l’aspect documentaire et interdisciplinaire de son approche. Ensemble, ils ont entamé un cycle intitulé Holocène XX , avec les spectacles Jerusalem, Iqaluit, Moscow, puis le cycle Horror Vacui avec Tagjish, Land’s End et Perhap’s All The Dragons. C’est avec la journaliste Cathy Blisson qu’ils ont choisi de poser leur regard et leur caméra sur Zvizdal et ses deux habitants. Portait filmique, performance théâtrale sur multi-écrans... Zvizdal s’attache à l’existence de Nadia et Pétro, dans une banlieue de Tchernobyl. Inspirés par leur vie hors norme en terre contaminée, le groupe Berlin et Cathy Blisson ont réalisé un projet entre théâtre, installation et documentaire – d’une profondeur abyssale. Cette création, qu’on a pu voir à Bruxelles dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts aussi bien qu’au Centquatre-Paris, pendant le Festival d’automne 2016, a laissé sans voix bon nombre de spectateurs. Touchés, émus, respectueux, affolés..., difficile pour le public de sortir indemne de ce récit tragique et réel. Impossible de ne pas être en empathie avec ce couple de vieillards du bout du monde, qui continue à vivre comme si de rien n’était, dans une nature étonnamment luxuriante. Robinson Crusoé d’un cataclysme invisible (la radioactivité ne se décèle pas à l’œil nu), Nadia et Pétro vivent reclus dans un territoire abandonné des humains. C’est après plusieurs voyages en Ukraine que Cathy Blisson a rencontré (par hasard) ce couple incroyable qui vit dans la zone interdite de Tchernobyl. Critique dans les champs de la création contemporaine hybride, à la croisée des disciplines scéniques et autres arts visuels XX , Cathy Blisson connaissait la quasi-totalité des spectacles du collectif Berlin. Elle poursuit aujourd’hui un travail d’écriture en tant que dramaturge auprès de plusieurs compagnies et s’attelle à des projets personnels d’écriture textuelle et sonore, notamment avec Anne Quentin (Collectif &.). Quand elle a rencontré pour la première fois Yves Degryse et Bart Baele, après un de leur spectacle programmé au théâtre de la Cité Internationale, c’était sans arrière-pensée : « Nous avons commencé à discuter et j’ai évoqué ma rencontre avec Nadia et Pétro, qui vivaient comme seuls au monde dans un village déserté car soumis aux radiations. J’avais envie d’en faire un projet et il (Yves) m’a demandé si j’avais une équipe... et c’est parti comme cela. Bart et Yves ont cette capacité à rentrer par la petite porte dans les grandes histoires ou à voir les grandes choses dans de petites histoires, sans être intrusifs. Le premier tournage a commencé en 2011.» XX Pour mémoire, cela fait déjà une trentaine d’années (le 26 avril 1986, accident classé 7 sur l’échelle internationale des événements nucléaires) que le plus grave accident nucléaire (avec Fukushima) a eu lieu, dans cette ville du nord de Kiev, en Ukraine. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, 350.000 personnes ont été déplacées, des dizaines de villages rasés et des zones d’exclusion délimitées (voir Pierre Le Hir, « Retour à Tchernobyl », Le Monde du 25-04-16). Après plusieurs voyages dans cette région, Cathy Blisson a pu pénétrer dans la zone interdite grâce à un ami photographe et a découvert les nonagénaires : deux vieux magnifiques aux gueules burinées. Solaires, malgré leurs bouches édentées et leurs silhouettes amaigries et bancales. Nadia, dite Baba ou La Vieille – par celui qu’elle nomme le Vieux –, avance en boitant, miraculeusement. Ce projet s’est donc naturellement construit autour d’eux et de leur rythme lent. Par nécessité et respect pour ces deux personnes, qui sont aussi les personnages principaux du récit, avec leurs animaux : « Partir à la rencontre de Pétro et Nadia, âgés respectivement de quatre-vingt-six et quatre-vingt-cinq ans à l’époque, nécessitait un travail sur le long terme. C’était clair que nous devions rentrer dans le rythme de leur vie et suivre les saisons » XX , explique Yves Degryse. Filmés au fil du temps, 4 ans durant, le couple se révèle progressivement aux interviewers. Baba et son Vieux se confessent très simplement à la caméra. Philosophes en détresse, survivants de guerre lasse, ils n’ont jamais voulu quitter cet endroit malgré la radioactivité... Pour aller où ? C’est le plus bel endroit du monde. C’est là qu’ils sont nés et qu’ils ont grandi. Ils se connaissent et s’aiment depuis la tendre enfance. Ils ne connaissent pas d’Ailleurs. Cathy Blisson rappelle ces paroles sidérantes de Pétro : « Regardez-nous, on marche, on est debout ; ce sont les gens qui sont partis qui sont morts. Mon corps s’est adapté et si je partais, je mourrais. » XX La caméra du collectif Berlin les a accompagnés pendant tout ce temps au rythme de deux visites par an. D’une année (et d’une saison) sur l’autre, faute de moyens de communication, les créateurs ne savaient pas s’ils les retrouveraient. Lors des premiers temps du film documentaire, monté de manière chronologique, nous les voyons en compagnie de quelques animaux dont la présence est essentielle. Vache, cheval et chien faméliques ont des fonctions vitales dans cette existence précaire : l’un aide au champ, l’autre donne du lait, ils se tiennent chaud... Tournées en extérieur (le couple ayant interdit l’accès à sa maison), les images traduisent le drame d’un coin de planète anéanti. Autrefois, le village était habité, des gens y travaillaient, il y avait de l’eau et de l’électricité... Basiques, rares et sommaires, les mots de Baba et Pétro s’attachent à décrire le quotidien. Tels des personnages beckettiens, ils semblent frappés d’immobilité et d’essentialité. Devenus étrangers au danger qui les environnent, ils parlent de la vie, l’amour et la mort – qu’ils côtoient constamment et emporte progressivement les bêtes, puis le Vieux. Inexorable dépeuplement. Images de Baba dans sa cahute isolée qui croule sous la neige. Quintessence de l’immense solitude, inexorable dépeuplement... Autant de signes arrachés au monde insensé de Tchernobyl qui font à nouveau songer à l’univers de Beckett et plus précisément au Dépeupleur. Cette œuvre frappante de la littérature contemporaine propose en effet le modèle réduit d’un monde possible (ou pas), un curieux microcosme caractérisé par l’épuisement de son peuple... Au plateau, au milieu d’un dispositif bi-frontal, les images défilent sur un grand écran surélevé qui sépare l’aire de jeu centrale. Trois maquettes alignées en-dessous représentent l’environnement du couple : cour, jardin et champ environnant leur maison, l’une aux beaux jours, l’autre en automne et la dernière en hiver... Avec humanité et sans pathos, Berlin a su recueillir les témoignages troublants et presque irréels de Baba et Pétro, et les restituer sur les différents supports de cette scénographie. Leur spectacle (le mot ne convient guère) sans acteurs vivants, se déroule donc dans ce dispositif proche des arts plastiques : l’entièreté du documentaire est projetée sur le grand écran la plupart du temps ; et des extraits choisis sont présentés à l’intérieur des maquettes - qui sont elles-mêmes filmées en direct. Ces inserts du monde réel dans des décors de carton-pâte, tendent à déréaliser la vraie vie des survivants de Zvizdal : vie filmée dans monde truqué : illusion sur illusion... Les images de Baba et Pétro, enchâssées dans ces maquettes de territoires, donnent l’impression qu’ils sont les derniers figurants d’une ville fantôme. Bien que le recours à cette scénographique soit fait de manière parcimonieuse, l’effet produit…
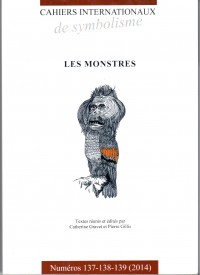
Introduction [page 37 de la version papier] Dans son essai Fiction : l’impossible nécessité, Vincent Engel XX signale que « le discours sur la littérature de la Shoah est dominé par une insistance sur l’incapacité de ce discours et plus particulièrement sa déclination artistique » XX . De fait, le judéocide fut une expérience d’une monstruosité telle qu’elle paraît se situer au-delà de tout ce qui est humainement imaginable, dicible et transmissible. Cependant, ces trois concepts, Engel les qualifie comme des mots qui ne trahissent que notre incapacité à imaginer, dire et transmettre, « des mots qui ne disent rien sur ce qu’on entend qualifier à travers eux » XX . Méditant sur le caractère toujours inédit et unique de l’expression de l’indicible, Engel montre comment le parcours du narrateur imaginé par Jean Mattern dans Les Bains de Kiraly XX (2008) atteste que, s’il est possible de surmonter la détresse en construisant un discours sur un événement apparemment inimaginable, indicible et intransmissible, le dépassement de cet inénarrable passe nécessairement par l’élaboration d’un récit personnel. Dans cette étude, nous nous proposons de nous faire l’écho des témoignages de deux voix majeures des lettres belges actuelles, deux romanciers [page 38 de la version papier] appartenant à des générations différentes mais dont les familles, juives, éprouvèrent dans leur chair et leur âme les atrocités nazies : Vincent Engel (°1963) et Françoise Lalande-Keil (°1941). Vincent Engel: Respecter le silence des survivants – Vous pourriez le laisser en prison, l’envoyer en Allemagne, dans un camp... – Vous ne connaissez pas les camps, monsieur de Vinelles ; sans quoi, je crois que vous me supplieriez de le fusiller sur-le-champ plutôt que de l’y envoyer XX ... Cette réplique de Jurg Engelmeyer, un officier allemand qui a ordonné l’exécution d’un jeune garçon en représailles aux actes commis par son père résistant, ne montre-t-elle pas que la monstruosité du nazisme hante le parcours romanesque de notre auteur pratiquement depuis son début ? Dans son article intitulé « Oubliez le Dieu d’Adam » XX , Engel relate qu’au cours de ses études de philologie romane à l’Université catholique de Louvain, son père lui offrit Paroles d’étranger d’Élie Wiesel, une lecture qui le bouleversa : Par le silence de mon père, par son indifférence à la chose religieuse, je redécouvre le judaïsme. Dans les livres, d’abord, au CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif) ensuite. Et Dieu se voile d’un drap sombre : celui de la souffrance à la puissance infinie d’Auschwitz. Toutes les souffrances se mêlent : celle de ma mère [décédée d’un cancer quelques années plus tôt], celle de la famille de mon père disparue dans les camps. (Idem, p. 72) Pourquoi parler d’Auschwitz ? Cette question, Engel s’astreindra à y répondre dès que cette réalité s’imposera à lui comme une « expérience marquante » bien que non vécue personnellement. La lecture et l’étude approfondie de l’œuvre de Wiesel imprimeront sur sa vision de la Shoah « un vocabulaire et des évidences : un monde était mort à Auschwitz, une société y avait fait faillite, et plus rien ne pouvait être comme avant » XX . D’où la nécessité, poursuit Engel, de « repenser le monde, refonder la morale, instaurer des conditions nouvelles pour la création artistique – pour autant qu’elle fût encore possible XX –, forger des mots neufs pour prononcer l’imprononçable [page 39 de la version papier] [...] » (idem, p. 18-19). D’autres évidences surgiront progressivement dans l’esprit de celui pour qui Auschwitz deviendra vite « une obsession » : celles de constater que la masse des documents publiés « n’ont guère servi à éduquer les gens » (idem, p. 20-21) et que les descendants des survivants, qui ont pour tâche de reprendre le flambeau du témoignage, doivent « trouver d’autres moyens d’expression, car ils n’ont pas vécu l’épreuve » (idem, p. 19). Si ses travaux scientifiques XX lui permirent d’« épuiser » la question « épuisante » de la responsabilité de Dieu devant le génocide juif ou, en tout cas, de tourner une page (ODA, p. 72), par après, c’est principalement à travers la fiction qu’Engel poursuivra cette interrogation sur la Shoah. Une interrogation qui trouve donc sa source directe dans la tragique histoire familiale et dans une identité juive ashkénaze fort ancienne. Comme il le détaille dans quelques interviews et articles XX , ses ancêtres paternels, polonais, étaient des juifs religieux appartenant à la bourgeoisie aisée. Bien que la situation dût se dégrader après la Première Guerre mondiale au cours de laquelle la famille se réfugia à Budapest où son père naquit en 1916, ils sont une famille juive inscrite dans le processus d’assimilation propre à cette période et à leur classe sociale ; les enfants fréquentent des écoles où ils côtoient la bourgeoisie polonaise catholique. Une intégration donc plutôt réussie mais qui n’empêchera pas leur déportation au début des années quarante. De toute la famille paternelle survivront un seul oncle, communiste avant la guerre et rescapé des camps, qui s’en ira faire sa vie à Los Angeles et y deviendra religieux orthodoxe, ainsi que le père de Vincent Engel, parti poursuivre ses études en Belgique vers 1938 et qui, après avoir passé la guerre dans les forces belges de la R.A.F, décidera de s’y installer définitivement : « Plus tard, il me dirait : “N’oublie pas que, pendant la guerre, des Juifs se sont battus”. » (Idem, p. 70.) Quand, à quarante ans, il rencontre son épouse, celle-ci, bien qu’appartenant à une bourgeoisie catholique bruxelloise imbue de solides préjugés, propose de se convertir au judaïsme. Une proposition qui sera rejetée par l’intéressé pour des raisons sur lesquelles l’écrivain ne peut que conjecturer : [page 40 de la version papier] Son athéisme s’était certainement renforcé à l’épreuve de la guerre et des camps. Ou bien, comme d’autres, refusait-il d’inscrire dans une telle tradition de martyre des enfants à venir. Ou bien, plus pragmatiquement, avait-il jugé que les meilleures écoles, à son avis, étaient catholiques. Hypothèse que conforte non seulement le refus de la conversion de sa femme, mais aussi le fait que ses enfants seraient baptisés, inscrits dans des écoles catholiques et feraient leur profession de foi. (Idem, p. 70-71) Une profession de foi qui, chez l’adolescent Engel, ne va pas de soi ! La découverte de l’œuvre de Wiesel et la relecture de Camus lui permettront de régler progressivement le conflit qu’il entretient avec ce christianisme qui prône la soumission, ferme les yeux sur les injustices les plus flagrantes – « Questionner Dieu sur la souffrance, celle d’Auschwitz ou celle de ma mère, accroît l’obscénité de la souffrance, puisque Dieu n’intervient pas et ne répond pas » (idem, p. 74) – et transmet à tous un goût certain pour la culpabilité. Ce qu’Engel (re)découvre dans Camus, la fausseté de la question de Dieu tout comme le devoir pour tout un chacun de suivre un cheminement éthique exigeant, n’est-ce pas en définitive ce que son père lui a transmis ? Évoquant ailleurs la figure paternelle, Engel insiste d’une part sur la certitude de celui-ci « qu’il n’y a pas de droits de l’homme sans le respect de devoirs, et de liberté sans responsabilité » ; d’autre part, sur « [son] impossibilité de dire à ses proches qu’il les aimait ». Et, ajoute-t-il, « pour ce qui est du judaïsme, un silence réduit à l’essentiel. [...] Mais un silence capable de faire passer le judaïsme, le sien, auquel son cadet au moins adhérera pleinement après ses vingt ans » XX . Car ce qui séduit Engel dans le judaïsme, c’est le fait qu’il représente « un rapport à…
