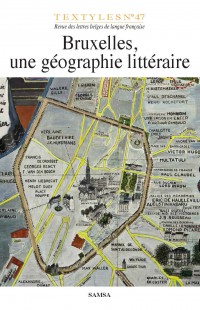
Laserra (Annamaria), Leclercq (Nicole) et Quaghebeur (Marc), dir., Mémoires et antimémoires littéraires au xxe siècle. La Première Guerre mondiale Bruxelles, PIE-Peter Lang, coll. « Documents pour l’Histoire des Francophonies », n° 15, 2008, 2 volumes, 426 et 339 p. * Cet ouvrage en deux volumes , co-dirigé par Marc Quaghebeur, publie les actes d’un colloque organisé en 2005 à Cerisy-la-Salle par les Archives et Musée de la Littérature et l’Université de Salerne. Inspiré par les Antimémoires d’André Malraux, où « l’Histoire côtoie la fiction, mais pas au sens de sa narration réaliste », cet ensemble de textes scientifiques centrés sur la Première Guerre mondiale et ses retentissements dans la littérature, esquisse un « parcours à l’intérieur de l’Histoire et de la Littérature de la Grande Guerre », mettant en relation les regards de critiques littéraires et d’historiens. Se limitant au théâtre de la guerre sur le front Ouest, les 33 contributions publiées analysent successivement les témoignages et positions d’écrivains célèbres qui n’ont pas participé au conflit (Rolland, Eeckhoud, Proust, etc.), pour s’intéresser ensuite aux récits de toute une variété d’auteurs, acteurs, « chantres » ou témoins de la guerre, écrits en 1914-1918 ou dans l’entre-deux-guerres, tentant d’évaluer la contribution de la littérature à l’organisation de la mémoire collective de la Grande Guerre. « Rebrassages de la mémoire historique » : les contributions rassemblées dans la troisième partie de l’ouvrage explorent les rapports entre l’écriture de l’Histoire et celle de la fiction et la question du pacifisme. Une quatrième partie, « Lointains après-coups d’une mémoire toujours vivace » s’attache surtout à la prise en charge de la guerre dans la fiction narrative belge, puis deux sections finales de cet imposant ouvrage présentent « quelques figures presque transhistoriques » de l’Histoire de 1914-1918 telles la guerre des gaz et la figure de l’infirmière, ainsi que deux récits de « derniers témoins » du conflit. Une perspective très large donc pour des contributions dont la diversité montre la richesse du patrimoine littéraire inspiré par la Grande Guerre. J’évoquerai brièvement ici quelques-unes de ces contributions, qui combinent l’analyse comparative des sources historiques avec l’analyse des textes littéraires et concernent des auteurs belges. Comme le note Sophie De Schaepdrijver , le déclenchement du grand conflit provoque une véritable « mobilisation culturelle ». La Belgique envahie, « nation héroïque d’abord, martyre ensuite », occupe une place majeure dans l’imaginaire de guerre des pays de l’Entente. Dans l’entre-deux-guerres, le démantèlement de cet imaginaire de guerre voit la réhabilitation de personnalités auparavant réprouvées, tel Georges Eekhoud, écrivain francophone de racines flamandes, mis au pilori dans la presse à la Libération, et pénalisé aussi sur le plan professionnel par les autorités de la Ville de Bruxelles, pour ce qu’on jugeait alors comme son manque de patriotisme durant l’Occupation. Mais l’historienne remarque : « l’image du vieil écrivain rebelle jetant son gant à la figure de l’idéologie nationaliste belliqueuse simplifie au point de déformer ». Le journal intime d’Eekhoud, demeuré à Bruxelles sous la botte allemande, permet de suivre le cheminement de sa pensée : lors de l’entrée en guerre et du début de l’Occupation, « Eekhoud se fait le chantre de la Belgique héroïque tout comme ses célèbres confrères Verhaeren et Maeterlinck ». Initialement, il « participe pleinement à la diabolisation de l’Allemagne ». Mais ensuite, l’image d’une ville dominée par le « chacun pour soi », la veulerie et la délation domine sa vision. Son regard d’écrivain y perçoit donc surtout « l’envers de la Belgique héroïque » : au lieu de souder la communauté nationale, l’Occupation la désintègre ! Hanté par la crainte de la déchéance sociale, Eekhoud en vient vite à considérer l’occupant comme un rempart face à « l’anarchie et la racaille ». Soucieux de sa gloire littéraire, il n’applique donc pas la consigne patriotique de ne rien publier tant que la Belgique est occupée, et signe en février 1916 un contrat avec l’Insel-Verlag qui publie ses œuvres dans une « Série flamande » à fins de propagande. Eekhoud est un des rares écrivains belges à avoir accepté une telle offre, ce que ses contemporains patriotes ne lui pardonneront pas. Après la guerre, ceux qui veulent réhabiliter l’écrivain rebelle, « chantre des ouvriers et des marginaux », mettront en valeur sa qualité de Maître de la littérature belge, qualifiant ses censeurs patriotes de ratés de la littérature et de « pygmées » et le pacifisme international fera de lui un héros du refus de la guerre... À travers l’œuvre d’écrivains belges réputés de l’entre-deux-guerres (Adolphe Hardy, Martial Lekeux, Laurent Lombard et Robert Goffin), Laurence van Ypersele analyse l’évolution de la représentation d’héroïques patriotes de la Résistance civile en Belgique (tels les Grandprez, Raoul Jacobs ou le commissaire Radino), aujourd’hui tombés dans l’oubli. L’immédiat après-guerre dans le pays endeuillé est marqué « par le culte des héros dont la mort est la gloire de la Patrie vivante et victorieuse ». De 1918 à 1924, alors que partout en Belgique s’érigent des monuments aux morts et que le culte des morts pour la patrie maintient le sens du conflit, les nombreuses publications de récits hagiographiques assurent à nos héros et martyrs la survie dans la mémoire collective. Mais dans toutes ces histoires édifiantes, les patriotes héroïques « se ressemblent étrangement ». La comparaison avec la figure du soldat est omniprésente chez ces civils exemplaires, agissant en véritables « soldats de l’intérieur ». Les récits décrivent peu les actions menées par ces résistants civils, de coups d’audace en missions dangereuses, et se concentrent plutôt sur la mort face au peloton d’exécution de ces simples citoyens, hommes et femmes ordinaires. Devenus par leur martyre « de véritables héros du civisme », tous semblent périr selon un même schéma, proche du récit de la Passion du Christ. L’évocation de la barbarie teutonne contraste avec la noblesse de ces « espions » fusillés, prouvant leur désintéressement total et la pureté de leur engagement patriotique par leur sacrifice suprême. Le sang de ces martyrs, « est une semence féconde de héros » et donc « leur mort a suscité de nouvelles vocations héroïques et encouragé la combativité des soldats du front ». De 1925 à 1933, le pacte de Locarno et la détente internationale favorisent le pacifisme et la démobilisation culturelle. En réaction, les « vrais » récits de l’héroïsme civil, mêlant histoire et fiction, cherchent à prolonger le culte de la patrie en danger et à alimenter la haine du Boche. De 1934 à 1940, l’ascension au pouvoir d’Hitler remobilise les esprits. Les histoires romancées de Laurent Lombard donnent des exemples de patriotisme à la jeunesse et appellent à l’unité nationale contre les menaces fascistes et flamingantes. La solidarité et le désintéressement des « passeurs d’hommes » et agents de renseignement, bons patriotes, s’oppose à la vénalité des Allemands. Dans sa contribution « De la culture dans les camps de prisonniers ? », Nicole Leclercq contextualise les souvenirs de guerre de son grand-père, Albert Delahaut, fait prisonnier le 6 août 1914, lors de la bataille pour Liège, rapatrié en janvier 1919, après une longue détention dans les camps de prisonniers de Basse-Saxe. Elle retrace le parcours de son aïeul et les multiples activités culturelles…

Le parti de l’étranger. L’Image du «réfugié» dans la littérature néerlandophone d’aujourd’hui
[Traduit du néerlandais par Christian Marcipont.] Le sort du réfugié est devenu un thème de la littérature contemporaine, y compris des lettres de langue néerlandaise. quels sont les auteurs qui, dans les plats pays, ont eu le courage d’aborder le thème du réfugié, montrant chacun à leur manière que la littérature peut apporter une plus-value parce qu’elle sait observer ce sujet sensible sous une multitude d’angles différents? * De nos jours , il est un thème – avec le climat et le terrorisme – qui domine et détermine l’actualité: celui de la migration. C’est surtout depuis les années 1990, qui voient le déclenchement de la guerre civile en ex-Yougoslavie, que la question des « réfugiés » en Europe est devenue un sujet aux nombreuses implications éthiques, politiques et sociales, et que les brasiers en Syrie et au Moyen-Orient ont rendu plus prégnant encore. Il est devenu l’enjeu de campagnes électorales virulentes et est aujourd’hui instrumentalisé comme jamais auparavant par les politiques, et cela sur le dos de groupes de population qui ne se doutent pourtant de rien. C’est aussi une question qui attise la rhétorique belliqueuse des populistes européens. Que cette problématique ne soit pas sans influencer la culture et la littérature contemporaines, c’est là une quasi-évidence. La question s’est toutefois déjà posée à maintes reprises: le réfugié est-il devenu le cache-misère idéal pour l’artiste qui cherche à s’avancer armé de son engagement? Et, mutatis mutandis, cela vaut-il également pour le monde des lettres? S’agit-il d’un passage obligé, d’une thématique « prémâchée »? Toujours est-il qu’à l’heure actuelle les romans et récits dont les protagonistes sont des réfugiés s’accumulent. Nombre d’écrivains traitent dans leurs livres des motivations des migrants et plus particulièrement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des sans-papiers. Ils racontent les obstacles à surmonter dans la quête d’une vie meilleure. Chose on ne peut plus logique si l’on considère que ce n’est pas d’hier que les écrivains observent les soubresauts du monde. Le sujet est au cœur de l’actualité et, de surcroît, ces dernières années les catastrophes se sont succédé sans relâche. Cependant, les écrivains ont parfaitement compris qu’il ne leur était pas permis de se jeter tête baissée dans la littérature pamphlétaire. Mieux vaut se tenir à quelque distance des versatilités de l’opinion. On ne peut sortir de son chapeau un « récit de réfugiés », sauf à espérer marquer un point par le biais du journalisme ou de l’essai. Il y a peu, par exemple, Valeria Luiselli a braqué les projecteurs sur les enfants mexicains qui traversent la frontière entre le Mexique et les États-Unis dans son livre de non-fiction Raconte-moi la fin, récit des expériences qu’elle a vécues comme interprète. Mais, récemment aussi, la même Valeria Luiselli leur a consacré un roman, Archives des enfants perdus, où elle raconte les vicissitudes d’une famille à la dérive, dans le contexte de la crise des réfugiés à la frontière du Mexique et des États-Unis. Or, les choses se présentent différemment dans un roman, qui est régi par d’autres règles: « Les récits qui trouvent leur origine dans la réalité nécessitent une plus longue période d’incubation s’ils veulent se transformer en fiction, beaucoup d’eau doit couler sous le pont avant que l’on atteigne la juste mesure », déclarait à ce propos l’auteur néerlandais Tommy Wieringa dans une interview accordée au quotidien flamand De Standaard. Si l’on considère la situation d’un point de vue international, on constate que les ouvrages dont les réfugiés occupent la première place suffiraient à remplir une bibliothèque entière. Dans le genre, Le Grand Quoi de Dave Eggers représente incontestablement un jalon: l’auteur, à travers un roman, raconte l’histoire de Valentino Achak Deng, un enfant réfugié soudanais qui émigre aux États-Unis sous les auspices du Lost Boys of Sudan Program. Citons ensuite le très populaire Khaled Hosseini. Ce dernier a acquis une réputation planétaire grâce à son livre consacré aux atrocités vécues en Afghanistan sous le régime des talibans. En définitive, le protagoniste des Cerfs-volants de Kaboul, après un passage par le Pakistan, finira par débarquer aux États-Unis. Dans le roman qui lui fait suite, Mille soleils splendides, Hosseini évoque également les camps de réfugiés en Afghanistan. « Voilà plusieurs siècles que la littérature prend fait et cause pour l’étranger, l’« autre », le réfugié », observait Margot Dijkgraaf dans le quotidien néerlandais NRC, renvoyant explicitement à l’œuvre du Français Philippe Claudel, qui n’a jamais fait mystère de son indignation quant au sort réservé aux réfugiés. Amer, humain, allégorique, factuel, pamphlétaire ou moralisateur: les angles d’attaque ne manquent pas dès lors que des auteurs se penchent sur le sujet. À quoi il faut ajouter que la question ne divise pas seulement la société, mais les écrivains eux-mêmes. Tommy Wieringa, par exemple, s’est depuis peu rangé à l’idée qu’« une frontière extérieure européenne sûre est nécessaire », ce qui est un point de vue d’adoption récente. Pour ne rien dire ici de Thierry Baudet, chef de file du parti de droite populiste Forum voor Democratie, qui ne répugne pas à se présenter comme écrivain. Parmi les représentants de la littérature d’expression néerlandaise, Kader Abdolah, originaire d’Iran, fut l’un des premiers à coucher par écrit son vécu de réfugié, entre autres dans De adelaars (Les Aigles) et Le Voyage des bouteilles vides XX . Depuis lors, les textes en prose consacrés à l’immigration sont quasiment devenus un genre en soi. Pourtant, des années-lumière séparent Hôtel Problemski XX, Dimitri Verhulst s’immerge dans un centre pour demandeurs d’asile, et l’effrayant L’oiseau est malade XX d’Arnon Grunberg. Souvent, le réfugié offre matière à opter pour des thèmes plus vastes. C’est ce qu’a réussi à faire, par exemple, Joke van Leeuwen avec Hier (Ici), une parabole sur les frontières et sur les contours de la liberté. « Les frontières maintiennent une pensée de type nous / eux, ce qui ne ressortit pas exclusivement au passé. Au contraire, j’ai l’impression que ce type de pensée binaire s’est renforcé ces dernières années », déclare-t-elle à ce sujet. Jeroen Theunissen, de son côté, a introduit subrepticement le thème des réfugiés dans son roman Onschuld (Innoncence) XX , où l’on voit le photographe de guerre Manuel Horst se faire enlever et torturer par des djihadistes dans le guêpier syrien avant, la chance aidant, de parvenir à s’échapper. Il est très peu disert à propos de sa nouvelle liberté, assure qu’il n’a nul besoin d’un soutien posttraumatique et tombe amoureux de Nada, une réfugiée syrienne. Il rentre avec elle en Belgique, où il leur faut batailler pour se construire une nouvelle existence avec le jeune fils de Nada, Basil. Mentionnons également Rosita Steenbeek, auteure de Wie is mijn naaste? (Qui est mon prochain?), un ouvrage engagé non fictionnel s’apparentant au reportage et consacré à l’accueil des réfugiés à Lampedusa, en Sicile et au Liban. Présenter un miroir au lecteur Venons-en à trois œuvres néerlandaises en prose qui traitent du thème des réfugiés d’une manière beaucoup plus directe et qui, pour se baser sur un récit nettement personnel, n’en parviennent pas moins à donner à cette problématique une portée universelle. Elvis Peeters (° 1957) – qui écrit ses romans en collaboration avec son épouse Nicole Van Bael – est un de ces auteurs flamands qui abordent régulièrement ce thème avec maestria, quoique sans menacer quiconque d’un doigt moralisateur. Plus d’une fois on trouve chez lui un penchant…

Est-il possible de s'attacher à un personnage odieux, ouvertement raciste et franchement…