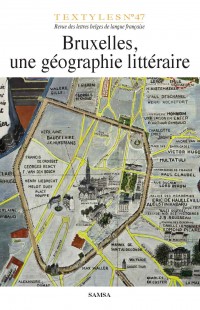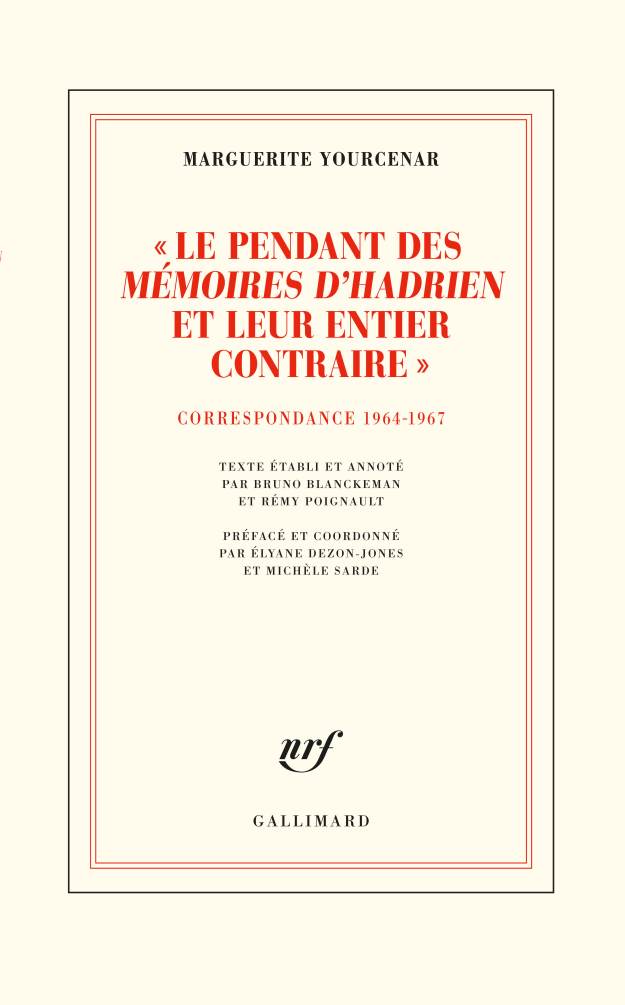En 1939, l’Amérique commence à Bordeaux. Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte (1938-1980)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Marguerite YOURCENAR
Auteur de En 1939, l’Amérique commence à Bordeaux. Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte (1938-1980)
Née à Bruxelles, le 8 juin 1903, de mère belge mais de père français, Marguerite Yourcenar est Française et le restera jusqu'en 1947, moment où elle deviendra Américaine.
Onze jours après sa naissance, sa mère, Fernande de Cartier de Marchienne, meurt des suites de l'accouchement. Son père Michel de Crayencour emmène l'enfant au Mont-Noir, en Flandre française. Marguerite gardera de cette enfance à la campagne l'amour de la nature et des animaux. Élevée par son père et par quelques précepteurs, l'enfant se familiarise très vite avec les auteurs latins et grecs. Très tôt, elle lira en italien et en anglais.
Quand la grand-mère meurt en 1909, Michel de Crayencour fait mettre en vente l'immense propriété et va vivre à Paris, multipliant les séjours à la Riviera, en Suisse et, plus rarement, en Belgique où réside sa belle-famille. La jeune Marguerite apprend ainsi à parfaire son éducation tout en voyageant.
Dès huit ans, elle rêve de devenir quelqu'un d'important et s'essaie à la poésie. Pour ses dix-neuf ans, son père lui offre la publication d'un dialogue poétique sur le mythe d'Icare : Le jardin des chimères. S'y exprime son ambition majeure : s'élever au-dessus de la mêlée. Le livre a la faveur de quelques critiques et la jeune fille rassemble des poèmes écrits entre la quatorzième et la seizième année. Publiés également à compte d'auteur, Les Dieux ne sont pas morts aborde ses futurs thèmes favoris : le paganisme hellénique, l'amour du passé et des sites, la passion des œuvres d'art.
L'attention portée aux documents iconographiques est là en germe et se développera par la suite, notamment dans Mémoires d'Hadrien. Enfin, ces poèmes démontrent une réelle puissance imaginative qui consiste à voir un personnage, ombre vivante, derrière la statue ou le personnage peint, don qui s'exprimera avec force lorsqu'il s'agira, vingt-cinq ans plus tard, de faire revivre Antinoüs à partir de la statuaire ou des monnaies. Un seul autre recueil de poèmes sera édité en 1956, Les Charités d'Alcippe, qui reprendra des poèmes de jeunesse retravaillés.
Il faudra cependant attendre Alexis ou le Traité du vain combat pour que la critique cherche à savoir qui se cache sous l'étrange pseudonyme de Marg. Yourcenar. Ce récit inaugure un style intimiste et un thème favori de l'auteur : le trio passionnel où la femme est rejetée par l'aimé qui aime un autre homme, situation que Marguerite Yourcenar a elle-même vécue, et qu'elle a connue dans sa prime jeunesse. Ainsi naît son premier roman, La Nouvelle Eurydice. Orpheline a vingt-six ans, Marguerite Yourcenar se lance dans les voyages et l'écriture.
Son Pindare plaît au lecteur de Grasset, André Fraigneau, qui fera également éditer Les Songes et les sorts (un essai agrémenté de récits de rêves récurrents), Feux, Denier du rêve (sur son expérience italienne de la montée du fascisme) et La Mort conduit l'attelage, trois récits sauvés d'un vaste et juvénile projet de roman.
À la déclaration de la seconde guerre mondiale, elle veut rejoindre la Grèce, mais, à court d'argent, accepte une invitation de Grace Frick, une Américaine rencontrée deux ans plus tôt, à se rendre aux États-Unis.
De 1939 à 1950, Marguerite Yourcenar produit peu et essentiellement du théâtre : Le Mystère d'Alceste, La Petite Sirène qui marque le moment où, pour l'auteur, la géologie et la méditation sur la terre ont pris le pas sur l'histoire et la méditation sur l'homme. Enfin, vient Électre ou la Chute des masques aux accents sartriens.
En relisant quelques pages sauvées d'une tentative de rédaction de 1937, elle se remet, début 1949, à écrire Mémoires d'Hadrien. Le livre, qui connaît un immense succès, est conçu comme une longue lettre adressée par l'empereur à son successeur Marc-Aurèle; il retrace de l'intérieur la vie et les pensées d'un homme d'État qui sut allier l'amour de la Grèce, de la beauté, du pouvoir et de la paix.
En 1947, Yourcenar prend la nationalité américaine. L'Académie royale de langue et de littérature françaises l'élit le 18 avril 1970 en tant que membre étranger.
Entre-temps, elle a écrit son chef-d'œuvre, L'Œuvre au noir. Sombre récit de la vie du philosophe et médecin Zénon se débattant contre l'enfer de l'Inquisition et préoccupé du seul perfectionnement de soi-même dans ce monde déchiré par les luttes religieuses. Œuvre pessimiste, elle captive pourtant par la victoire de l'homme sur lui-même. Marguerite Yourcenar est désormais un auteur célèbre et célébré.
Une grave maladie de sa compagne et traductrice, Grace Frick, la maintient durant dix ans à Petite Plaisance. Elle profite de cette réclusion pour rédiger les deux premiers tomes de la trilogie consacrée à un vieux projet : l'histoire de sa famille. Souvenirs pieux évoque sa famille maternelle, Archives du Nord, sa famille paternelle et l'histoire de son père. S'y exprime une préoccupation croissante : la nostalgie d'un monde à l'extrême bord de l'éternel qu'elle a rencontré et rêvé dès 1942.
Quand Grace Frick meurt, elle reprend ses voyages avec un nouveau compagnon, Jerry Wilson. L'étourdissement de la vie retrouvée l'éloigne un temps de l'écriture qui reste présente mais moins ardente. La gloire cependant l'assaille de toutes parts et elle est la première femme à l'Académie française. Elle est reçue le 22 janvier 1982 au siège de Roger Caillois.
Elle rédige de front essais et œuvres romanesques : Le Temps, ce grand sculpteur, En pèlerin et en étranger, Le Tour de la prison, Anna, soror..., Un homme obscur et Quoi? L'Éternité, dernier tome de sa trilogie resté inachevé.
En novembre 1987, retrouvant quelques forces, elle veut revenir en Europe pour visionner le montage du film qu'André Delvaux a tiré de L'Œuvre au noir. La veille de son départ, elle est hospitalisée. Elle meurt le 17 décembre à Bar Harbour.
NOS EXPERTS EN PARLENT...
Le Carnet et les Instants
Marguerite Yourcenar était une épistolière prolixe. L’époque, ses nombreux voyages, sa vie d’exilée sur son île états-unienne étaient propices à la correspondance. Nombre de ses lettres ont déjà paru en volume[1], il en paraît encore et probablement qu’il en paraîtra davantage quand ses archives, tenues secrètes jusqu’en 2037, selon sa volonté de fer, seront enfin dévoilées. Volonté de fer : Yourcenar blindait sa correspondance comme son œuvre. Ses lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte « n’ont pas été déposées par l’écrivaine dans les archives de la bibliothèque Houghton avec les correspondances destinées d’emblée à la postérité », comme le rappellent Elyane Dezon-Jones et Michèle Sarde, dans l’avant-propos. D’ordinaire, Yourcenar…