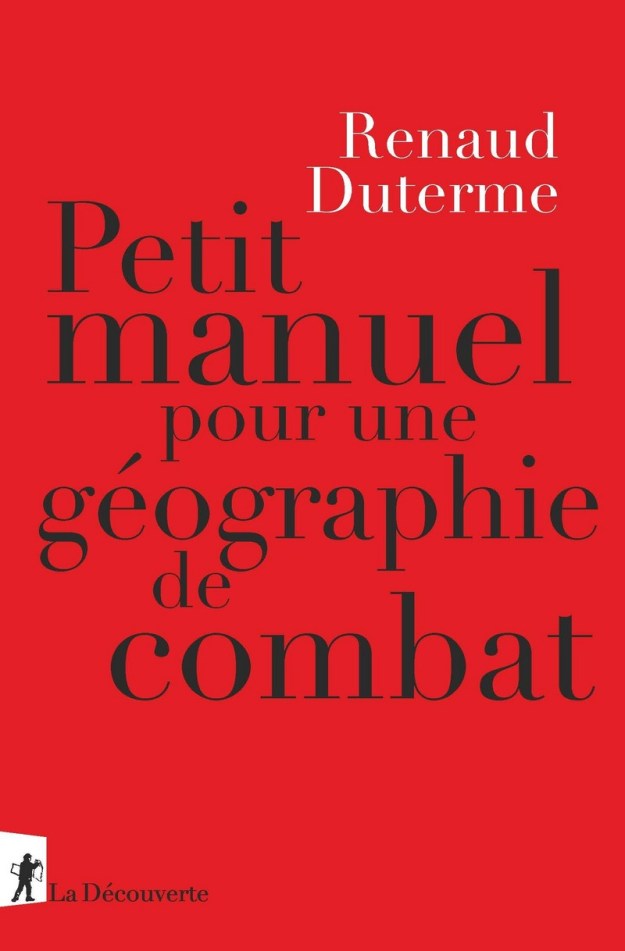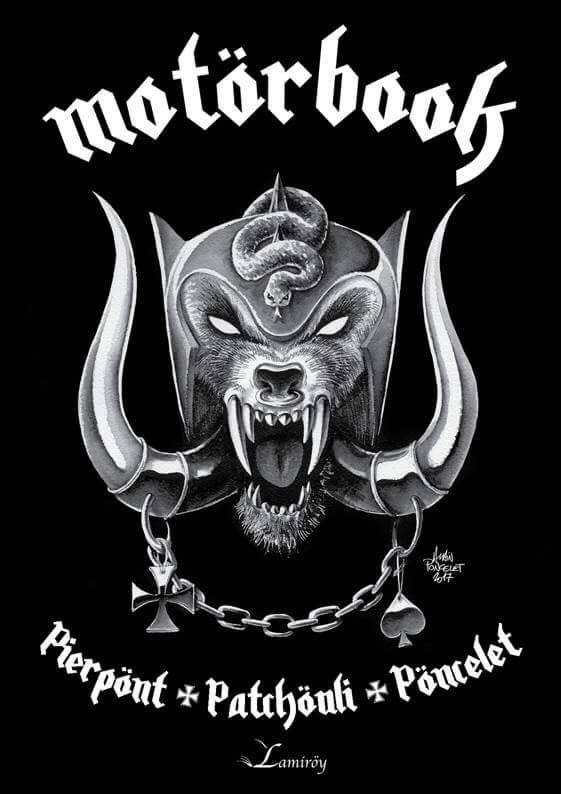
Aux bouillonnantes Éditions Lamiroy qui ont, entre autres, déjà publié les Abécédaires Doors, Kiss, Allo Bowie ? C’est David ! et lancé une collection de nouvelles hebdomadaires (Opuscule), le trio composé des journalistes rock Jacques de Pierpont et Patchouli et de l’illustrateur, auteur de bandes dessinées, Alain Poncelet, sort un abécédaire trempé dans la passion viscérale du rock. Loin de livrer une analyse à froid du phénomène Motörhead, loin de retracer du dehors la trajectoire du mythique groupe de heavy metal, ils dessinent un voyage à l’intérieur de l’univers de Lemmy Kilmister et de ses musiciens, creusant aussi bien la nouveauté musicale, la signature du groupe (énergie rebelle, rythmique d’enfer, riffs rapides, ballades renversantes, jeu de basse très particulier de Lemmy qui donne ce fameux « son Motörhead »…) que sa place dans l’histoire du rock, ses thématiques, l’évolution au fil de leur vingt-deux albums, les frasques de leur vie privée. Si, illustré par Alain Poncelet, préfacé par la chanteuse, la Metal Queen Doro Pesch et par Philippe Close, ce Motörbook ravira les aficionados de ce groupe placé sous la devise « Everything Louder Than Everything Else », il séduira plus largement les amateurs de rock dur et sans concession, ralliera ceux qui font du rock une manière de vivre, un mode d’existence vertébré par l’esprit de la liberté et de la révolte contre l’asphyxie du système. Ni encens ni tapis rouge mais le partage d’une expérience, de la fièvre d’une musique qui change la vie : notre trio d’auteurs passe derrière le mythe Lemmy, derrière le power trio d’idoles Lemmy/Phil Campbell/Mikkey Dee (dernière composition du line up du groupe). Motörhead n’est pas une icône à qui on rend un culte, mais une bouffée d’adrénaline, un style musical qui, derrière l’image réductrice d’une esthétique de la violence, du speed rock et de la hargne, cache une sensibilité lyrique, des sommets mélodiques, un art des textes ciselés au scalpel (aberration de la guerre, aliénation de la religion, haine du conformisme, résistance au pouvoir, fringale sexuelle, profession de foi anarchiste…). De ses débuts comme roadie de Jimi Hendrix à sa collaboration au groupe de space rock Hawkind, de la formation de Motörhead en 1975 en pleine vague punk au succès mondial avec les albums Overkill, Ace of Spades, Lemmy forge un univers nourri par les racines du rock, la veine du blues, l’ heroic fantasy . Faisant sauter les faux-semblants, les entraves, dynamitant les barrières entre les genres musicaux, Motörhead a absorbé l’héritage du rock incendiaire, contestataire afin de le recréer. Il a sauvé la flamme d’une musique qui va droit aux tripes en bâtissant un langage qui influencera décisivement le speed metal, le trash metal. Que, durant quatre décennies, Motörhead ait balancé au monde non seulement une musique marquant un avant et un après-Motörhead mais aussi une philosophie de vie, un style d’être au monde, les témoignages recueillis à la fin du volume l’attestent (ceux d’Anik De Prins, de Michel Stiakakis, Marc « Temple » El Khadem…). De l’Umlaut, du tréma qui surmonte le second O de Motörhead aux bootlegs, de la créature Snaggletooth — emblème du groupe — aux collaborations musicales entre Lemmy, Slash, Brian Robertson ou des girls bands, des chanteuses comme Girlschool, Doro…, le Motörbook délivre mille et une approches, plongées et contre-plongées, musicales ou sociologiques des princes…
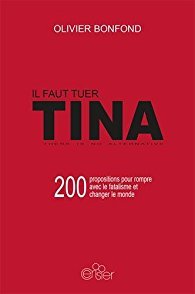
Il faut tuer TINA. 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde
Première ministre britannique de 1979 à 1990, Margaret Thatcher a beaucoup contribué à l’instauration de l’ordre néo-libéral qui mène aujourd’hui le monde. Son mot d’ordre : « There Is No Alternative », en acronyme TINA, signifiait que le capitalisme néo-libéral constituait le seul horizon possible pour le monde occidental. Et que, dès lors, il n’y avait rien d’autre à faire que démanteler les syndicats, privatiser les services publics (santé, transports, éducation), baisser les impôts, défaire le droit du travail, raboter les salaires, s’attaquer au système de protection sociale, favoriser les profits industriels et financiers en précipitant une partie sans cesse croissante de la population laborieuse dans la précarité et la misère. En somme : privatiser, déréglementer et appauvrir les moins nantis. Olivier Bonfond est un économiste progressiste, notamment spécialisé dans l’analyse de la dette publique [1] . Il ne partage pas cette vision fataliste. Il fait partie des économistes et des chercheurs de plus en plus nombreux qui considèrent que le capitalisme ultra-libéral épuise les ressources de la planète à court terme et, si rien ne change, mène l’humanité à sa perte. Dès lors, au prix d’un impressionnant travail de documentation, étalé sur plusieurs années et ayant bénéficié de beaucoup de soutiens amicaux, il a entrepris la rédaction d’un ouvrage monumental et ambitieux : Il faut tuer TINA. 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Que faire quand les inégalités explosent ? Son livre est divisé en quatre parties. La première énumère les défis à relever et met en perspective la notion d’alternative. Les trois autres s’attaquent en une quinzaine de chapitres à quelques grandes questions : « Mettre l’économie au service des peuples » (économie et finance), « Prendre soin des humains et de la planète » (conditions de vie et protection de l’environnement) et « Construire une démocratie réelle » (les conditions d’une citoyenneté active et critique).Un objectif fédère les propositions innovantes illustrées dans l’ouvrage : « Notre projet doit viser l’émancipation économique, politique et sociale des peuples, c’est-à-dire la possibilité pour l’humanité de se libérer de toutes les formes d’oppression », précise Olivier Bonfond.Pour l’auteur, la situation est « catastrophique » : « Non seulement les déficits sociaux, écologiques et démocratiques sont gigantesques, mais en plus ils vont grandissant ». Car « la grande majorité de l’humanité vit dans des conditions inacceptables. Et n’oublions pas que 70 % des personnes vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté dans le monde sont des femmes ». Quelques exemples : la faim tue 9 millions de personnes chaque année, 11% de la population humaine n’a pas accès à l’eau potable et 19% à l’électricité, 774 millions d’humains (dont deux tiers de femmes) sont analphabètes, deux milliards de personnes ne disposent pas d’un logement décent, la moitié des 3 milliards d’humains qui travaillent doit vivre avec moins de deux dollars par jour et plus d’un cinquième vit sous le seuil de l’extrême pauvreté.Une partie de la population des pays riches n’échappe pas à ces problèmes, car « Ces vingt-cinq dernières années, les inégalités ont explosé (…) Les mesures néo-libérales, en particulier la dérégulation financière, mises en œuvre pendant deux décennies et demi expliquent cette évolution terrifiante (…) En janvier 2016, un rapport d’Oxfam International concluait que les soixante-deux personnes les plus riches du monde possèdent la même richesse que la moitié la moins riche de la population mondiale ». Une démonstration rigoureuse La démarche est efficace : des faits étayés, des informations précises, des chiffres éloquents, des conclusions logiques et une attention particulière pour la situation des pays du Sud, particulièrement celle des femmes. La visée quasi encyclopédique du livre en rend la synthèse difficile, mais rares sont les domaines qui ne sont pas abordés (l’UE en tant que telle, peut-être). On observe cependant le souci constant de considérer les choses d’un autre point de vue : mettre en évidence la solidarité entre les peuples et les continents au lieu de constater l’exploitation des ressources et des êtres humains au profit de la minorité des 1% de rentiers, de cadres de haut vol, d’actionnaires et de spéculateurs.L’auteur multiplie les exemples de solutions alternatives inventées de par le monde pour tenter de faire pièce au néo-libéralisme : abolition des dettes odieuses ou illégitimes, observation de l’échec généralisé de la privatisation des ressources et des énergies, mise en évidence de l’effet désastreux du capitalisme sur l’environnement, inefficacité criante des politiques d’aide au développement, valorisation des initiatives populaires, des coopératives et des entreprises contrôlées par les travailleurs.Si l’ouvrage est ambitieux, il est également engagé : Olivier Bonfond défend avec conviction le projet d’un socialisme du XXIe siècle, solidaire et rationnel, mais dégagé des dérives totalitaires, opposé au néo-libéralisme destructeur, mais partiellement compatible avec l’économie de marché et, surtout, prioritairement soucieux du bien commun, de l’intérêt général, d’une démocratie renouvelée et de la survie de la planète. Des enjeux où se rejoignent à leur manière bon nombre d’économistes hétérodoxes et de penseurs qui réfléchissent aujourd’hui à l’avenir du monde dans une optique progressiste, comme les Économistes Atterrés, Jean Ziegler, Susan George, Naomi Klein, Chantal Mouffe, Paul Jorion, et bien d’autres. René Begon [1] Olivier BONFOND , Et si on arrêtait de payer ? 10 questions/réponses sur la dette publique belge et les alternatives…