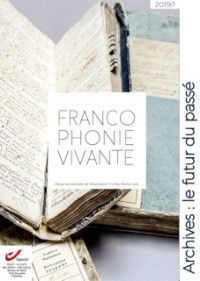
Quelle place pour le visuel dans les archives littéraires?
[Anne Reverseau est chercheur FNRS de l'Université catholique de Louvain.] Ce petit texte entend proposer quelques réflexions sur la place du visuel dans les archives des écrivains. Il s’agit plus pour moi de soulever des questions que d’apporter des réponses définitives, étant à l’orée d’un large programme de recherche portant sur la manipulation d’images par les écrivains, de 1880 à nos jours. Ce programme met l’accent sur les gestes que font les écrivains avec tout type d’images. Il s’appuie sur l’idée d’une continuité entre agencement d’images sur les murs, dans les manuscrits et dans les livres. La place du visuel dans les archives d’écrivains, une question longtemps peu pensée, est donc pour cette recherche tout à fait centrale. * Quel visuel? Je préfère dans ce cadre parler de « visuel » et non d’« images » pour permettre à des formes comme le dessin en marge du manuscrit, la sculpture ou le film d’entrer dans la réflexion. Les problèmes théoriques que soulève la définition de l’image sont en effet redoutables: l’image peut-elle être un original ou uniquement une reproduction? Y a-t-il des images en trois dimensions…? Dans les archives d’écrivains, on trouve plusieurs types de visuels, explicitement artistiques ou non, et produits ou non par l’écrivain. On pense d’abord aux captations vidéo ou aux photographies de plateau des adaptations théâtrales ou cinématographiques d’œuvres littéraires. Ce matériel figure en général dans les archives littéraires et peut servir à comprendre, comme les dossiers de presse, la réception et la continuation de l’œuvre. On pense ensuite aux nombreuses œuvres plastiques, notamment lorsqu’elles sont de la main d’un écrivain qui était aussi peintre, sculpteur, photographe ou cinéaste. Les lieux de conservation sont alors souvent différenciés. Les photographies d’Hervé Guibert sont par exemple conservées par la galerie Agathe Gaillard à Paris, tandis que ses archives littéraires sont à l’IMEC à Caen, comme celles de Pierre Albert-Birot dont le versant plastique de l’œuvre est, lui, au Centre Pompidou. Le cas d’Édouard Levé, écrivain et photographe contemporain, dont les archives textuelles et visuelles sont conservées au même endroit, à l’IMEC, fait plutôt figure d’exception. C’est aussi la chance du Fonds Henry Bauchau qui se trouve à l’Université catholique de Louvain. On trouve également aux côtés des archives littéraires les œuvres plastiques qui ont été offertes à l’écrivain, matériel important pour réfléchir aux relations entre les arts et commenter la façon dont les écrivains ont souvent été des amateurs, des regardeurs et des critiques d’art. Il faut ajouter à cela tout un ensemble d’images non artistiques, vernaculaires, personnelles ou au contraire industrielles, qu’elles appartiennent à l’écrivain (photographies d’amateurs ou dessins sans prétention, par exemple) ou qu’elles aient simplement été collectées par lui. Photographies, cartes postales, coupures de presse, images publicitaires, « images de peu » pour reprendre l’expression de Christian Malaurie XX , constituent un ensemble dont souvent les archives littéraires ne savent que faire. Cette imagerie pauvre constitue pourtant bien souvent l’environnement visuel d’un écrivain. Je veux parler de l’environnement visuel de son époque, de son lieu de résidence, de sa classe sociale, mais aussi plus précisément de celui de son «cabinet de travail» selon l’expression que Pierre Mac Orlan emploie dans un article sur l’importance du graphisme qui nous entoure XX . Comment, alors, conserver et valoriser les images souvent triviales qui figurent au mur ou sur le bureau d’un écrivain, son « décor domestique pittoresque » comme disaient les journaux et les magazines de l’entre-deux-guerres qui en étaient friands? * Archiver le visuel? La question des archives visuelles des écrivains possède un double enjeu de conservation et d’exploitation. Il est particulièrement difficile d’archiver l’imagerie pauvre qui accompagne les écrivains dans le travail de création. Si l’on pense aux images qui peuplent, depuis le 19e siècle au moins, les bibliothèques personnelles, singulièrement celles des écrivains, on imagine aisément les obstacles qui se dressent à leur conservation. Lorsque une bibliothèque intègre un fonds d’archives, on constitue un catalogue et chaque livre est collecté individuellement, dans un autre ordre que celui qui régnait en général sur les étagères. Parfois les archivistes vont photographier la bibliothèque telle qu’elle était utilisée, et éventuellement garnie d’images, sans conserver toutefois le matériel visuel de façon systématique. C’est par exemple la rencontre avec la bibliothèque, encore entière et illustrée, de Sebald sur qui Muriel Pic avait travaillé, qui est à l’origine de son projet d’exposition et de livre, Les Désordres de la bibliothèque, qui consistait à déplier les bibliothèques pour en faire apparaître le visuel. « Moment unique car les bibliothèques d’auteurs, quand elles sont conservées, sont “désossées” pour entrer dans le catalogue. J’ai photographié et je me suis rendu compte, comme je l’explique dans un article XX , que la bibliothèque avec les documents glissés dans les livres est un modèle pour sa manière d’introduire l’image dans le texte » XX . Pour plusieurs bibliothèques d’écrivains ou de penseurs, elle a ainsi sorti les images dont les livres étaient truffés pour les disposer sur les rayons, les photographier puis monter les images en une seule grande séquence. Cet exemple contemporain montre combien les archives visuelles des écrivains sont affaire de reconstitution plus encore que de conservation. L’environnement visuel se trouve en effet dans d’autres contextes aussi complètement mis en scène, par exemple dans les maisons d’écrivains et leurs reconstitutions spectaculaires d’un cabinet de travail ou d’une bibliothèque. C’est le cas de la bibliothèque et du bureau de Valery Larbaud à Vichy, dont le matériel visuel est important, ou des maisons de Pierre Loti ou de Victor Hugo, pour lesquelles la volonté de muséalisation remonte au vivant des auteurs. Ces cas contrastent fortement avec d’autres maisons d’écrivains singulièrement vidées de tout « décor domestique pittoresque » authentique, comme la maison de Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, ou la Casa Pessoa de Lisbonne. © Anne Reverseau, revue Francophonie vivante n° 2019-1, Bruxelles Notes 1. Chr. Malaurie, L’ordinaire des images. Puissances et pouvoirs de l’image de peu, Paris, L’Harmattan, « Nouvelles études anthropologiques », 2016. 2. « Le cabinet de travail d’un créateur, quel que soit son mode de création, modifie son pittoresque » (P. Mac Orlan, « Graphismes », dans Arts et métiers graphiques, no 11, 15 mai 1929). 3. M. Pic, « L’atlas fantastique: W.G. Sebald lit Walter Benjamin et Claude Simon », dans Quarto. Archives Littéraires Suisses, no 30-31: Urs. Ruch et Ulr. Weber (dir.), Autorenbibliotheken / Bibliothèques d’auteurs, 2010, pp. 72-76. 4. Entretien par courriel avec Muriel Pic (juin 2017). Chr. Malaurie, L’ordinaire des images. Puissances et pouvoirs de l’image de peu, Paris, L’Harmattan, «Nouvelles études anthropologiques», 2016. «Le cabinet de travail d’un créateur, quel que soit son mode de création, modifie son pittoresque», P. Mac Orlan, «Graphismes», dans Arts et métiers graphiques, no 11, 15 mai 1929. M. Pic, «L’atlas fantastique: W.G. Sebald lit Walter Benjamin et Claude Simon», dans Quarto. Archives Littéraires Suisses, no 30-31: Urs. Ruch et Ulr. Weber (dir.), Autorenbibliotheken / Bibliothèques d’auteurs, 2010, pp. 72-76. Entretien par courriel avec Muriel Pic (juin 2017).…

Jean Brismée, co fondateur de l'INSAS et « La Plus Longue Nuit du Diable »
Cinergie : En 1962, vous avez cofondé l’INSAS avec Raymond Ravar, Paul Anrieu et André Delvaux. Vous y avez enseigné jusqu’au milieu des années 1980. Pourriez-vous revenir sur cette aventure? Pourquoi créer une école de cinéma en Belgique? Qu’est-ce qui différenciait l’INSAS des autres écoles? Jean Brismée : Il y avait autour de la Cinémathèque, qui est ensuite devenue la Cinémathèque Royale, différentes personnes très cinéphiles. André Delvaux notamment. Ces gens-là considéraient que l’existence d’une école à Paris (l’IDHEC) nous obligeait presque à en créer une chez nous. Il y en avait déjà une, l’IAD. Or, dans le contexte politique, l’IAD étant catholique, il fallait nécessairement créer une école de cinéma laïque. Parce que notre pays est ainsi fait. En fait, une seule école de cinéma suffirait largement. Aujourd’hui, il y en a trois ! Trois écoles de cinéma pour tous les métiers, ça me semble totalement délirant. Mais notre motivation principale en 1962 était de créer une école d’Etat francophone, toujours sous un gouvernement unitaire. Comme nous avons créé l’INSAS, il fallait également une école flamande. C’est comme ça qu’est né le RITCS. L’INSAS et le RITCS partageaient leurs locaux, les professeurs se rencontraient dans les couloirs… tout allait très bien! * C. : Dans les années 1960, vous avez réalisé de nombreux documentaires en collaboration avec votre ami André Delvaux. Pourriez-vous nous parler de votre amitié? J. B. :Nous nous sommes connus par la Cinémathèque ! Nous avions des rapports excellents mais je dirais que la grande différence entre nous, c’est que Delvaux était un radical qui défendait exclusivement le cinéma d’auteur, tandis que moi je défendais les films de genre même si j’allais aussi voir les films d’auteur ! Je pense qu’une production ne doit pas être exclusive, il doit y avoir une production très large. Encore qu’on pourrait débattre très longtemps sur la définition de « film d’auteur »! C. : Vous étiez principalement connu comme documentariste. L’idée de passer au long-métrage de fiction en 1971 avec La Plus longue nuit du diable, était-elle là depuis longtemps ? Comment en êtes-vous arrivé à réaliser ce film ? J. B. : Je crois que j’en avais envie, tout simplement. Envie de me colleter un problème totalement différent de celui d’un documentaire de 20 ou 30 minutes. Mais en réalité, ce n’est pas exactement comme ça que c’est arrivé. Un jour, un de mes anciens étudiants de l’INSAS (qui n’a d’ailleurs jamais terminé l’INSAS), Charles Lecocq, m’a téléphoné et m’a dit : « J’ai un problème. Nous avons produit un film pour la Flandre Orientale, qui n’a pas été accepté. Est-ce que vous accepteriez de refaire le film, de regarder les rushes ? » Je lui ai dit : « Je ne regarde pas les rushes ! Je veux bien voir le film mais ça ne servira strictement à rien. » Je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Il m’a donc expliqué ce que la Flandre Orientale exigeait. J’ai donc ensuite écrit le scénario en une semaine, fait les repérages également en une semaine et puis nous avons tourné… en une semaine également, si mes souvenirs sont bons ! Tout ça s’est fait très vite. Ce film a été très bien accueilli et a même reçu un prix du scénario au Festival de Saint-Sébastien. Comme j’avais sauvé la maison de production du naufrage, un beau jour, ils m’ont téléphoné et m’ont demandé si j’aimerais réaliser un long-métrage. Ils avaient un scénario. La Commission refusait que ce soit un Français qui le réalise et ils ont donc proposé mon nom. Ils ont d’abord accepté « sous réserve », puis finalement, je leur ai dit que ce serait un excellent exercice. Faire ce long-métrage, pour moi, c’était comme un exercice d’école, tout simplement ! Mais ce n’est pas moi qui ai proposé le sujet. On m’a dit « voilà le scénario » et je l’ai accepté. C. : Vous êtes pourtant crédité au générique en tant que co-scénariste… J. B. : C’est-à-dire que j’ai participé aux réécritures. Je l’ai revu et terminé. J’ai réécrit certains dialogues mais la base était déjà là. C. : L’idée d’introduire le thème des sept péchés capitaux dans l’histoire (chaque victime correspond à un péché) vient-elle de vous ou était-ce un concept qui se trouvait déjà dans le scénario original ? J. B. : Non, c’était l’idée de Patrice Rhomm, le scénariste français. C’est d’ailleurs une idée ingénieuse, qui fonctionne très bien dans le film. C. : Dans ces années-là, le cinéma fantastique européen et le mélange horreur / érotisme étaient très populaires. Je pense évidemment aux films de la Hammer en Angleterre, ainsi qu’aux films de Mario Bava ou Antonio Margheriti en Italie. Le Masque du Démon, de Bava, a inspiré toute une génération de cinéastes. Est-ce que tous ces films gothiques vous ont influencé pour la création de La Plus longue nuit du diable ? J. B. : Disons qu’inévitablement, il y a des… je serais tenté de dire des poncifs du cinéma d’horreur, des figures, des idées qui reviennent. J’étais donc forcément un peu influencé par tout ça, mais je n’étais pas particulièrement attiré par ces films-là. Je pense que c’est un genre aussi respectable que les autres mais je ne suis pas du tout fanatique des films d’horreur. C. : Qu’en est-il du Surréalisme belge ? Nous sommes le pays du surréalisme par excellence. Est-ce que c’est quelque chose qui a influencé votre cinéma ? Comment expliquez-vous ce goût chez les artistes belges, que ce soit au cinéma, en peinture ou en littérature ? J. B. : Ah, ça, oui ! Je crois que le surréalisme est le mouvement libérateur entre tous ! C’est LE mouvement artistique du XXe siècle ! Je crois qu’un Belge normal a l’esprit un peu tordu. C’est probablement lié à cette rencontre entre deux cultures dans notre pays. On a connu des Surréalistes en Flandre comme en Wallonie. Pour moi, le surréaliste par excellence reste René Magritte, dans le domaine de la peinture, bien entendu, mais pour l’ensemble du mouvement. J’aime beaucoup sa façon de mettre côte à côte deux objets qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre et de voir le choc que cela produit. Dans mon travail, j’ai toujours suivi la voie la plus rigoureuse possible, mais les points de vue surréalistes m’intéressent beaucoup. C’est une autre réalité. En fait, je me rends compte que je ne crois pas tellement à la réalité à laquelle nous croyons appartenir. C. : Parlez-nous de votre collaboration avec Erika Blanc… J. B. : Erika est une femme superbe, d’une gentillesse incroyable et d’une grande simplicité. À l’époque, elle avait déjà beaucoup de films à son actif. Il y a dans le film une séquence où l’on voit son visage changer complètement. Pour cette séquence, je dois rendre hommage au maquilleur, Duilio Giustini, qui était un véritable artiste. Nous l’avons tournée image par image, ce qui veut dire qu’Erika devait rester immobile. Elle ne pouvait pas bouger d’un millimètre. Giustini ajustait son maquillage pour chaque plan. On tournait deux ou trois images, puis il remodifiait le maquillage. À l’ancienne ! Ça a dû être épouvantable pour elle mais elle ne s’est jamais plainte. C. : Ce maquillage est très réussi. La succube a une allure fantomatique et tragique, pas monstrueuse, comme c’est souvent le cas chez ces personnages-là. J. B. : Oui, c’est exactement ce que je cherchais. Et tous les trucages étaient à l’avenant. C’étaient des trucages à l’ancienne, c’était assez amusant. On se serait cru à l’époque de Méliès ! Comme dans ce plan où le contrat du Diable prend feu. Tout a évidemment été réalisé à même le plateau. C. : J’ai cru comprendre qu’avec Daniel Emilfork, qui joue Satan, la collaboration ne s’est pas bien passée du tout. Il est pourtant devenu…

Vie du livre : La librairie labellisée, un lieu de qualité pour le lecteur et la promotion du livre
Poussez les portes des librairies labellisées ! Vous serez certain d’y trouver l’accueil digne du lecteur que vous êtes. La fête du livre y est perpétuelle : rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, heures du conte, ateliers thématiques, clubs de lecture pour tous les âges, expositions, séances de dédicaces, nocturnes... l’imagination est au pouvoir. Depuis 2007, un label des librairies contribue à valoriser un métier essentiel à la vie culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Actuellement, 54 librairies sont labellisées en Wallonie et à Bruxelles (v. la liste en bas de page* ). Vous les identifierez grâce au logo du label qu’elles affichent. Onze critères, définis en concertation avec le Syndicat des libraires francophones de Belgique, permettent de déterminer les bénéficiaires du label « le libraire ». Ces critères ont fait l’objet en juillet 2013 d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d’usage et de contrôle de la marque « le libraire ». Ils peuvent se résumer en quelques mots clés : Primauté du livre, accueil par des libraires professionnels bien outillés et formés, acceptant la commande à l’unité et proposant un assortiment de nouveautés, d’ouvrage de fonds et de titres d’auteurs belges sans restriction de distributeur ou de maison d'édition. Ce label donne accès aux aides de la FWB qui sont principalement de trois ordres : des subventions pour l’organisation de rencontres littéraires et pour des abonnements à des outils bibliographiques professionnels, ainsi que des prêts sans intérêts pour l’aménagement et l’équipement des lieux. En 2016, la FWB a financé 314 animations littéraires dans 33 librairies labellisées et ceci ne représente qu’une petite partie du programme culturel développé par les libraires dans leurs murs ou en partenariat avec des théâtres, des centres culturels, des festivals, des écoles... La lecture : un enjeu global et territorial Pour qu’écoles, bibliothèques publiques, centres culturels mais également auteurs et éditeurs puissent agir ensemble pour le développement de la lecture, le déploiement d’un réseau dense de librairies indépendantes est essentiel. La lecture est un enjeu global et territorial capital : là où se développent bibliothèques et librairies, la démocratie se renforce. Les mandataires politiques qui s’emparent de cet enjeu territorial fort contribuent au vivre ensemble grâce au livre et à la lecture. Cette volonté politique peut notamment se concrétiser par le choix des critères d’attribution de marchés publics d’achat de livres permettant un véritable partenariat entre écoles, bibliothèques, centres culturels d’une part et librairies indépendantes d’autre part. Un accord-cadre Les collectivités locales et pouvoirs organisateurs des bibliothèques mais aussi des écoles sont confrontés à la passation de marchés publics de livres sans être toujours outillés pour fonder leur sélection sur des critères de qualité. C’est donc souvent le taux de remise qui détermine le choix. Dans cette logique, les librairies sont amenées à forcer leurs ristournes, risquant ainsi de mettre leur commerce en difficulté et les collectivités locales sont conduites à sélectionner des fournisseurs peu performants, voire défaillants. L’accord-cadre portant sur un marché de fournitures de livres (imprimés et numériques) du Ministère de la Communauté française vise à mettre fin à cette situation. Ce vaste marché public est accessible à tous les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais également aux 102 pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires qui s’y sont ralliés (villes, communes, pouvoirs organisateurs de bibliothèques...). Ce marché a été attribué en janvier 2017 à l’Association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour une durée de quatre ans. Cette association est composée de 50 librairies réparties sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les différents pouvoirs adjudicateurs pourront donc commander indifféremment dans ces établissements sans limitation d’aucune sorte et selon leur nécessité du moment. Par cet accord-cadre, la Fédération Wallonie-Bruxelles renforce son soutien aux bibliothèques publiques et au secteur de la librairie. Un décret pour soutenir entre autres les librairies Le réseau de la librairie indépendante, véritable poumon culturel et économique local, a été parfois mis à mal ces dernières années par différents mouvements économiques. Il revient aux autorités publiques de soutenir ce réseau constitué souvent de toutes petites entreprises pour maintenir la liberté de choix du lecteur, la profusion et la diversité culturelles, aux profits des auteurs, des éditeurs et de tous les citoyens, mais aussi pour éviter le processus de concentration tel qu’il s’est développé au Royaume-Uni, en Italie, en Flandre où les librairies indépendantes disparaissent au profit de chaînes qui influencent de manière restrictive les choix éditoriaux des éditeurs. Le projet de « Décret relatif à la protection culturelle du livre » est actuellement examiné par le Conseil d’État. Il devrait être voté fin 2017 pour entrer en application en 2018. Il a pour finalité de construire, en Fédération Wallonie-Bruxelles, une politique de soutien à la création, à la diffusion et à l’accessibilité des livres en limitant les remises autorisées et en abolissant la pratique de la « tabelle » ou mark-up (surcoût appliqué au prix des livres importés de France). Il a été rédigé après une concertation menée avec les associations professionnelles (la Maison des auteurs, l’Association des Éditeurs belges, le Syndicat des Librairies francophones, ProDiPresse, Espace Livre & Création) et les instances d’avis compétentes en la matière (le Conseil du Livre, le Conseil des Bibliothèques Publiques, la Commission d’Aide à l’Edition, la Commission d’Aide à la Librairie) et entend répondre aux demandes légitimes du secteur du livre. Parmi les nombreuses motivations exprimées par celui-ci, on relèvera notamment la protection de la diversité culturelle, la démocratisation du livre et la promotion de la lecture, la suppression de la « tabelle » devant mener à une diminution du prix payé par les consommateurs pour l’achat de livres édités en France (soit plus de 70% des livres achetés en Belgique francophone), une juste concurrence entre les librairies, les grandes surfaces et les sociétés de vente en ligne. « Le présent dispositif veut inscrire, dans les outils législatifs de la Communauté française, une mesure de politique culturelle globale visant le soutien aux acteurs du livre et plus spécifiquement aux créateurs (auteurs, illustrateurs, traducteurs...) et aux diffuseurs culturels que sont les différentes catégories de détaillants, et en particulier les libraires de premier et second niveaux. Il vient renforcer la politique du livre développée, entres autres, grâce au "Plan Lecture" (lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, promotion de la lecture dès le plus jeune âge...) » (extrait de l’exposé des motifs de l’avant-projet de décret) Le décret devrait ainsi définir les acteurs autorisés à déterminer le prix des livres (imprimés et numériques) vendus en Communauté française ; il devrait également fixer les limites des variations de prix, à la hausse comme à la baisse, en pourcentage et leur cadre temporel ; il déterminera les dérogations accordées pour l’achat de livres par certains organismes. Cette régulation du livre devrait permettre de faire respecter le prix créé par l’éditeur qui en gardera la maîtrise. Tous les détaillants pourront être en concurrence, non plus sur les taux de remise sans rapport avec la valeur réelle du livre, mais bien sur la fiabilité des services fournis, la variété, la disponibilité…