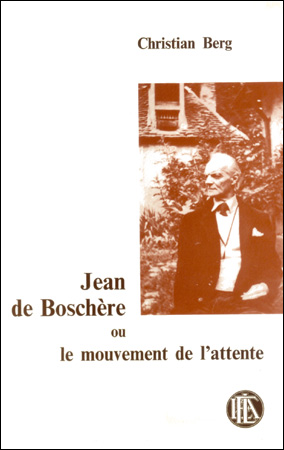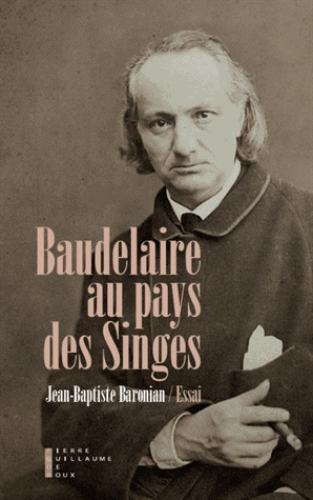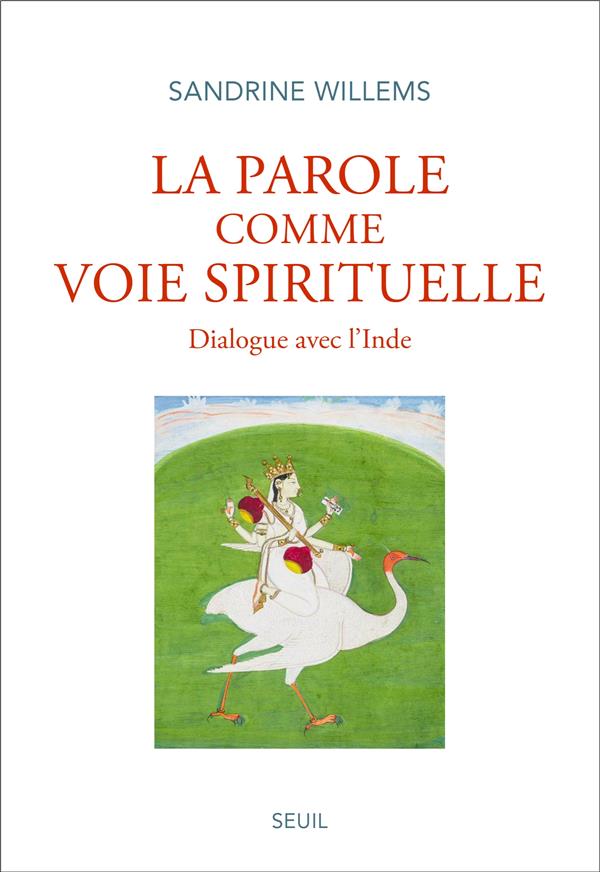
La parole comme voie spirituelle. Dialogue avec l’Inde
Sandrine WILLEMS , La parole comme voie spirituelle. Dialogue avec l’Inde , Seuil, 2023, 200 p., 19,50 € / ePub : 13,99 € , ISBN : 9782021493276 Dans son dernier essai, l’écrivaine, philosophe, psychanalyste et réalisatrice Sandrine Willems nous invite à un décentrement, nous propose un voyage mental, esthétique et conceptuel loin de l’anthropocentrisme qui a façonné l’Occident. S’ils se voient remis en question de nos jours, de l’intérieur de nos sociétés, l’anthropocentrisme de l’Occident et son primat de l’humain ont eu une incidence sur notre perception de la parole réduite à la sphère humaine, confisquée par cette dernière. L’ouverture de l’esprit aux dimensions qui échappent à la raison se fait sœur d’une expérience de la spiritualité qui, afin de ne rester murée dans l’indicible, doit se mettre en quête d’un langage, plus exactement d’une parole qui puisse en rendre compte. Éblouissant essai sur les diverses visions de la parole, sur sa nature, son origine, son statut, ses effets, réflexions sur les puissances, les ressources, les mystères qu’elle détient, La parole comme voie spirituelle. Dialogue avec l’Inde nous convie à une rencontre avec l’Inde ancienne. Sandrine Willems porte à la lumière la manière dont la spiritualité indienne envisage la parole comme une énergie qui transit toutes les formes de l’être et de la vie, de l’animal au végétal ou au minéral, du divin à l’humain. L’affirmation d’une continuité entre humains et non-humains se traduit dans une pensée qui, loin des dualismes de l’Occident et de leurs conséquences, envisage les échos, les correspondances entre les entités et le Tout, entre les existants et le cosmos.S’appuyant sur les textes fondateurs de l’hindouisme et les différents courants de pensée indienne, des Védas aux Tantras, de la Bhagavad-Gita aux Upanishads , de l’épopée sanskrite Mahabharata au recueil Yoga Sutras , Sandrine Willems propose la conjugaison d’une voie esthétique et d’un chemin spirituel. À partir de la pratique du yoga qu’évoque l’autrice, de la découverte de la musique indienne, des mantras qui pulsent le chant, l’essai explore les enseignements de l’hindouisme et du bouddhisme, leurs puissances thérapeutiques, la gémellité entre exploration intérieure et expression esthétique, l’ouverture à une écoute qui libère la parole, la vie des critères de l’utilité et du savoir. Au cœur du texte, une mort, celle de la mère, une crise sanitaire, une pandémie, symptôme d’une crise du système. Se tenant dans une région qui abolit et transcende la division entre théorie et pratique, la pensée indienne s’offre comme une alternative à l’effondrement d’un système capitaliste mondialisé lié à une vision du monde. Non pas une panacée mais une autre voie. Affin au continuum entre affect et concept, entre pensé et vie qui sous-tend la pensée indienne comme il vertèbre les philosophies de l’immanence de Spinoza à Deleuze ou certains corpus des mystiques, le corps du texte est transi par une parole qui le dépasse, qui l’excède, qui, faisant l’épreuve de noces entre non-maîtrise et laisser-être, transforment autant la scriptrice, l’autrice que les lectrices et lecteurs. Lorsque la poésie fait résonner l’homme et le non-humain, elle rejoint la résonance que visait la musique, le dhvani (…) L’affect cette fois n’est plus causé par le monde, mais par quelque chose qui le dépasse. Les cheminements dans les textes, les œuvres de Plotin, de mystiques, de Maître Eckhard, de Lacan, de Heidegger, de John Cage, la subtilité des rapprochements, des frottements idéels entre Rabindranah Tagore, Bataille, Foucault, Deleuze s’emportent dans les mouvements d’un texte derviche tourneur qui épouse une parole perçue comme une énergie, un souffle, une expérience inscrite dans un rapport au sacré. Point d’ombilic du sacré, la parole, son nouage entre sens et sons, son espace où respire le silence, produisent des effets thérapeutiques, sont dotés d’effets performatifs : la conception de l’Inde rejoint celle de la psychanalyse fondée sur les vertus de la cure par la parole. Les passerelles entre la parole védique et l’idéalisme allemand, entre des textes mystiques et philosophiques occidentaux et la pensée indienne, l’analyse de la conception heideggérienne du Quadriparti, de la poésie conçue comme reliance entre la terre et le ciel, les humains et les dieux, comme l’expression d’une quasi-identité entre le Denken, le penser et le Danken , le remerciement forment autant de scansions d’une réélaboration spirituelle de la vie. Laquelle passe par la vivification de la parole. Véronique Bergen Plus d’information…