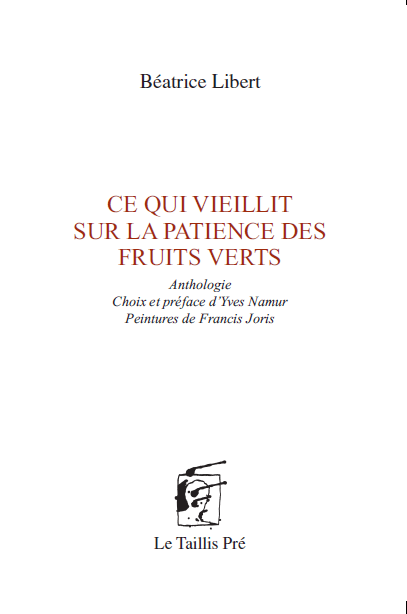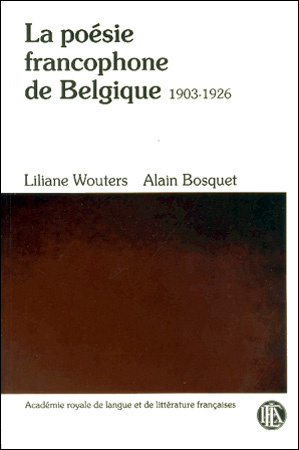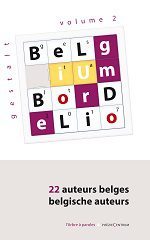La mer dans la littérature française
RÉSUMÉ
De François Rabelais à Alexandre Dumas ; De Victor Hugo à Pierre Loti. 2 vol.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Simon Leys
Auteur de La mer dans la littérature française
Pierre Ryckmans naît le 28 septembre 1935 à Bruxelles, de parents d'origine anversoise, grands amateurs de livres. Dès 1955, étudiant en droit et en histoire de l'art à Louvain, il participe à une délégation de jeunes Belges invités en Chine. Ce voyage initiatique déterminera le cours de son itinéraire intellectuel et de sa carrière sinologique.
Ses études en Belgique terminées, son apprentissage de la Chine se passe de 1959 à 1970, à Taiwan, à Singapour et à Hong-Kong. C'est au contact des milieux universitaires et des réalités vécues dans ces grandes banlieues extrêmement actives et dynamiques d'une Chine continentale alors en proie à une révolution chaotique que s'accomplit sa seconde éducation, élective celle-ci. Le double accès à la Chine, savant et quotidien, alimentera l'étonnante diversité d'une bibliographie où les austères travaux d'érudition classique de Pierre Ryckmans voisinent avec les flamboyants pamphlets d'actualité politique de Simon Leys. Il favorisera aussi l'éclosion d'une vocation littéraire et d'une indépendance d'esprit qui cadraient mal avec les contraintes académiques de la sinologie conventionnelle. Ce qui constitue en effet la marque singulière de l'apport de Pierre Ryckmans à la sinologie, c'est bien la qualité littéraire de tous ses ouvrages. Avec lui, on redécouvre que la littérature n'est pas ornement, mais la force et la vérité même du langage. Il est fort rare que ces facultés soient mises au service de la science!
Ses deux premiers ouvrages relèvent du versant classique de son activité. Dans les Propos sur la peinture du moine Citrouille-amère, pour l'étude du célèbre traité de Shitao (début du XVIIIe siècle) qui se situe à la fois au terme et au sommet d'une littérature esthétique développée durant quelque mille cinq cents ans, Ryckmans privilégie une approche rigoureusement philologique. Il s'agit donc d'accompagner la traduction du traité d'un glossaire des termes philosophiques, esthétiques et techniques. L'édition originale (1970) portait en sous-titre «Contribution à l'étude terminologique des théories chinoises de la peinture» et ne s'adressait qu'à une audience spécialisée. Mais le livre fut repris ensuite par un éditeur commercial (1984) pour atteindre le grand public, plus particulièrement celui des artistes. Toujours dans le domaine de la peinture, on signalera au passage que les notices biographiques des grands peintres rédigées par Ryckmans pour l'Encyclopaedia universalis constituent à ce jour une des plus abordables et des plus sûres introductions à l'histoire de la peinture chinoise.
Avec sa traduction de Shen Fu, Six récits au fil inconstant des jours (1966; réédition 1982), Ryckmans aborde une série de traductions littéraires. Les mémoires de Shen Fu constituent un document unique sur la vie quotidienne dans la Chine de la fin du XVIIIe siècle. Il s'attache aussi à Guo Mo-ruo : Mes années d'enfance (1970) et à Chen Jo-hsi : Le Préfet Yin.
Un séjour prolongé à Hong-Kong aboutit à la publication presque simultanée de deux livres; le premier, La vie et l'œuvre de Su Renshan, rebelle, peintre et fou, 1814-1849 (1970) est une monographie sur un peintre maudit dont la personne et l'œuvre échappèrent de peu à un oubli complet. Cette méditation sur la fragilité de la mémoire historique se présentait comme un travail classique d'histoire de l'art (couronné du prix Stanislas Julien, de l'Institut de France, la plus haute récompense couronnant un ouvrage sinologique), mais il préfigurait aussi cette conception de la mission morale de l'historien qu'allait développer Simon Leys dans sa dénonciation de l'imposture maoïste.
Simon Leys est né avec Les habits neufs du président Mao : chronique de la révolution culturelle (1971). Le style de combat du livre ne doit pas masquer qu'il s'agit essentiellement d'un travail de recherche et d'analyse politique dont les jugements, qui firent scandale à l'époque, furent entièrement confirmés par les événements qui suivirent l'ère maoïste. Récit personnel d'un séjour en Chine, Ombres chinoises (1974) est une dénonciation du mensonge maoïste et de la complicité de ses thuriféraires occidentaux. Traduit en neuf langues et couronné de nombreux prix, Ombres chinoises devait consacrer la réputation internationale de son auteur.
Deux recueils d'essais sur la culture et la politique chinoises, La Forêt en feu (1983) et L'humeur, l'honneur, l'horreur (1991) permettent à l'universitaire Ryckmans et au pamphlétaire Leys de se rejoindre en un seul auteur. La jonction de l'érudition et de la polémique permet également à l'écrivain, avec un court essai sur 0rwell ou l'horreur politique (1984), de s'acquitter d'une dette intellectuelle et morale envers un des esprits les plus lucides et les plus courageux de notre siècle — comme il l'avait déjà fait dix ans plus tôt envers l'Orwell chinois : Lu Xun (La mauvaise herbe de Lu Xun dans les plates-bandes officielles, 1975).
Un des plus ambitieux de tous ses travaux littéraires, paradoxalement, n'est pas un travail chinois : il s'agit de sa traduction d'un classique américain de 1840, Richard Henry Dana : Deux années sur le gaillard d'avant (1990), chef-d'œuvre de la littérature de la mer qui avait inspiré Melville.
La Mort de Napoléon (1986) est le seul ouvrage de fiction publié à ce jour par Simon Leys. Comme tel, il a marqué un tournant dans sa carrière. Traduit en plusieurs langues, dont prochainement le japonais, c'est dans sa version anglaise que The Death of Napoleon semble avoir trouvé sa forme la plus naturelle et sa langue véritablement maternelle, ce que confirment ses multiples rééditions anglaises, les prix littéraires qui lui ont été décernés en Angleterre et en Australie. Cette affinité avec la sensibilité anglo-saxonne, réelle et profonde, a fait de Simon Leys un écrivain de langue anglaise à part entière.
Simon Leys a été élu à l'Académie le 10 novembre 1990.
Simon Leys est mort à Sidney le 11 août 2014.