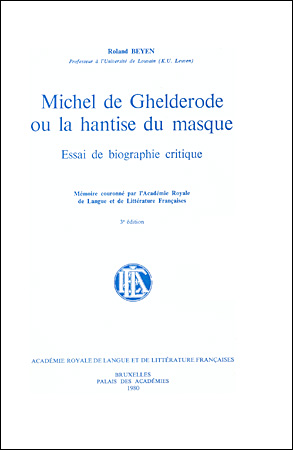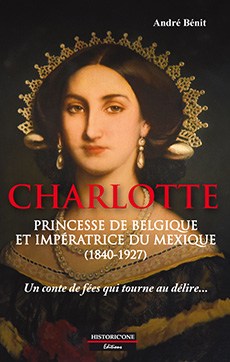
Charlotte princesse de Belgique et impératrice du Mexique (1840-1927)
Un destin qui a soulevé beaucoup de curiosité, c’est celui de Charlotte de Belgique (1840-1927) dont la longue vie sombra très tôt dans la folie. Elle la termina dans le calme d’un délire installé, mais dans un état physique relativement stable et constant. Nombre d’études, commentaires ou histoires figurent parmi les références bibliographiques du dernier ouvrage en date qui lui est consacré par André Bénit, professeur à l’Université Autonome de Madrid. Charlotte princesse de Belgique et impératrice du Mexique s‘inspire en effet des plus récentes recherches historiques et psychiatriques concernant cette princesse, un ouvrage commenté ainsi dès sa première de couverture : un conte fées qui tourne au délire. Ce qui se confirme au regard d’un bref résumé. Charlotte est la petite-fille de Louis-Philippe, la fille chérie de Léopold Ier, la cousine de la reine Victoria. Elle devient archiduchesse d’Autriche à la suite de son mariage avec Maximilien de Habsbourg et impératrice du Mexique à l’âge de 24 ans. Elle est aussi la sœur de celui qui deviendra Léopold II. Maximilien est nommé gouverneur de Vénétie-Lombardie par son frère François-Joseph qui mettra pourtant fin à sa charge. Ce séjour n’excédera pas la défaite de Magenta et de Solferino en 1859, mettant fin à la présence de l’Autriche en Italie, et le couple se retire à Miramar, près de Trieste. Mais les feux d’un empire nouveau brillent et ils quittent l’Europe pour le trône du Mexique qui plaît peut-être davantage à Charlotte qu’à son mari. Les années mexicaines sont finalement assez brèves : elle rentre en Europe en 1866 et d’abord à Paris pour plaider la cause mexicaine auprès de Napoléon III. Elle y affronte une fin de non-recevoir. De même, peu après, lors de sa requête à Rome auprès du Pape Pie IX : deux entrevues dont l’échec sera péniblement vécu.Selon les témoignages d’époque, elle a manifesté dès le Mexique, pendant la traversée et surtout au moment du retour, des tendances paranoïdes, notamment l’effroi devant certaines nourritures ou boissons, la peur d’être empoisonnée, la certitude d’être une cible, sans parler d’une secrète absence d’entente conjugale véritable avec Maximilien qui aurait précédé…Mais l’auteur fait référence à des sources plus récentes et notamment à l’étude du psychiatre Émile Meurice, Charlotte et Léopold II de Belgique. Deux destins d’exception entre histoire et psychiatrie (2005), selon qui les troubles remonteraient aux remaniements du psychisme dès l’enfance. Les travaux de l’historienne Dominique Paoli, L’impératrice Charlotte. « Le soleil noir de la mélancolie » (2008) et de la psychanalyste Coralie Vankerkhoven, Charlotte de Belgique : une folie impériale (2012) qui ont pour l’une accès à des archives inédites et pour l’autre à la totalité de la correspondance de la princesse, ont mis plus récemment en lumière la longue période qui va du retour de Miramar, lieu de la retraite forcée, à Bruxelles, et jusqu’à la fin de Charlotte. En raison des troubles déjà très remarqués par ses proches et ses médecins, Léopold II prend la décision et c’est la reine Marie-Henriette qui accompagne son retour au pays où on lui cache l’exécution de Maximilien en 1867 par les hommes de Benito Juarez. Elle séjournera successivement à Tervueren, Laeken, puis de nouveau à Tervueren, palais quitté après un incendie, avant de terminer sa vie au château de Bouchout. La période dite de délire épistolaire se situe en 1869.L’ouvrage d’André Bénit est d’une lecture passionnante et déborde de références autorisées. L’auteur est spécialiste des reconstitutions historiques, étudiant tout particulièrement l’interprétation que s’autorisent les écrivains. Il est par ailleurs l’auteur d’une thèse sur la présence de la Guerre d’Espagne dans les lettres belges francophones.…

Le cri du public. Culture populaire et chanson dialectale au pays de Liège (XVIIIe-XIXe siècles)
À propos du livre Que peuvent nous apprendre les prédictions de l' Almanach de Mathieu Laensbergh en matière d'éveil aux idées de Lumières, au XVIIIe siècle? Quel changement de mentalité à l'égard des pratiques magico-religieuses laissent entrevoir les commentaires du livret de pèlerinage à Saint-Hubert en Ardenne? C'est à de telles questions que tâchent de répondre les essais contenus dans le présent ouvrage, à partir d'une documentation associant littérature « populaire », journaux, catalogues de libraires, chansons, etc. La communication orale y trouve une place importante, notamment quand elle se fait dialectale. La diffusion de valeurs et d'interrogations communes s'opère aussi par le théâtre, où drames sérieux, vaudevilles et opéras-comiques nous sommes au pays de Grétry composent un véritable «paysage culturel» moyen. On verra ainsi comment le Laensbergh ou les mémoires rédigés à l'occasion de procès opposant des communautés rurales aux autorités manifestent le progrès du rationalisme critique, à travers un lexique où le bourgeois sensible côtoie l'aristocrate éclairé . De leur côté, les livrets de pèlerinage offrent une mutation du regard sur la «neuvaine» contre la rage, la protection sacrée cédant la place à la conception du contrat marchand et à l'hygiénisme. La réflexion sur l'«amélioration de l'espèce humaine», avec les questions de l'eugénisme, de l'alimentation des enfants et de la vaccination, entrent dans le débat qu'entretiennent le Journal encyclopédique et le Giornale enciclopedico di Liegi . Comment s'étonner de la vigueur avec laquelle les classes populaires verviétoises vont combattre l'ancien régime dans les années qui précèdent sa chute? Une figure d'exception domine intellectuellement et pratiquement l'événement : Nicolas Bassenge. La chanson «patriotique» donne la mesure de son charisme et de l'évolution que connaît celui-ci, quand se développera l'aspiration à une société pacifiée. Une même exigence de conciliation et de pragmatisme s'observe dans le traitement accordé au wallon sous un régime français moins jacobin qu'on ne l'a parfois dit. Y a-t-il continuité ou rupture entre le catalogue de la lecture à la fin du XVIIIe siècle et celui de l'époque romantique? Quelles nouveautés foncières se font jour, à côté d'une tradition persistante du livre «utile» visant désormais l'entrepreneur balzacien? Quelle réception pour un romantisme souvent jugé «dégoûtant»? Avec Georges Sand et les Vésuviennes de 1848, la revendication féministe fera irruption sur la scène locale, tandis qu'alterneront dans la chanson de conscrit complaintes de la fille-mère et gaietés de l'escadron, émaillées de…