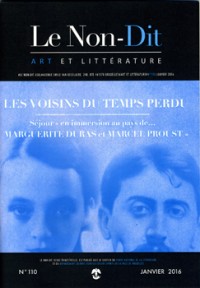
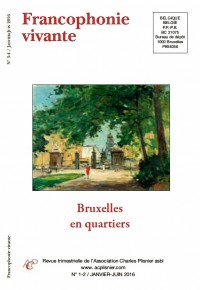
La vallée du Maelbeek à l’ombre de l’Europe
J’allais à l’école dans le cœur mal-aimé de la ville. Derrière le lycée, on construisait l’Europe, du moins son parlement. Autour de nous, c’était une vallée à laquelle il ne manquait que la rivière. On avait caché le Maelbeek, mais il se vengeait périodiquement dans les caves des maisons alentour. La seule chose qui coulait dans le quartier était le béton et le flot des voitures de la rue Belliard. À la marée haute des heures de pointe, elles allaient s’engluer dans les méandres de Jourdan et du bas de la chaussée de Wavre. Larguer les enfants tenait de la mission commando. En double, triple file, « Et surtout n’oublie pas ton cartable ! », je l’oubliais souvent. Le pire, c’était lors de la venue du cirque qui occupait le centre de la place. La place Jourdan était alors un petit quartier populaire résistant au milieu des grandes mutations de la ville. Pas d’hôtel de luxe pour la fermer, juste un terrain vague, masqué par quelques planches. Il servait de parking improvisé et il est arrivé que des professeurs s’enlisent à la mauvaise saison, qui, à Bruxelles, peut durer dix mois. Traverser la rue du Maelbeek provoquait toujours une appréhension dans ma tête d’enfant. Y avait-il vraiment, là-bas, en dessous de mes pieds, une rivière, un fleuve peut-être, avec ses berges, ses quais, ses bateaux, ses pêcheurs oubliés lors du grand recouvrement ? Tout un monde enfoui sous la surface. Bruxelles a réussi le miracle de faire marcher toute la journée ses habitants sur l’eau sans qu’ils le sachent et qu’ils en éprouvent le moindre vertige. Ce Maelbeek, je l’imaginais noir et méchant, un Styx de poche qu’il fallait traverser pour passer dans l’autre monde, celui de l’école. Il y avait juste à côté de l’entrée du parc Léopold une pissotière, d’un modèle plus qu’antique, unique dans la ville. On l’a fait murer à la demande d’un restaurant de poisson qui n’en pouvait plus de souffrir son odorante concurrence. Autour de la place s’organisait une petite vie, une petite ville au milieu de la grande : la vieille quincaillerie aux odeurs fanées, la pâtisserie Vatel ouverte toute la nuit, la friterie qui donnait chaud l’hiver rien que de la sentir et la couronne de cafés. Au long de mes études, j’ai vu lentement les cafés d’habitués se muer en brasseries, devenir restaurants ; ils seront bientôt lounge. En remontant , on trouvait la place Van Meyel et l’église rouge sang, deux fois trop grande, qu’un architecte avait tenté d’y faire entrer. Un matin, elle s’est effondrée. Il n’en est resté que les cloches. Une fuite d’eau dans le sous-sol, a-t-on dit. Un mauvais coup du Maelbeek ? Les habitants qui vivaient depuis toujours dans une demi obscurité, habitués aux tâtonnements des taupes, ont découvert soudain l’existence du soleil. Pour le rêve , il y avait le musée d’Histoire naturelle, le vieux musée dans lequel on entrait par les escaliers au fond du parc. Passé la porte, le visiteur était plongé dans un capharnaüm droit sorti de Jules Verne : animaux empaillés, squelettes amoncelés dans les lourdes vitrines et, par-dessus le tout, la cage aux dinosaures. On pouvait rester là, loin du monde, hors du temps. Le présent avançait pourtant et le monde changeait au-dehors. Sur la rue Belliard restait une poignée d’irréductibles, acharnés à ne pas lâcher le terrain, à ne pas se laisser ensevelir. C’était des maisons semi-abandonnées, les fantômes d’un ancien Bruxelles. L’avenue de Tervueren et ses hôtels particuliers avaient dû ruisseler par vagues et rejoindre la petite ceinture. Il en restait quelques gouttes tremblant sur le présent, des façades noircies par la pollution qui s’écaillaient, mal étançonnées, encerclées par les hautes parois de verre et de béton des bureaux en construction. Pour éviter les squats, on avait barricadé les portes et les fenêtres. Des squats, il y en avait vers les ponts du Maelbeek dans une maison éventrée. De leur train, les fonctionnaires en costume et cravate pouvaient voir les habitants et le linge tendu à des fils. Ils ne se cachaient pas. Toutes ces palissades et façades en jachère faisaient le bonheur des colleurs d’affiches sauvages. Elles s’empilaient de jour en jour, délavées par la pluie, déchirées par le vent, fondues l’une dans l’autre en un magma compact. Il en résultait d’étranges fresques urbaines où se mêlaient les bandelettes de vieilles campagnes électorales, les annonces de spectacles, les animaux perdus et les tracts de quelques groupuscules. Une sorte de journal intime de la ville. On pouvait mesurer les années d’abandon d’une maison à l’épaisseur de la croûte de papier collée sur ses murs. Il faut plaindre les promoteurs immobiliers bruxellois. Toutes ces bâtisses néo-classiques, hétéroclites, Horta ou simplement « eau et gaz aux étages » font preuve d’une résistance hors-norme. Des années de non-soins et des trésors de négligence sont nécessaires pour qu’enfin la maison vaincue reçoive son brevet d’irrécupérable. Il y en avait trois à l’époque, de l’autre côté du parc, avenue de la Renaissance, qui attendaient tout au bout de leur vie dans les soins palliatifs de l’urbanisme bruxellois. On a vaguement fini par sauver leur façade qu’on a plaquée sur des corps modernes si bien qu’elles ressemblent à des pastiches d’elles-mêmes, comme ces stars hollywoodiennes en bout de carrière. Ce qui désolait tous ceux qui avaient visité la ruine était la perte des vastes cheminées de marbre, hautes moulures, grandes verrières. Longtemps, le rond-point Montgomery a eu la gueule d’un fichu garnement dont une dent vient de tomber. On avait cassé une maison Art nouveau, il est resté un terrain vague. Puis, à force de procès d’entêtés archaïques, il a fallu reconstituer sa façade. En sera-t-il de même pour la Maison du Peuple ? Il paraît qu’elle attend en tas, improbable Lazare, au bord d’une voie de chemin de fer, sa résurrection. À l’angle de la rue Baron de Castro se dressait, sans doute agrandi par le souvenir d’enfance, un vrai petit palais avec ses frontons, ses colonnes, tout en sculptures et « pierres de France ». Il était l’orgueil de la haute bourgeoisie, les certitudes pétrifiées d’un siècle qui commence. Ce siècle, à son reflux, l’avait laissé mendiant, tendant dangereusement ses balcons vers les passants comme pour les supplier, agitant en vain ses volets arrachés, la toiture déversée sur le sol pour les apitoyer. Centre de l’Europe , qu’ils disaient ; et pourquoi pas du monde ? On marinait dans l’Histoire, on ne pouvait pas en sortir. Pour la promenade, les familles montaient au sommet de la vallée vers le Cinquantenaire. Passer sous l’arcade du centre, entre les ailes qui aspirent le vent, sous le drapeau furieux qui claque, suffit à vous convaincre de n’être pas héros. Mais peut-on rêver meilleur terrain de jeu que les canons du musée de l’armée en guise de toboggan ? Lorsque le musée de l’automobile fut créé, chaque mercredi, de nouvelles voitures arrivaient simplement rangées sur le parking au milieu des autres véhicules pour la plus grande joie des enfants. Ils se précipitaient, dès que la cloche avait sonné, pour les voir arriver au loin sur l’avenue. Les passions humaines se cachaient, elles, soigneusement au fond du parc derrière les buissons. Il était courant de voir des gens agenouillés, curieux de découvrir ce qui pouvait mériter l’enfer par le trou de la serrure. Lorsqu’il pleuvait , il était possible de se réfugier dans le musée d’Art et d’Histoire. On n’imaginerait plus le faire aujourd’hui. Il fut longtemps gratuit. L’entrée se faisait par le pavillon brûlé et il fallait passer sous un panneau comme on en voit dans les centrales électriques – tous les voyants étaient rouges ou presque. Il était possible de se promener sans croiser personne et même de se perdre dans les salles désertes et obscures au risque de tomber…

Exploration du langage de la bande dessinée. Rencontre avec Thierry Van Hasselt
Thierry Van Hasselt est auteur de bande dessinée, plasticien, scénographe, installateur, graphiste et professeur à Saint-Luc. Il est aussi l’un des membres fondateurs du Frémok, plateforme d’édition indépendante bruxello-bordelaise menée par un collectif et issue de la rencontre d’artistes passionnés. Depuis vingt-cinq ans, les livres publiés par le Frémok proposent une bande dessinée qui sort du cadre, repousse sans cesse ses frontières avec l’art plastique et la narration littéraire. * Que ce soit au niveau du format de ses livres (parfois très petits ou très grands, épais ou minces), par les techniques plastiques utilisées pour les réaliser, les sujets traités, le Frémok n’est jamais là où on l’attend. Formé dans les années nonante par un groupe d’étudiants en art réunis par des aspirations et projets communs, le Frémok, qui s’appelle alors Frigo Production, puis le Fréon, a commencé en créant des ouvrages faits maison, à la photocopieuse, en sérigraphie ou en gravure. De la microédition artisanale à tout petit tirage. Dès cette période, la conscience des moyens de production et la volonté de dépasser une qualité standard constituent la pierre angulaire de leur travail. Ultra-exigeant sur la qualité d’impression, le collectif investigue en particulier ce champ technique. Thierry Van Hasselt, un des membres les plus actifs du Frémok, y publie une œuvre singulière, qui commence avec la parution de Gloria Lopez. Dans ses albums de bande dessinée, on entre en immersion dans l’image, dans une narration tout sauf classique, on perd ses repères pour mieux se laisser happer. Il a récemment reçu le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée pour son ouvrage Vivre à Frandisco, réalisé avec l’artiste Marcel Schmitz, créateur d’une ville imaginaire. Thierry Van Hasselt, comment a commencé votre parcours dans la bande dessinée? J’ai aimé la bande dessinée très jeune et j’ai voulu très tôt en faire mon métier. Après une scolarité un peu douloureuse, j’ai commencé la bande dessinée à Saint-Luc à Bruxelles. Cela a été une période de découverte, de liberté et d’ouverture vers des univers dont je ne soupçonnais pas l’existence. Alors qu’au départ je m’intéressais à de la bande dessinée plutôt classique, j’ai découvert le travail de Lorenzo Mattotti, qui a provoqué en moi un déclic : il était possible de connecter la peinture, la grande littérature et la bande dessinée. Mattotti a été le passeur qui m’a permis d’autres découvertes comme celles de la bande dessinée espagnole, de la revue d’Art Spiegelman Raw, du travail d’Alex Barbier, de José Muñoz… J’ai ensuite rencontré le groupe Moka, constitué par des étudiants de Saint-Luc un peu plus âgés que moi, parmi lesquels il y avait Éric Lambé ou Alain Corbel, et qui avait créé une revue. Nous nous sommes au départ clairement inscrit dans la prolongation de ce groupe qui n’a pas duré mais dont nous avons récupéré l’énergie. Nous avons repris le flambeau en créant d’abord le groupe Frigo Production puis, après une restructuration du groupe, les éditions Fréon. Plus tard, nous avons rencontré les gens d’Amok à Paris et avons décidé de travailler ensemble, ce qui a donné naissance au Frémok. Nous investissons beaucoup dans la production et la fabrication. C’est notre terrain d’expérimentation. Nous travaillons de près avec un photograveur qui lui-même collabore étroitement avec un imprimeur. Notre manière de travailler est hors norme, nous utilisons une technique d’impression tout à fait nouvelle. Aujourd’hui, ce sont souvent les auteurs qui scannent leurs propres illustrations. Or, ils ne sont pas formés pour le faire. L’évangile doré de Jésus Triste (réalisé avec La « S ») a été imprimé avec deux noirs pour obtenir une saturation d’encre proche de celle de la linogravure. Le Frémok travaille avec La « S » Grand Atelier qui propose des ateliers de création pour des artistes mentalement déficients. Qu’est-ce qui vous a mené à collaborer sur des projets collectifs puis sur Frandisco? C’est Anne-Françoise Rouche, directrice de La « S », qui est venue vers nous. Ils organisent des résidences d’artistes dans le cadre de leur projet de mixités entre artistes mentalement déficients et artistes contemporains. Ils souhaitaient travailler dans le domaine de la bande dessinée, et le côté expérimental du Frémok, ses libertés par rapport aux normes de la bande dessinée canonique, leur ont donné envie de venir nous chercher. Après une première réaction de perplexité, car on s’interrogeait sur ce vers quoi cette collaboration allait nous mener, nous avons accepté. Cela nous motive toujours d’aller vers l’inconnu et là où on ne nous attend pas. Très vite, ce travail de collaboration s’est révélé être transformateur pour nous. Cela a en fait bouleversé nos pratiques de la bande dessinée, puis donné lieu à la création d’une plateforme d’édition commune, Knock Outsider, dédiée à l’art brut contemporain et à la recherche autour de cet art. En quoi cela a-t-il bouleversé les artistes du Frémok? Nous sommes des artistes plutôt cérébraux, avec une conscience théorique. Nous avançons dans une autoréflexion constante de nos pratiques. Nous nous sommes soudain confrontés à des artistes qui n’étaient pas dans cette intellectualisation du travail, mais plutôt dans une grande liberté par rapport au médium. Ce télescopage-là a amené une sorte de choc esthétique, puis une autorisation de partir dans des directions dans lesquelles, encombrés par notre théorie ou notre culture, nous ne serions pas allés seuls. Je pense notamment au projet que j’ai réalisé avec Marcel Schmitz : quand je travaille seul, le ton est beaucoup plus grave, avec un rapport au monde présentant plus d’angoisse, de pesanteur. Avec Marcel, je suis parti dans une espèce de jubilation, de joie de vivre, des choses beaucoup plus élémentaires, aussi bien dans la façon d’aborder le dessin que dans le sujet, qui est la découverte d’un monde heureux, ludique, même si une certaine gravité est aussi présente. Nous sommes heureux de travailler ensemble et c’est aussi ça que je raconte. Jamais je n’aurais pensé faire un travail dans l’optimisme, l’humour et la légèreté tout en posant des questions fondamentales et profondes. Je n’en reviens toujours pas, à vrai dire, d’avoir fait une telle bande dessinée. Parallèlement, je continue à travailler seul et c’est alors un travail beaucoup plus sombre, écorché. Votre style graphique évolue sans cesse. De Gloria Lopez à Vivre à Frandisco, votre technique diffère. Comment expliquez-vous cela? Je n’ai pas une mais plusieurs techniques de prédilection. Je me pose d’abord la question du sujet : de quoi est-ce que je veux parler ? Qu’est-ce que je veux convoquer dans un récit ? La technique suit. Je vais trouver un outil qui me permettra, de la façon la plus adéquate, d’en parler. Pour Gloria Lopez, qui traite de perception mentale et de flou de conscience, j’ai utilisé la technique du monotype, où l’image n’est jamais fixée et semble toujours pouvoir se diluer. Pour traiter cette question d’apparition/disparition du sujet, c’était la plus appropriée. Pour un autre de mes projets, lié à la danse, avec la chorégraphe Karine Ponties, qui parle de ces mouvements mentaux, j’ai utilisé la même technique, en continuité avec Gloria Lopez. Pour Vivre à Frandisco, qui traite de la ville, j’avais envie d’utiliser un outil d’architecte et de revenir à quelque chose de très simple. Je n’avais jamais travaillé au trait. C’était pour moi un très grand déplacement graphique et esthétique, mais qui correspondait bien au déplacement du sujet. Je suis donc parti sur cet outil que je n’avais qu’à peine expérimenté…