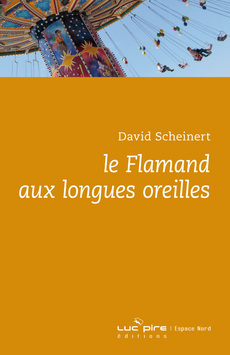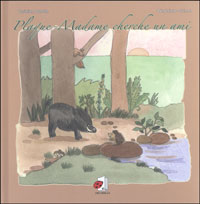ISBN 2-8032-0046-5 À propos du livre Quand, au milieu du XVIIe siècle, Arnauld d'Andilly fait paraître sa traduction des Vies des saints pères des déserts , il ne livre pas seulement un texte philologiquement sûr à la lecture édifiante des moniales et des reclus; il espère que les gens du monde y trouveront des exemples nombreux de sainteté pour en faire un instrument de leur conversion à Dieu. Bien d'autres livres, qui semblent à l'usage exclusif des conventuels, prétendent in fine excéder le lieu de leur diffusion professionnelle pour être lus dans le «monde». Et ils l'ont été. Cette performance du texte religieux de conversion et de retraite illustre un procès de rencontre entre deux univers, trop souvent tenus pour être quasi étanches et, pour le moins, opposés l'un à l'autre : le cloître et le «siècle». Centrée sur le XVlle siècle français, non sans puiser aux sources d'un passé parfois récent ou s'oser aux extrapolations pour les siècles suivants, la réflexion qui est ici présentée cherche à montrer que, si opposition il y a eu entre ces deux sphères des destinées humaines, la bipartition n'aura été aussi vive que par le fait de la similarité structurelle qui les fait trop semblables pour qu'elles ne s'opposent pas. Par l'ascèse, dont la diffusion se fait dans l'espace curial, qui commande aux nouveaux comportements légitimes et aux représentations dominantes de la société d'Ancien Régime, prennent forme un procès de domestication des pulsions, une éthique de la convergence du paraître social et de l'être psychologique, un fétichisme déréalisant qui porte sur les grâces royales de plus en plus symboliques, sur les petits riens de l'étiquette et sur une subordination de l'espace privé à une montre publique de soi. Ce protocole trouve son homologie déplacée dans l'espace du cloître : la césure de l'être avec son passé mondain, l'investissement dans les promesses divines de la rédemption, la transparence du coeur et de l'âme dans la promiscuité cénobitique, l'attention annihilante, voire mystique, aux moindres détails qui comptent plus que tout au regard de Dieu. De manière plus circonstancielle, les nouveaux modèles de l'éthique aristocratique ont puisé aux instructions anciennes des novices ; en retour, les prélats ou les supérieurs redéfinissent les Règles monastiques à partir des préceptes de la civilité aristocratique. Structurant un échange continu du fait de cette position inédite entre deux mondes, la manipulation des exemples édifiants formalise la congruence des modèles existentiels, tel saint Louis, mythifié pour exalter le fondateur spirituel de la monarchie, pour magnifier l'union des obligations séculières avec celles de la pénitence et pour cautionner la lutte contre les protestants. Parce que le recrutement monastique montre une surreprésentation des fractions sociales dominantes, s'expliquent l'imposition du modèle aristocratique dans les réformes monastiques du XVlle siècle et, plus sourdement, l'émergence d'un procès plus vaste où rétrospectivement se définira l'homme moderne l'individu dans son agir social et dans la représentation qu'il va intérioriser des usages licites et surtout sublimants où l'individu finira par se penser au-delà des…