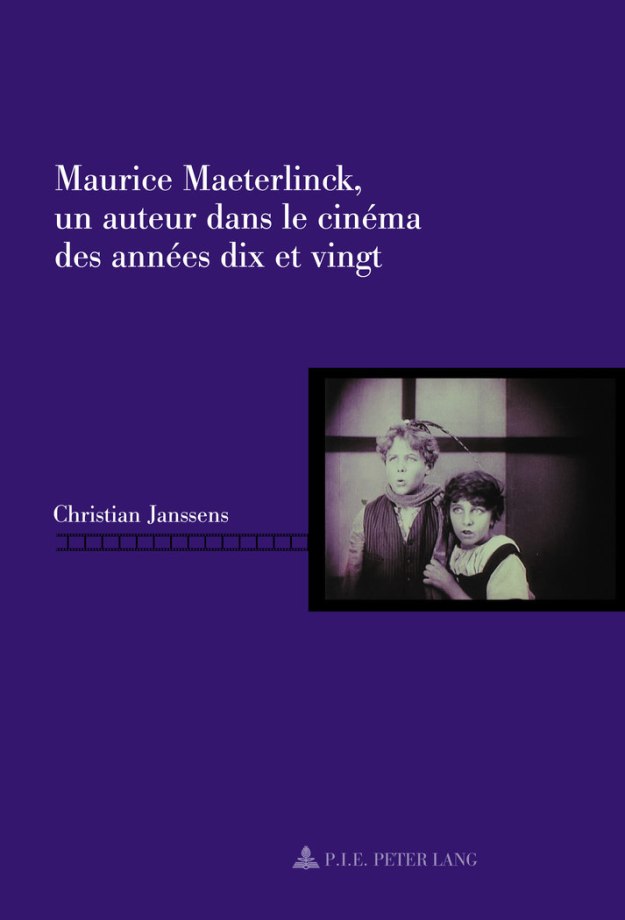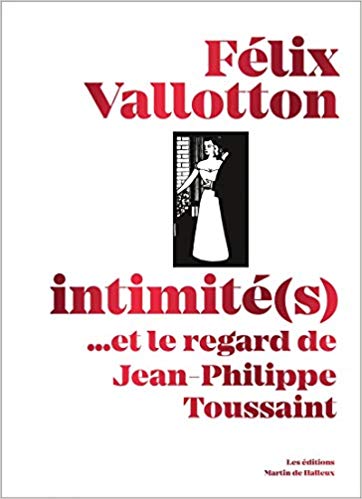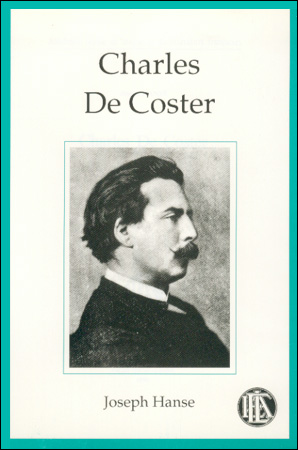Maeterlinck, l'arpenteur de l'invisible
RÉSUMÉ
Il est temps de corriger l’image en demi-teintes, assez falote, que l’histoire littéraire a véhiculée trop longtemps du dramaturge belge. Sous l’habit du bourgeois conservateur se cache l’iconoclaste qui fait voler en éclats le système de valeurs traditionnelles, sur lequel s’était fondée la grandeur de la dramaturgie issue de l’humanisme classique. À sa manière,…
DOCUMENT(S) ASSOCIÉ(S)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Paul Gorceix
Auteur de Maeterlinck, l'arpenteur de l'invisible
Né à Joigny dans l'Yonne, Berrichon par sa mère, Limousin par son père, Paul Gorceix entame en 1947 à l'Université de Potiers des études de langue et de littérature bientôt interrompues par la maladie. La tuberculose le cloue au lit durant deux ans, au cours desquels deux livres de chevet surtout le soulagent de ses peines : L'âme romantique et le rêve d'Albert Béguin et De Baudelaire au surréalisme de Marcel Raymond : ébauche d'une vocation?
Sa dernière année de licence, il la passe à Vienne, où il est assistant à l'Akademisches Gymnasium, tout en suivant les cours de Josef Nadler à l'université. Sa licence obtenue, il se retrouve assistant de français à Offenbach, près de Francfort. Rentré en France, il n'a de cesse de s'expatrier à nouveau. Il obtient un poste d'adjoint d'enseignement à Bône, actuellement Annaba, en Algérie. On est en 1954, au début de la guerre d'indépendance : il prépare dans ce climat le concours d'aptitude à l'enseignement secondaire, qu'il réussit, et lui vaut d'être affecté comme professeur adjoint dans un lycée strasbourgeois. L'Allemagne est proche : il obtient des Affaires Étrangères une nomination à l'Institut Français de Brême, puis un lectorat à l'université de Marbourg, jumelée avec celle de Poitiers, où il prépare un premier doctorat sur Ernst von Feuchtersleben, un ancêtre méconnu de la psychanalyse. Pour la thèse d'État, on lui suggère un sujet embrassant les lettres françaises et allemandes : le projet débouchera sur un ouvrage paru aux PUF en 1975 : Les affinités allemandes dans l'œuvre de Maurice Maeterlinck. Contribution à l'étude du Symbolisme français et du Romantisme allemand, qui lui vaudra le prix Strasbourg en 1976.
«Votre destin est scellé», lui dira Roland Beyen en l'accueillant à l'Académie. Dès la défense de sa thèse, il obtient la chaire de langue et de littérature allemandes à l'Université de Poitiers, et l'habilitation à la défense de thèses de maîtrise en littérature française de Belgique. Il développera ce deuxième volet lorsqu'en 1991 il sera nommé professeur à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux.
«Depuis 1967», année où il a déposé son sujet de thèse sur Maeterlinck, «votre engagement pour la littérature française de Belgique aura été total» , poursuivra Roland Beyen. Effort qui sera couronné, en 1999, par le Prix du rayonnement des lettres françaises de Belgique à l'étranger. Médiateur, Gorceix l'est à l'image de Maeterlinck, qui devait son rôle d'intercesseur entre le romantisme allemand et le mouvement symboliste français à sa situation de Flamand de langue française au carrefour de l'Europe. Elle permettait «d'aller de la pensée du mystique médiéval (Ruysbroeck) au mouvement symboliste», en particulier en Belgique bien sûr, mais aussi d'être profondément sensible à l'œuvre de Novalis. Gorceix a étudié avec passion ces interactions, recherches qu'il a déployées dans quelque vingt-cinq livres, maints articles et recensions.
On lui doit notamment la réédition des poèmes de Maeterlinck et d'Elskamp dans la collection «Poésie» chez Gallimard, et le rassemblement des textes fondamentaux de La Belgique fin de siècle en deux forts volumes chez Complexe, ainsi qu'en trois tomes chez le même éditeur un gigantesque ensemble d'œuvres de Maeterlinck, ce «visionnaire du dedans», selon la belle expression dont Gorceix le désigne, cet «arpenteur de l'invisible» comme il l'appelle au fronton de l'ouvrage de synthèse essentiel qu'il lui a consacré aux éditions de l'Académie.
Paul Gorceix est décédé à Pujols (Gironde) le 17 novembre 2007.