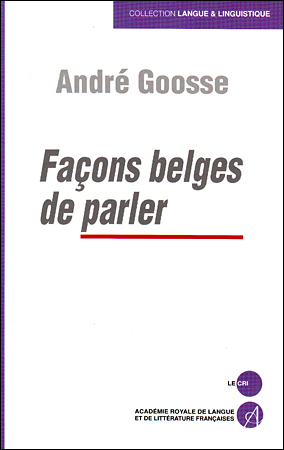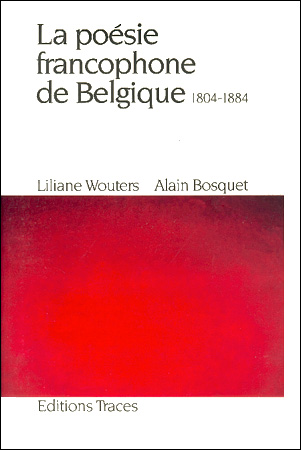Médecinaire liégeois du XIIIe siècle et médecinaire namurois du XVe (manuscrits 815 et 2769 de Darmstadt)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Haust
Auteur de Médecinaire liégeois du XIIIe siècle et médecinaire namurois du XVe (manuscrits 815 et 2769 de Darmstadt)
Jean Haust est né à Verviers le 10 février 1868. Bien que de milieu modeste, et malgré la mort prématurée de son père, il peut, après ses études secondaires au collège des Jésuites de sa ville, entreprendre, en 1885, des études supérieures à l'École normale des humanités (annexée à l'Université de Liège). Il y obtient, en 1889, le titre d'agrégé en philologie classique, avec grande distinction. Dès 1892, après quelques intérims, il est nommé à l'Athénée de Liège, et il y enseignera le latin jusqu'en 1921, année où il en sera détaché pour une mission scientifique dont l'objet est l'étude des dialectes de Wallonie. En 1920 déjà, le ministre Jules Destrée l'a chargé de faire à l'Université de Liège le premier cours (facultatif) d'étude philologique des dialectes wallons, mais ce n'est qu'en 1932, à l'âge de soixante-quatre ans, qu'il y est nommé professeur ordinaire.
Ainsi, son œuvre scientifique, pourtant très importante, s'est réalisée, pour l'essentiel, en dehors du milieu universitaire, avant sa nomination et après son accession à l'éméritat, et tout entière dans un domaine auquel ne le destinaient ni sa formation ni sa carrière, mais où l'entraîna un goût précoce et de plus en plus accusé.
Sa première étude, qui paraît en 1892 dans les Mélanges wallons offerts à Maurice Wilmotte, vise à caractériser Les parlers du nord et du sud-est de la province de Liège. Si elle est centrée sur la phonétique et la morphologie, domaines auxquels il préférera par la suite le lexique, elle inaugure une démarche à laquelle il restera fidèle jusqu'à la fin : l'enquête de terrain, qui fournit une documentation sûre, abondante, inédite.
Pendant plus de cinquante ans, ses activités ont comme pôles diverses sociétés savantes, au premier rang desquelles la Société liégeoise de littérature wallonne (aujourd'hui Société de langue et de littérature wallonnes). Il y est élu en 1897, et il y déploie une grande activité, comme secrétaire, de 1901 à 1927, rompant alors définitivement, à la suite de mésententes. Cette période a été faste pour la Société, puisqu'elle vit paraître plus de cinquante publications de grand intérêt; mais pour Haust aussi, à qui ce travail obscur et souvent ingrat d'éditeur a permis de faire, comme il l'aime, son apprentissage sur le vif et dans le concret. Il rédige de nombreux rapports, conseille des auteurs de glossaires et de toponymies, établit des index, collabore au Dictionnaire général de la langue wallonne.
Convaincu de la nécessité d'étudier en même temps que les mots les réalités qu'ils désignent, il contribue à la création, en 1913, du Musée de la vie wallonne, où il jouera pendant longtemps un rôle capital.
L'étymologie a toujours passionné Jean Haust. À partir de 1906, il multiplie dans les revues des notes de ce type. Jointes à d'autres, inédites, elles formeront en 1923 le livre Étymologies wallonnes et françaises (prix Volney de l'Institut de France).
Ses mérites sont également reconnus en Belgique, puisque le 18 août 1920, sur proposition de Jules Destrée, il est désigné par le roi pour faire partie de l'Académie royale de langue et de littérature françaises qui vient d'être créée. Il y publiera deux œuvres importantes : en 1937, une étude sur Le toponyme ardennais fa (fè, fwè), en 1941, l'édition critique d'un Médicinaire liégeois du XIIIe siècle et d'un Médicinaire namurois du XVe siècle.
Dès leur création, il fera partie également de la Commission royale de toponymie et dialectologie (1926) et de la Commission communale de l'histoire de l'ancien pays de Liège (1929). Dans ces deux sociétés savantes, il manifestera, comme partout ailleurs, une grande activité, rédigeant notamment, dans le bulletin de la première, une chronique bibliographique annuelle, dans l'annuaire de la seconde, des gloses explicatives et étymologiques de termes et de toponymes anciens.
Depuis 1921, détaché pour mission scientifique, il a mis en train son projet le plus ambitieux, une vaste enquête dialectale destinée à l'élaboration d'un atlas linguistique de la Wallonie, inspiré de l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron, et fondé sur un questionnaire d'environ deux mille questions. Si la mort l'empêcha de mener ce travail à son terme, il eut néanmoins la satisfaction de publier lui-même quelques cartes provisoires, mais ce n'est qu'à partir de 1953 que, les travaux préparatoires clôturés, cette ouvre monumentale commença à paraître. En 1995, sur les vingt volumes prévus, sept ont été publiés, cinq autres sont en préparation.
Malgré le temps que requérait une entreprise d'une telle ampleur, les vingt dernières années de sa vie ont été d'une fécondité étonnante. Sans parler de ses articles, non seulement il réalise ses grands ouvrages lexicologiques : La houillerie liégeoise (1925-1926), riche glossaire d'un métier traditionnel extrêmement original, et son chef-d'œ.uvre, le triptyque consacré au dialecte wallon de Liège – Dictionnaire des rimes (1927), Dictionnaire liégeois (1929-1933), Dictionnaire français-liégeois (posthume, 1948) –, que consacra, en 1938, le Prix de la langue française et auquel la faveur du public valut plusieurs rééditions. Mais encore, dans la collection Nos dialectes, qu'il crée en 1933, il donne, avec constance et régularité, une douzaine d'éditions critiques d'œuvres littéraires anciennes (Quatre dialogues de paysans; Dix pièces en vers sur les femmes et le mariage…) et modernes (E. Remouchamps, J. Calozet, L. Henrard). Il enrichit les mémoires de la Commission de toponymie et dialectologie d'une intéressante Enquête dialectale sur la toponymie wallonne (1940-1941).
Jean Haust est mort le 24 novembre 1946.