
« Sonar », film de Jean-Philippe Martin. Les oreilles du coeur.
Pour son premier long-métrage de fiction, Jean-Philippe Martin plonge dans l'univers du son et élabore une enquête amoureuse têtue où la recherche de la vérité évoluera au fil des rencontres et des confrontations. Sonar Ingénieur du son en déprime, Thomas, trentenaire, vit reclus dans le studio d'enregistrement de son patron, mais néanmoins ami. Suite à l'échec d'une liaison amoureuse, il a délaissé sa passion – réaliser des portraits sonores – et se contente de vivoter grâce à des boulots alimentaires et sans intérêt. Sa rencontre avec Amina sur une aire d'autoroute va le bousculer et l'obliger à prendre sa vie en main et à s'ouvrir au monde. Thomas accepte de la loger quelque temps et découvre que cette femme lumineuse et en colère cache une histoire douloureuse. Fasciné, Thomas se sent de plus en plus happé par ce mystérieux personnage et retrouve en elle une envie de création. Suite à une violente dispute, Amina disparaît. De plus en plus obsédé, Thomas décide de partir à sa recherche À la fois road-movie intérieur et physique, « Sonar » est avant tout l'ouverture progressive au monde et à la vie d'un homme égaré, enfermé dans son marasme et sa difficulté d'être. Judicieusement, le cinéaste traduit plastiquement cette évolution par une utilisation réussie de la profondeur de champ, de l'évolution du cadrage et de la lumière. Enfermé dans son studio d'enregistrement, Thomas l'est aussi par un cadre serré et une profondeur de champ réduite, l'entourant d'un flou systématique, rupture d'avec le monde. La fuite d'Amina l'oblige à sortir, à réécouter son environnement et à reprendre contact avec les autres. Malgré l'interprétation très effacée de Baptiste Sornin et certaines longueurs, le cinéaste parvient à rendre compte de cet élan. Caché derrière son casque et son micro, Thomas va réapprendre le monde par les sons et les rencontres successives pour chercher Amina. Des cités de banlieue grisâtres au Maroc solarisé, ses déambulations le conduiront aussi à s'exposer et à n'être plus uniquement dans l'enregistrement. Ainsi, le cadre s'élargit pour s'ouvrir complètement lors de la séquence magnifique, chez les parents d'Amina, hors du temps et fondatrice dans la mue de Thomas. Apprentissage Cet apprentissage de l'extérieur et de la lumière est doublé subtilement par une réflexion sur comment les individus se construisent ou se réinventent pour échapper à une société, une culture, une norme qui les contraint et les emprisonne. Portée par sa volonté de liberté et d'entièreté, Amina est d'abord un personnage-objet, objet de fantasme pour Thomas, tant amoureux qu'artistique (il veut réaliser un portrait d'elle), objet de rumeurs assassines de la part de ceux et celles qui la connaissent de loin et objet de ressentiment de la part de sa famille. Le mensonge lui permettra de survivre et de devenir sujet de sa propre vie, superbe paradoxe. Enfin, sa confrontation ardente avec Thomas lui permettra d'exister comme son égale, chacun.e ayant trouvé dans l'autre un apaisement et une possibilité d'être soi sans mentir. © Fred Arends, 2017…
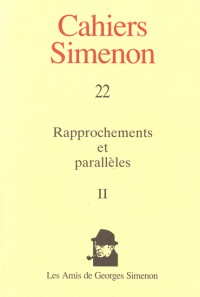
Georges Simenon et Jean Cocteau, une amitié jouant à cache-cache
Personne n’ignore que Georges Simenon , presque toute son existence durant, est resté en marge des milieux littéraires et même, d’une manière plus générale, des milieux qualifiés d’intellectuels, bien que quelques-uns de ses amis s’appellent Marcel Achard, Marcel Pagnol, Jean Renoir, Francis Carco, Maurice Garçon, Henry Miller ou encore, après le XIIIe festival de Cannes dont il a été le président du jury en 1960, Federico Fellini. Personne n’ignore non plus qu’en raison de cette attitude, sans doute prise à contrecœur mais de plein gré, l’institution littéraire a mis de longues années avant de se pencher sérieusement sur l’œuvre immense de l’écrivain liégeois. Avec les multiples manifestations commémorant en 2003 le centenaire de sa naissance, la parution de nombreux ouvrages critiques et biographiques ainsi que l’édition de vingt et un de ses romans dans deux copieux volumes de la « Bibliothèque de la Pléiade », ce temps n’est plus – et tout se passe désormais comme si Simenon était un classique primordial de la littérature du XXe siècle. À cet égard, le consensus dont il fait aujourd’hui l’objet dans les médias est des plus révélateurs. Il y a quelques années encore, il aurait été inimaginable. Je viens de mentionner Marcel Achard, Marcel Pagnol, Jean Renoir, Francis Carco, Maurice Garçon, Henry Miller et Federico Fellini parmi les relations les plus célèbres de Simenon, je devrais ajouter Jean Cocteau. Les deux hommes se sont connus au début des années 1920, après que Simenon s’est installé en France avec sa jeune femme, Régine Renchon. Dans sa dictée Vent du nord, vent du sud (1976), Simenon consacre quelques pages à la vie parisienne de l’époque et, en particulier, à Montparnasse en train de devenir « le centre du monde » avec, précise-t-il, « ses artistes venus des quatre coins d’Europe et même des États-Unis ». Il y est question, pêle-mêle, de la mode à la garçonne 1 , sur le modèle du best-seller de Victor Margueritte, du charleston, du black-bottom, du fox-trot, de gigolos professionnels, du Café du Dôme, de La Boule blanche, de La Coupole « qui était alors aussi peu bourgeois que possible 2 », du Jockey « où l’on pouvait à peine remuer les jambes tant on était pressés les uns contre les autres »... « Le cabaret le plus moderne, rapporte Simenon, s’appelait Le Bœuf sur le toit et on y rencontrait Cocteau avec son inséparable Radiguet 3 ... » Que le futur auteur des Maigret ait fait la connaissance du futur cinéaste du Sang d’un poète dans le Paris insoucieux des années 1920 et, selon toute probabilité, dans ce fameux cabaret immortalisé par l’entraînante musique de Darius Milhaud, rue Boissy-d’Anglas, cela semble une certitude. Il paraît assez improbable en revanche que Simenon y ait rencontré Cocteau en compagnie de Radiguet, vu que ce dernier est mort en décembre 1923 et qu’en 1923, justement, Simenon se trouvait le plus souvent à Paray-le-Frésil dans l’Allier, exerçant les fonctions de secrétaire auprès du marquis Raymond d’Estutt de Tracy, riche propriétaire, entre autres, de maisons et de châteaux, de vignobles et du journal nivernais Paris-Centre. En réalité, ce n’est qu’à partir de mars 1924 que les Simenon vont bel et bien se mêler de près à la vie parisienne – lui, le petit Sim, se mettant à écrire sans relâche des contes légers et des romans populaires sous une quinzaine de pseudonymes ; elle Régine, affectueusement surnommée Tigy, n’arrêtant pas de dessiner, de peindre et de fréquenter le milieu des artistes, à Montmartre et à Montparnasse : Kisling, Foujita, Soutine, Vlaminck, Colin, Derain, Vertès, Van Dongen, les dadaïstes puis les premiers surréalistes... Le Georges Simenon d’alors n’a pas grand-chose à voir avec l’homme comblé et fortuné dont l’image s’est répandue dans le grand public après la Seconde Guerre mondiale (et que Simenon lui-même, sans conteste, a contribué à répandre), rien à voir avec le gentleman farmer comme retranché dans les campagnes du Connecticut, le châtelain d’Échandens sur les hauteurs de Lausanne, le maître de la forteresse d’Épalinges, le romancier de langue française le plus traduit sur les cinq continents et le plus choyé par les cinéastes 4 . C’est une sorte de bellâtre de vingt et un ans à peine, un tantinet hâbleur, bravache et frivole – et comme au Café du Dôme, à La Boule blanche ou, sur la rive droite, au Bœuf sur le toit, on ne sait trop à quoi il occupe ses journées ni comment il parvient à subvenir à ses besoins, on ne voit en lui que le beau chevalier servant de Madame Tigy, artiste peintre 5 ... Il suffit du reste d’examiner les différentes photos réalisées à l’époque pour s’en convaincre : sur la plupart d’entre elles, Simenon est tout sourire, l’air de n’avoir aucun état d’âme ou l’air de fomenter un innocent canular. Autant dire que ce Simenon-là est le type même du mondain. Si ce n’est, pour utiliser une expression plus prosaïque, le type même du joyeux fêtard. Tigy en est parfaitement consciente et quand, en octobre ou en novembre 1925, son bonhomme de mari et l’ardente, l’impétueuse, Joséphine Baker s’éprennent l’un de l’autre, elle ne peut hélas que se résigner. Et voilà donc qu’entre lui et Cocteau se nouent des relations amicales – et elles sont d’autant plus franches que Cocteau adore, lui aussi, les mondanités et se comporte très volontiers, au cours de ces années 1920, comme un prince frivole. Et de là à ce que ses écrits soient de la même manière taxés de frivoles... « La frivolité caractérise toute son œuvre, remarque ainsi le toujours pertinent Pascal Pia, dans un article sur les débuts du poète. Même quand il se donne des airs de gravité, même quand il se prétend abîmé de douleur, ses accents restent ceux d’un enfant gâté, qui agace plus qu’il n’apitoie. On ne saurait l’imaginer en proie à un chagrin dont il eût négligé la mise en scène 6 . » Dans ses livres autobiographiques – un gigantesque corpus de vingt-cinq volumes –, Simenon cite une quinzaine de fois le nom de Cocteau. Ce n’est pas rien, quoique l’écrivain français récoltant le plus de références directes soit André Gide avec lequel, on le sait, Simenon a longtemps correspondu mais qui n’a jamais été un de ses amis, au sens où on entend d’ordinaire ce terme 7 . À quelques exceptions près, les évocations de Cocteau sont toutes fort anecdotiques et, en général, assez convenues et des plus aimables, notamment pour dire qu’ils se voyaient fréquemment à Cannes, au bar du Carlton ou ailleurs, à l’époque des festivals, quand ils séjournaient tous les deux à la Côte d’Azur, Simenon après son retour des États-Unis, en 1955, et Cocteau chez Francine et Alec Weisweiller (villa Santo-Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat 8 ). C’est du genre « mon vieil ami » – une formule qui revient souvent dans sa bouche et à laquelle il a pareillement recours presque toutes les fois qu’il parle par exemple de Fellini, de Pagnol ou encore de Chaplin. Voire de n’importe quel illustre personnage. Mais, entre deux observations anodines ou entre deux menus propos à bâtons rompus, on relève de loin en loin des phrases qui ne manquent pas d’intérêt. Dans La Main dans la main (1978), Simenon constate ainsi à quel point certains hommes célèbres racontent toujours les mêmes histoires avec, dit-il, « la même intonation de voix » et « les mêmes gestes ». Et après avoir fait allusion à Sacha Guitry répétant « à l’infini » plus ou moins les mêmes blagues à ses interlocuteurs, il enchaîne sur cette confidence, un peu dans le registre de la remarque piquante de Pascal Pia : « Un autre, dont je crois que je peux parler aussi et que j’ai connu pendant de longues années, qui passait pour un enfant espiègle lançant des feux d’artifice, Jean Cocteau, m’avouait qu’avant d’aller dans le monde, comme on disait…
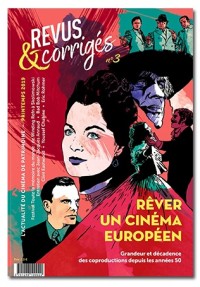
Trilogie bordelaise (3). Une ode au cinéma de patrimoine
Notre rédacteur continue son exploration bordelaise en passant par la célèbre librairie Mollat et en nous faisant découvrir une revue de cinéma de patrimoine lancée en 2018. * Bordeaux est une ville qui aime les livres et ceux qui les aiment. De nombreuses bouquineries parsèment ses rues, des plus généralistes aux plus spécialisées. Les amateurs pourront fouiller dans les rayonnages du Quai des Livres, de la Bouquinerie Plus ou de celle d’Alain Guillaume, ou encore aller se perdre dans la Nuit des Rois (a qui va, largement, ma préférence). Et puis, il y a la librairie Mollat. Difficile de la manquer: ses multiples vitrines, rue Vital Carles et rue de la Porte Dijeaux, affichent fièrement ses bannières, couleur bleu roi. Celui qui se risque dans ses rayonnages est vite gagné par le tournis : des livres, par milliers, par dizaines de milliers ; sur les murs, jusqu’au plafond, sur des dizaines et des dizaines de tables et de présentoirs. Les salles s’enfilent et l’impression d’être dans une bibliothèque et non dans une boutique s’impose peu à peu. Des échelles coulissantes parsèment les étagères ; la littérature francophone occupe l’espace d’une librairie classique ; les salles spécialisées (en cinéma par exemple) fourmillent de titres inconnus en Belgique. Chez Mollat, l’actualité et l’histoire fusionnent sur un modèle total. Ce gigantisme peut effrayer. Mais on se rend vite compte que l’atmosphère y est infiniment plus respirable que dans d’autres supermarchés du livre dont les noms n’ont pas besoin d’être mentionnés. Physiquement, d’abord, la hauteur des plafonds, la largeur des vitrines et la scénographie librairiste ne privent jamais d’air la visiteuse. Philosophiquement ensuite, on ne retrouve pas chez Mollat cette inflation du goodies et de rayons opportunistes ; ni snack planté au milieu de la librairie, ni ersatz de cave à vin offert aux CSP++ censés constituer la principale cible du marché de l’imprimé. Immense, Mollat l’est par son obsession pour l’objet du livre, comme si la librairie pensait pouvoir, réellement, réunir en un seul lieu toute la littérature couchée sur papier. * C’est dans cette antre fantastique que je suis tombé par hasard sur Revus et corrigés, revue dont j’ignorais l’existence. Lancée en 2018 suite à un financement participatif réussi (20.000 euros récoltés sur 15.000 euros initialement demandés), elle s’est donnée pour mission de couvrir l’actualité et la non-actualité du cinéma de patrimoine. Les restaurations bien sûr mais aussi le destin des fonds cinématographiques ou encore l’histoire du cinéma, entendue comme une relation du présent au passé et pas une simple description factuelle du dit passé. Riche, jusqu’à présent, de trois numéros de 150 pages, elle va renaître dans une nouvelle formule de 200 pages le 12 juin. Que trouvait-on dans son numéro 3, Printemps 2019? D’abord un grand dossier sur le thème de « Rêver un cinéma européen ». Passionnant, il décrit le système de co-productions européennes à ces différents stades de développement – passant par des époques où les acteurs stars atteignaient le sommet de leur carrière en jouant dans de grands castings transcontinentaux et par d’autres où les « europudding » sacrifiaient toute cohérence artistique à la volonté de plaire à tous les publics européens. L’analyse des journalistes et la parole des interviewés (comme Jean-Jacques Annaud) sont intéressantes parce que loin de s’inscrire dans une vision idéalisée d’une construction culturelle européenne, elles révèlent surtout les différentes manières de protéger (ou non) les scènes nationales. Et cela sans pour autant verser dans un repli identitaire – l’exemple le plus frappant étant celui de la France, qui pratique l’exception culturelle mais qui investit sans retenue dans la co-production internationale (bien au-delà des frontières de l’Union Européenne) et en est même devenue l’un des acteurs centraux. On trouve aussi, dans ce numéro, une couverture du festival « Toute la mémoire du monde », organisé à Paris autour… du cinéma de patrimoine. Succès public, le festival avait fait le choix du grand écart entre la modernité, avec l’invitation du réalisateur Nicolas Winding Refn pour évoquer sa plateforme de VOD gratuite ByNWR, et le retour aux sources avec une rétrospective sur le cinéaste Jerzy Skolimowski, cheville ouvrière du Nouveau cinéma polonais. Notes de festival et interviews donnent l’eau à la bouche sans jamais sombrer dans l’ésotérisme cinéphilique. C’est d’ailleurs la grande force de Revus et corrigés : transmettre sans élitisme la passion du patrimoine. Les différentes critiques, sur des films connus comme Requiem pour un massacre d’Elem Klimov ou Mort à Venise de Luchino Visconti ou plus obscures comme L’Aiguille du kazakh Nougmanov (1988), permettent à la lectrice de construire sa culture cinéphilique au grès de ses intérêts et curiosités. Grands classiques et trésors inconnus sont présentés sans préjugé. Les néophytes y trouveront foison de films à voir et les cinéphiles confirmés des analyses et des découvertes surprenantes. On regrettera l’impression de lire, parfois, un catalogue des éditeurs de support physique dont les publicités s’affichent presque à côté des articles consacrés aux films marketés. De la même manière, comme le patrimoine est à la base une affaire de sélection, les critiques sont ultra-majoritairement positives… l’éternel problème de la promotion. On se consolera avec les interviews au ton plus libéré et parfois critique, justement, sur le passé. Pour peu qu’on s’intéresse un peu au cinéma, Revus et corrigés remplit parfaitement son office. L’avenir dira si sa nouvelle formule, plus longue et un peu plus chère (14€ pour 200 pages), continuera dans le même sillon. Félicitations en tout cas à l’équipe de la revue, qui est parvenue à créer un média « grand public » (disons, pour tous les cinéphiles) sans sacrifier la critique proprement dite. Revus et corrigés n°3, printemps 2019, 150 pages © Thibaut Scohier, revue en ligne Karoo,…