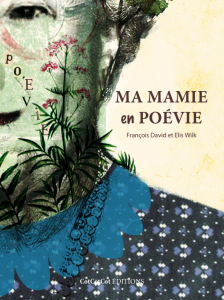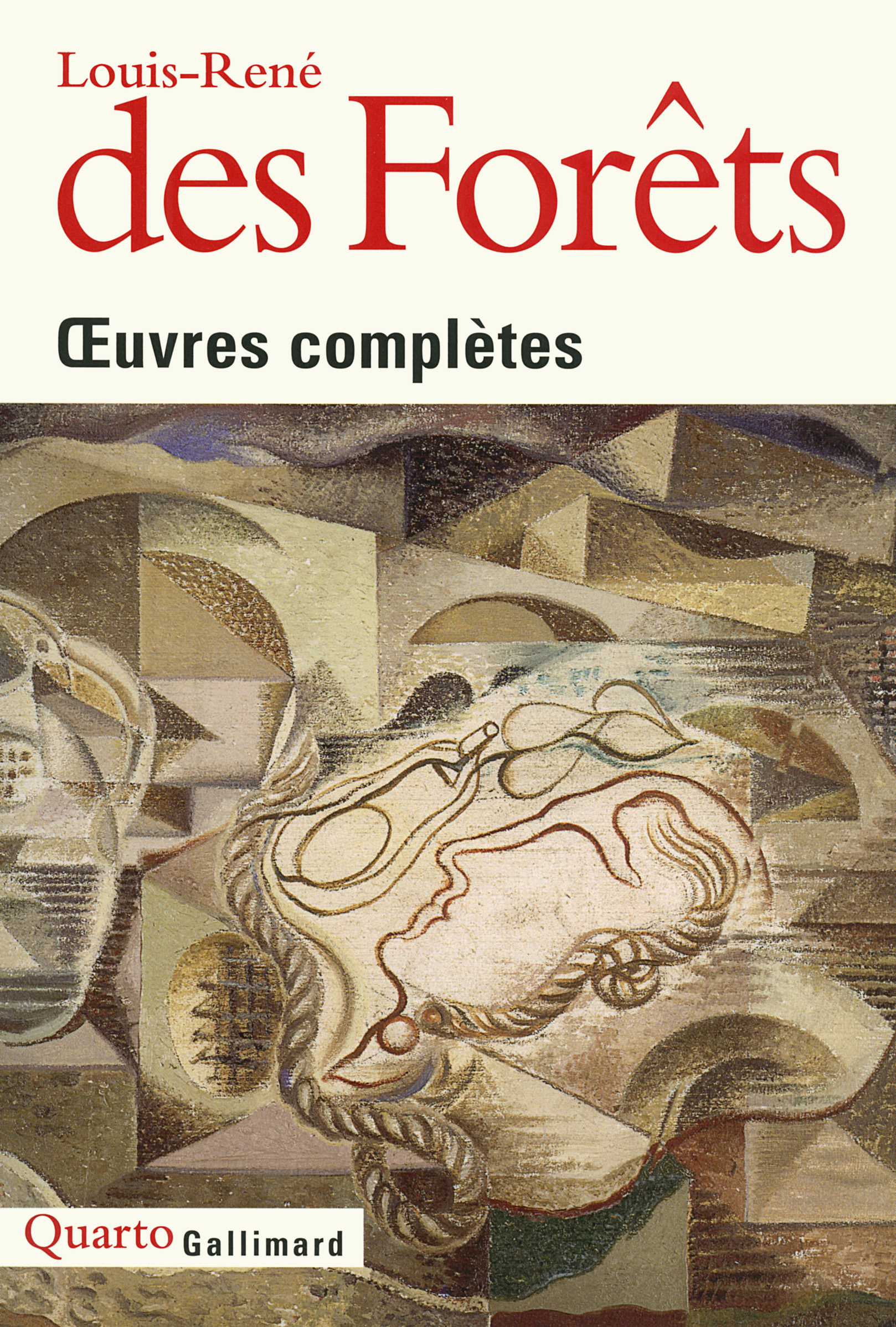Plaisirs
À PROPOS DE L'AUTEUR
Dominique Rolin
Auteur de Plaisirs
Dominique Rolin naît à Bruxelles, rue Saint-Georges, le 22 mai 1913. Fils d'un magistrat belge, son père, Jean Rolin, est directeur de la Bibliothèque du ministère de la Justice. Sa mère, fille de l'écrivain naturaliste français Léon Cladel, est professeur de diction. Rapidement ce couple s'avère aussi invivable que remarquable, sombrant dans une violence dont l'œuvre de la fille aînée explorera, avec passion et rigueur, les soubassements et les effets. Cette saisie du drame familial par éclairages successifs et variés est déjà au cœur tant des premiers récits, publiés dans Le Flambeau et Cassandre, que d'un roman refusé par Gallimard en 1939 et détruit ensuite par la romancière. C'est en 1942, au plus sombre de la guerre et en plein enfer privé que Dominique Rolin produit son premier chef-d'œuvre, salué avec ferveur par Max Jacob et Jean Cocteau. Publié par Denoël, roman à la fois onirique et d'une précision cruelle, Les Marais invente un lieu (une maison à l'orée de la forêt) et un groupe familial déchiré, éléments qui feront l'objet d'un étrange étoilement à travers les trente-sept volumes que Dominique Rolin a signés jusqu'à ce jour.
En 1946, elle quitte la Belgique et s'installe définitivement en France. Elle collabore en tant qu'illustratrice aux Nouvelles littéraires à Paris, où elle rencontre le dessinateur et sculpteur Bernard Milleret qu'elle épouse en 1955. Milleret meurt le 12 mars 1957. Ce choc produira, trois ans plus tard, un superbe roman : Le Lit, porté à l'écran en 1982 par la réalisatrice Marion Hänsel. En 1958, elle est élue membre du jury du prix Fémina et rencontre l'écrivain qui, dans ses romans futurs, s'appellera Jim. histoire de cette relation exceptionnelle sera racontée, avec force et délicatesse, dans Trente ans d'amour fou (1988) et dans Le Jardin d'agrément (1994). Son engagement aux côtés des protagonistes du Nouveau Roman, à partir des années soixante, est à l'origine de sa révolte contre le caractère sclérosé du prix Fémina. Une vive polémique dans la presse aboutira à son exclusion, en 1964, ce qui ne l'empêchera pas, par la suite, de devenir membre d'autres jurys littéraires prestigieux (le prix Valery Larbaud, le prix Rossel). Le 11 juin 1988, Dominique Rolin est élue à l'Académie royale de langue et de littérature françaises où elle succède à Marguerite Yourcenar.
Souvent déconcertante, mais d'une cohérence exemplaire, l'œuvre romanesque de Dominique Rolin connaît quatre phases essentielles. La première, qui va des Marais jusqu'aux Deux sœurs (1946), nous présente des romans dans lesquels s'opère une transposition romantique du drame familial : le décor est nordique, la perplexité flamboyante et les noms des personnages ont tous une résonance germanique sinon flamande; ensuite, après le départ à Paris, le ton change : un réalisme apparemment plus français prédomine, les personnages de L'Ombre suit le corps, Souffle (1952, prix Fémina) ou d'Artémis portent des noms qui n'ont plus rien d'exotique, leur milieu social varie, mais le noyau familial et ses radiations restent souvent les mêmes. Dans la période cruciale qui suit 1960, marquée par le bouleversement de la conception et de la technique romanesques sous l'influence des expériences en cours à Paris (Tel Quel et le Nouveau Roman), Dominique Rolin retrouve sa mémoire propre, tout en la fragmentant au fil d'une écriture constamment présente à elle-même (La Maison la forêt, Maintenant, Le Corps, Les Éclairs…), allant ainsi jusqu'à inscrire son nom et celui des siens dans la texture même de ces magnifiques romans d'avant-naissance et d'outre-tombe que sont L'Infini chez soi (1980), Le Gâteau des morts (1982) et La Voyageuse (1984).
Ayant de ce fait subverti le pacte autobiographique traditionnel, Dominique Rolin poursuit un voyage romanesque très singulier au cours duquel des fictions vraies (tels Trente ans d'amour fou ou Le Jardin d'agrément) redistribuent et transfigurent à nouveau les récits de sa mémoire, en les mêlant à des versions imagées, possibles. Pareille stratégie permet à la romancière de s'éloigner quelquefois du registre autobiographique (L'Enfant-roi, Vingt chambres d'hôtel), d'écrire de superbes essais (Un convoi d'or dans le vacarme du temps), de noter ses rêves avec une étonnante franchise (Train de rêves) ou d'inventer un somptueux monologue intérieur du peintre Pieter Breughel récapitulant sa vie et ses combats d'artiste (L'Enragé). Il convient d'ailleurs de souligner le rôle primordial joué par la peinture, principalement vénitienne et flamande, dans cet univers romanesque. Au cœur de plusieurs textes, des tableaux de Guardi, de Van der Weyden ou de Vermeer déclenchent des mises en scène très particulières d'un amalgame de souvenirs et de projections. Enfin, la superposition d'un chef-d'œuvre de Breughel et de la mort du père de la romancière a produit un des livres les plus forts de Dominique Rolin : Dulle Griet (1977).
En 1994, elle publie Le Jardin d'agrément, roman où se produit une chose étrange et inédite : la rencontre à Paris, dans une sorte de collision-annulation des temps, entre, d'une part, Dominique enfant devenue jeune fille puis jeune femme et, d'autre part, la Dominique âgée qui écrit. C'est bien entendu cette rencontre détonante qui fait que l'autobiographie, ou même l'autofiction, se voient à nouveau troublées ou détournées. Quant à l'absence d'indications de temps dans les intitulés des chapitres de ce roman, elle augure d'une nouvelle simultanéité des temps, plus rassérénée, laquelle enveloppera les cinq brefs romans qui achèvent la quatrième phase de l'œuvre : L'Accoudoir (1996), La Rénovation (1998), Journal amoureux (2000), Le Futur immédiat (2002) et Lettre à Lise (2003).
Elle a conservé pour la Belgique un attachement profond. Souvenirs de jeunesse et de voyages tissent dans son œuvre une toile de fond où se retrouvent notamment la ville d'Ostende ou Bruges la vive (1990). Dans ce dernier ouvrage, elle insuffle à la cité que Rodenbach voyait morte une densité et une présence que lui confère la mémoire des paysages, de l'art et des traditions. Les brumes de la mer du Nord accompagnent ses visions intérieures…
Ainsi les métamorphoses d'un style riche et précis, de même que l'extrême mobilité dans une approche presque physique de la mémoire et de l'imaginaire, marquent une œuvre à la mesure d'un siècle intimement vécu dans ses horreurs et ses merveilles. Nous confrontant sans cesse à une vision abrupte et sensuelle du corps humain, de son engendrement et de son langage, Dominique Rolin vient incarner au mieux le propos d'Auguste Rodin, le grand sculpteur français dont Judith Cladel, tante de la romancière, fut très proche : «Il n'y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur : il n'y a qu'une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle.»
NOS EXPERTS EN PARLENT...
Le Carnet et les Instants
Le doute, la mémoire, l’amour, le double, Venise, la musique, les Primitifs flamands, les visages, les miroirs, la Belgique… autant de portes d’entrée du voyage qui mena Dominique Rolin et Patricia Boyer de Latour à tisser un ensemble d’entretiens réunis sous le titre Plaisirs. Dès 1999, bien après Les marais, Le lit, La maison la forêt, Le corps, Les éclairs, à l’époque où paraissent des œuvres majeures comme La rénovation, Journal amoureux, débute une série d’échanges placés sous le signe de « la promenade dans un jardin » (Rolin), le jardin Rolin dont les fleurs s’appellent le doute, la passion, l’enfance, l’écriture comme « investissement total de l’être ».Une…