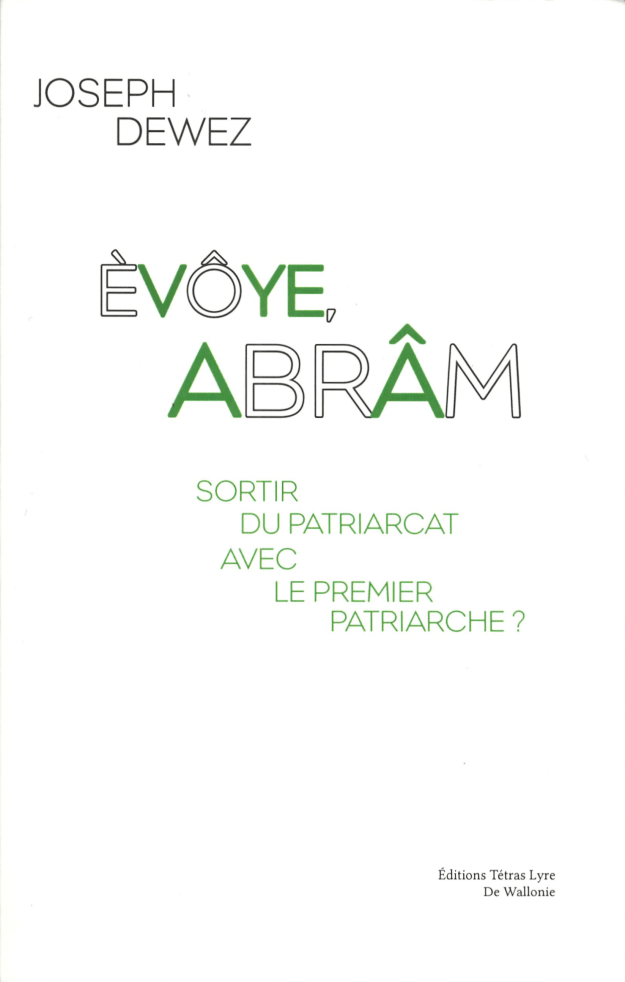Poésie (1944-2004)
RÉSUMÉ
Préface de Charles DobzynskiÀ propos du livre
Au point culminant de la poésie belge contemporaine, Philippe Jones joue un rôle particulier. Non point celui d’un phare, de ceux que célébrait Baudelaire : il est trop discret pour revendiquer une situation privilégiée. Mais depuis plus d’un demi-siècle (le poète est né à Bruxelles en 1924) son œuvre a…
DOCUMENT(S) ASSOCIÉ(S)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe Jones
Auteur de Poésie (1944-2004)
Issu d'une famille de juristes d'origine anglaise, Philippe (Roberts-) Jones naît à Ixelles le 8 novembre 1924. Son enfance est heureuse dans la maison familiale, au sein d'un milieu intellectuel et artistique, mais après ses études à l'Athénée d'Uccle, il tombe gravement malade puis perd son père, fusillé pour résistance aux nazis (1943). Ces épreuves ne paraissent pas étrangères au déclenchement de sa vocation poétique : Le Voyageur de la nuit (1946) le situe d'emblée parmi les poètes de l'aube accordée, au double sens du don et de l'harmonie. Sachant que la nuit rend toujours ses morts, il veut recréer, fût-ce à usage personnel, un ordre, ressaisir le monde à ses origines, au bouillonnement des formes qui se cherchent pour les mener à des structures stables, voire fixes mais constamment variées. Cette démarche d'essence classique ne se démentira pas au courant de quelque vingt recueils de poésie.
Membre de l'Armée secrète, engagé volontaire, Jones devient officier de liaison, puis suit à l'Université libre de Bruxelles deux années de droit mais s'oriente vers l'histoire de l'art. D'un séjour de deux ans à Paris, il ramène sa thèse de doctorat, analysant et synthétisant l'histoire de la caricature française : De Daumier à Lautrec. Revenu en Belgique, il occupe diverses fonctions : inspecteur des bibliothèques publiques, attaché culturel au cabinet du ministre Charles Moureaux (1958), il est bientôt nommé conservateur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts (1961 à 1985); il s'y consacrera à la rénovation intérieure du Musée d'art ancien (1974), à l'établissement d'un Musée provisoire d'art moderne puis à sa recréation originale et définitive (1984).
Nommé professeur d'histoire de la gravure à l'Université de Bruxelles, il y fonde une importante section d'art contemporain. Parallèlement, il poursuit une œuvre de critique artistique ample et variée puisqu'elle s'étend sur plus d'une centaine d'essais, articles et ouvrages, couvrant des matières aussi diverses que La presse satirique illustrée entre 1860 et 1890 (1956), La caricature du second Empire à la Belle Époque (1963), Du réalisme au surréalisme (1969), La peinture irréaliste au XIXe siècle (1978), des études consacrées aux créateurs contemporains, souvent ses amis comme Magritte (1972), Lismonde (1977), Van Lint (1983), Willequet (1985), Jos Albert (1986), Jo Delahaut, Gaston Bertrand et d'autres. Nombre de ses écrits sur l'art sont réunis dans les volumes : L'Art majeur (1974), L'Alphabet des circonstances (1981) et Image donnée, image reçue (1989). Critique compréhensive et aussi dénonciatrice, elle ne se borne pas à l'éloge intelligent mais souligne les crises, les faiblesses inhérentes aux nouveaux cultes esthétiques : ainsi, lorsque la convention de l'anti-conformisme ne garantit plus la facture des choses, le poète-critique y oppose la réflexion, un terme-clé dans son ambiguïté même.
Or on n'oublie pas en (Roberts-)Jones l'incessant dialogue de la parole et de l'image, si bien que le poète construit, en longue patience, ce qu'il estime d'abord chez les plasticiens : la beauté des lignes nettes; car il s'agit moins d'enrichir le langage que de l'épurer et l'œuvre poétique en fournit la preuve. Si l'on y distingue d'ordinaire deux périodes, l'une écrite de 1944 à 1958 et constituée des six premiers livres, l'autre égrenant des publications à partir de 1971, il ne faut pas voir là de rupture d'inspiration mais plutôt un approfondissement et un aiguisement du regard en même temps qu'un resserrement formel qui n'hésite pas à créer une beauté abstraite, voire énigmatique. Seul un arbre (1951) fondait bien le paysage du poème puisque la présence droite d'un tronc, qui est lieu d'échanges de la racine à l'oiseau, contredit le plan de l'horizon et définit ainsi l'espace, un lieu d'être où la structure de la nature peut évidemment se reporter au niveau de la vie morale.
Mais dans l'écriture de la maturité, Graver au vif (1971), Être selon (1973), D'un espace renoué (1979), ou Image incendie mémoire (1985), Jones concrétise cet espace dans la forme même du poème, alternant savamment la verticalité du texte en vers brefs et l'horizontalité du verset, à moins qu'il n'articule des espaces-miroirs où des groupes d'écriture s'organisent parallèlement autour d'un vers central charnière et porteur de sens (jusqu'à la tentation de l'aphorisme), si bien que les plans du poème se répondent rythmiquement en successions de temps coulés et de temps forts.
De même, à la poursuite du mot concret, juste, coloré, et dont parfois le poète joue, comme dans ses Quatre domaines visités (1958), répondent les évocations de Jaillir saisir (1971), où la pénétration d'univers artistiques aussi différents que ceux de Villon et de Schwitters, d'Alechinsky ou de Brancusi, révèle une sensibilité ouverte mais non moins soucieuse à la fois d'élan et de parachèvement, de spontanéité et de maîtrise. Pareil artisanat de précision fait songer parfois à quelque démarche rhétorique; elle s'inscrit en fait dans une tradition française qui relie le trobar clus à Reverdy et à Char et ce n'est pas par hasard qu'après avoir reçu le Prix du Rayonnement français, l'ensemble de l'œuvre a été couronnée par le Grand Prix de poésie de l'Académie française (1980). Au reste, c'est la valeur du témoin, la justesse du rapport qui tranche notait Jones (Bloc-notes, 1958) dont les derniers recueils, D'encre et d'horizon (1989), Toi et le tumulte (193) ou Le Temps hors le temps (1994), affrontent le sens de l'humain et de l'écrire, questionnent inlassablement notre aléatoire être-image dans la prolifération de l'espace-temps. Récemment, Jones a aussi publié deux recueils de récits courts, originaux, où les instantanés sociaux sont prétextes à images poétiques et réflexions morales.
Élu membre (1975), président (1980) puis secrétaire perpétuel (1984) de l'Académie royale de Belgique, membre de l'Académie de langue et de littérature françaises de Belgique (élu le 9 avril 1983), membre de l'Institut de France (1987), de l'Académie des sciences de Hollande (1985), de l'Académie Mallarmé (1989) et de l'Académie internationale de poésie de Luxembourg (1995), Jones a reçu en 1988 le titre de baron.
Philippe Jones est mort le 9 août 2016.