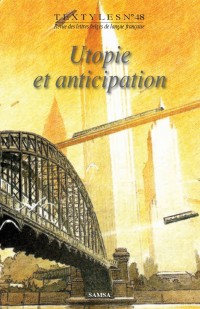
Un ouvrage critique se demandait récemment s’il existait un « style Minuit » XX . On peut…
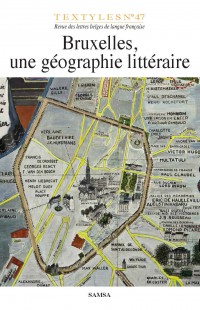
Laserra (Annamaria), Leclercq (Nicole) et Quaghebeur (Marc), dir., Mémoires et antimémoires littéraires au xxe siècle. La Première Guerre mondiale Bruxelles, PIE-Peter Lang, coll. « Documents pour l’Histoire des Francophonies », n° 15, 2008, 2 volumes, 426 et 339 p. * Cet ouvrage en deux volumes , co-dirigé par Marc Quaghebeur, publie les actes d’un colloque organisé en 2005 à Cerisy-la-Salle par les Archives et Musée de la Littérature et l’Université de Salerne. Inspiré par les Antimémoires d’André Malraux, où « l’Histoire côtoie la fiction, mais pas au sens de sa narration réaliste », cet ensemble de textes scientifiques centrés sur la Première Guerre mondiale et ses retentissements dans la littérature, esquisse un « parcours à l’intérieur de l’Histoire et de la Littérature de la Grande Guerre », mettant en relation les regards de critiques littéraires et d’historiens. Se limitant au théâtre de la guerre sur le front Ouest, les 33 contributions publiées analysent successivement les témoignages et positions d’écrivains célèbres qui n’ont pas participé au conflit (Rolland, Eeckhoud, Proust, etc.), pour s’intéresser ensuite aux récits de toute une variété d’auteurs, acteurs, « chantres » ou témoins de la guerre, écrits en 1914-1918 ou dans l’entre-deux-guerres, tentant d’évaluer la contribution de la littérature à l’organisation de la mémoire collective de la Grande Guerre. « Rebrassages de la mémoire historique » : les contributions rassemblées dans la troisième partie de l’ouvrage explorent les rapports entre l’écriture de l’Histoire et celle de la fiction et la question du pacifisme. Une quatrième partie, « Lointains après-coups d’une mémoire toujours vivace » s’attache surtout à la prise en charge de la guerre dans la fiction narrative belge, puis deux sections finales de cet imposant ouvrage présentent « quelques figures presque transhistoriques » de l’Histoire de 1914-1918 telles la guerre des gaz et la figure de l’infirmière, ainsi que deux récits de « derniers témoins » du conflit. Une perspective très large donc pour des contributions dont la diversité montre la richesse du patrimoine littéraire inspiré par la Grande Guerre. J’évoquerai brièvement ici quelques-unes de ces contributions, qui combinent l’analyse comparative des sources historiques avec l’analyse des textes littéraires et concernent des auteurs belges. Comme le note Sophie De Schaepdrijver , le déclenchement du grand conflit provoque une véritable « mobilisation culturelle ». La Belgique envahie, « nation héroïque d’abord, martyre ensuite », occupe une place majeure dans l’imaginaire de guerre des pays de l’Entente. Dans l’entre-deux-guerres, le démantèlement de cet imaginaire de guerre voit la réhabilitation de personnalités auparavant réprouvées, tel Georges Eekhoud, écrivain francophone de racines flamandes, mis au pilori dans la presse à la Libération, et pénalisé aussi sur le plan professionnel par les autorités de la Ville de Bruxelles, pour ce qu’on jugeait alors comme son manque de patriotisme durant l’Occupation. Mais l’historienne remarque : « l’image du vieil écrivain rebelle jetant son gant à la figure de l’idéologie nationaliste belliqueuse simplifie au point de déformer ». Le journal intime d’Eekhoud, demeuré à Bruxelles sous la botte allemande, permet de suivre le cheminement de sa pensée : lors de l’entrée en guerre et du début de l’Occupation, « Eekhoud se fait le chantre de la Belgique héroïque tout comme ses célèbres confrères Verhaeren et Maeterlinck ». Initialement, il « participe pleinement à la diabolisation de l’Allemagne ». Mais ensuite, l’image d’une ville dominée par le « chacun pour soi », la veulerie et la délation domine sa vision. Son regard d’écrivain y perçoit donc surtout « l’envers de la Belgique héroïque » : au lieu de souder la communauté nationale, l’Occupation la désintègre ! Hanté par la crainte de la déchéance sociale, Eekhoud en vient vite à considérer l’occupant comme un rempart face à « l’anarchie et la racaille ». Soucieux de sa gloire littéraire, il n’applique donc pas la consigne patriotique de ne rien publier tant que la Belgique est occupée, et signe en février 1916 un contrat avec l’Insel-Verlag qui publie ses œuvres dans une « Série flamande » à fins de propagande. Eekhoud est un des rares écrivains belges à avoir accepté une telle offre, ce que ses contemporains patriotes ne lui pardonneront pas. Après la guerre, ceux qui veulent réhabiliter l’écrivain rebelle, « chantre des ouvriers et des marginaux », mettront en valeur sa qualité de Maître de la littérature belge, qualifiant ses censeurs patriotes de ratés de la littérature et de « pygmées » et le pacifisme international fera de lui un héros du refus de la guerre... À travers l’œuvre d’écrivains belges réputés de l’entre-deux-guerres (Adolphe Hardy, Martial Lekeux, Laurent Lombard et Robert Goffin), Laurence van Ypersele analyse l’évolution de la représentation d’héroïques patriotes de la Résistance civile en Belgique (tels les Grandprez, Raoul Jacobs ou le commissaire Radino), aujourd’hui tombés dans l’oubli. L’immédiat après-guerre dans le pays endeuillé est marqué « par le culte des héros dont la mort est la gloire de la Patrie vivante et victorieuse ». De 1918 à 1924, alors que partout en Belgique s’érigent des monuments aux morts et que le culte des morts pour la patrie maintient le sens du conflit, les nombreuses publications de récits hagiographiques assurent à nos héros et martyrs la survie dans la mémoire collective. Mais dans toutes ces histoires édifiantes, les patriotes héroïques « se ressemblent étrangement ». La comparaison avec la figure du soldat est omniprésente chez ces civils exemplaires, agissant en véritables « soldats de l’intérieur ». Les récits décrivent peu les actions menées par ces résistants civils, de coups d’audace en missions dangereuses, et se concentrent plutôt sur la mort face au peloton d’exécution de ces simples citoyens, hommes et femmes ordinaires. Devenus par leur martyre « de véritables héros du civisme », tous semblent périr selon un même schéma, proche du récit de la Passion du Christ. L’évocation de la barbarie teutonne contraste avec la noblesse de ces « espions » fusillés, prouvant leur désintéressement total et la pureté de leur engagement patriotique par leur sacrifice suprême. Le sang de ces martyrs, « est une semence féconde de héros » et donc « leur mort a suscité de nouvelles vocations héroïques et encouragé la combativité des soldats du front ». De 1925 à 1933, le pacte de Locarno et la détente internationale favorisent le pacifisme et la démobilisation culturelle. En réaction, les « vrais » récits de l’héroïsme civil, mêlant histoire et fiction, cherchent à prolonger le culte de la patrie en danger et à alimenter la haine du Boche. De 1934 à 1940, l’ascension au pouvoir d’Hitler remobilise les esprits. Les histoires romancées de Laurent Lombard donnent des exemples de patriotisme à la jeunesse et appellent à l’unité nationale contre les menaces fascistes et flamingantes. La solidarité et le désintéressement des « passeurs d’hommes » et agents de renseignement, bons patriotes, s’oppose à la vénalité des Allemands. Dans sa contribution « De la culture dans les camps de prisonniers ? », Nicole Leclercq contextualise les souvenirs de guerre de son grand-père, Albert Delahaut, fait prisonnier le 6 août 1914, lors de la bataille pour Liège, rapatrié en janvier 1919, après une longue détention dans les camps de prisonniers de Basse-Saxe. Elle retrace le parcours de son aïeul et les multiples activités culturelles…

Exploration du langage de la bande dessinée. Rencontre avec Thierry Van Hasselt
Thierry Van Hasselt est auteur de bande dessinée, plasticien, scénographe, installateur, graphiste et professeur à Saint-Luc. Il est aussi l’un des membres fondateurs du Frémok, plateforme d’édition indépendante bruxello-bordelaise menée par un collectif et issue de la rencontre d’artistes passionnés. Depuis vingt-cinq ans, les livres publiés par le Frémok proposent une bande dessinée qui sort du cadre, repousse sans cesse ses frontières avec l’art plastique et la narration littéraire. * Que ce soit au niveau du format de ses livres (parfois très petits ou très grands, épais ou minces), par les techniques plastiques utilisées pour les réaliser, les sujets traités, le Frémok n’est jamais là où on l’attend. Formé dans les années nonante par un groupe d’étudiants en art réunis par des aspirations et projets communs, le Frémok, qui s’appelle alors Frigo Production, puis le Fréon, a commencé en créant des ouvrages faits maison, à la photocopieuse, en sérigraphie ou en gravure. De la microédition artisanale à tout petit tirage. Dès cette période, la conscience des moyens de production et la volonté de dépasser une qualité standard constituent la pierre angulaire de leur travail. Ultra-exigeant sur la qualité d’impression, le collectif investigue en particulier ce champ technique. Thierry Van Hasselt, un des membres les plus actifs du Frémok, y publie une œuvre singulière, qui commence avec la parution de Gloria Lopez. Dans ses albums de bande dessinée, on entre en immersion dans l’image, dans une narration tout sauf classique, on perd ses repères pour mieux se laisser happer. Il a récemment reçu le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée pour son ouvrage Vivre à Frandisco, réalisé avec l’artiste Marcel Schmitz, créateur d’une ville imaginaire. Thierry Van Hasselt, comment a commencé votre parcours dans la bande dessinée? J’ai aimé la bande dessinée très jeune et j’ai voulu très tôt en faire mon métier. Après une scolarité un peu douloureuse, j’ai commencé la bande dessinée à Saint-Luc à Bruxelles. Cela a été une période de découverte, de liberté et d’ouverture vers des univers dont je ne soupçonnais pas l’existence. Alors qu’au départ je m’intéressais à de la bande dessinée plutôt classique, j’ai découvert le travail de Lorenzo Mattotti, qui a provoqué en moi un déclic : il était possible de connecter la peinture, la grande littérature et la bande dessinée. Mattotti a été le passeur qui m’a permis d’autres découvertes comme celles de la bande dessinée espagnole, de la revue d’Art Spiegelman Raw, du travail d’Alex Barbier, de José Muñoz… J’ai ensuite rencontré le groupe Moka, constitué par des étudiants de Saint-Luc un peu plus âgés que moi, parmi lesquels il y avait Éric Lambé ou Alain Corbel, et qui avait créé une revue. Nous nous sommes au départ clairement inscrit dans la prolongation de ce groupe qui n’a pas duré mais dont nous avons récupéré l’énergie. Nous avons repris le flambeau en créant d’abord le groupe Frigo Production puis, après une restructuration du groupe, les éditions Fréon. Plus tard, nous avons rencontré les gens d’Amok à Paris et avons décidé de travailler ensemble, ce qui a donné naissance au Frémok. Nous investissons beaucoup dans la production et la fabrication. C’est notre terrain d’expérimentation. Nous travaillons de près avec un photograveur qui lui-même collabore étroitement avec un imprimeur. Notre manière de travailler est hors norme, nous utilisons une technique d’impression tout à fait nouvelle. Aujourd’hui, ce sont souvent les auteurs qui scannent leurs propres illustrations. Or, ils ne sont pas formés pour le faire. L’évangile doré de Jésus Triste (réalisé avec La « S ») a été imprimé avec deux noirs pour obtenir une saturation d’encre proche de celle de la linogravure. Le Frémok travaille avec La « S » Grand Atelier qui propose des ateliers de création pour des artistes mentalement déficients. Qu’est-ce qui vous a mené à collaborer sur des projets collectifs puis sur Frandisco? C’est Anne-Françoise Rouche, directrice de La « S », qui est venue vers nous. Ils organisent des résidences d’artistes dans le cadre de leur projet de mixités entre artistes mentalement déficients et artistes contemporains. Ils souhaitaient travailler dans le domaine de la bande dessinée, et le côté expérimental du Frémok, ses libertés par rapport aux normes de la bande dessinée canonique, leur ont donné envie de venir nous chercher. Après une première réaction de perplexité, car on s’interrogeait sur ce vers quoi cette collaboration allait nous mener, nous avons accepté. Cela nous motive toujours d’aller vers l’inconnu et là où on ne nous attend pas. Très vite, ce travail de collaboration s’est révélé être transformateur pour nous. Cela a en fait bouleversé nos pratiques de la bande dessinée, puis donné lieu à la création d’une plateforme d’édition commune, Knock Outsider, dédiée à l’art brut contemporain et à la recherche autour de cet art. En quoi cela a-t-il bouleversé les artistes du Frémok? Nous sommes des artistes plutôt cérébraux, avec une conscience théorique. Nous avançons dans une autoréflexion constante de nos pratiques. Nous nous sommes soudain confrontés à des artistes qui n’étaient pas dans cette intellectualisation du travail, mais plutôt dans une grande liberté par rapport au médium. Ce télescopage-là a amené une sorte de choc esthétique, puis une autorisation de partir dans des directions dans lesquelles, encombrés par notre théorie ou notre culture, nous ne serions pas allés seuls. Je pense notamment au projet que j’ai réalisé avec Marcel Schmitz : quand je travaille seul, le ton est beaucoup plus grave, avec un rapport au monde présentant plus d’angoisse, de pesanteur. Avec Marcel, je suis parti dans une espèce de jubilation, de joie de vivre, des choses beaucoup plus élémentaires, aussi bien dans la façon d’aborder le dessin que dans le sujet, qui est la découverte d’un monde heureux, ludique, même si une certaine gravité est aussi présente. Nous sommes heureux de travailler ensemble et c’est aussi ça que je raconte. Jamais je n’aurais pensé faire un travail dans l’optimisme, l’humour et la légèreté tout en posant des questions fondamentales et profondes. Je n’en reviens toujours pas, à vrai dire, d’avoir fait une telle bande dessinée. Parallèlement, je continue à travailler seul et c’est alors un travail beaucoup plus sombre, écorché. Votre style graphique évolue sans cesse. De Gloria Lopez à Vivre à Frandisco, votre technique diffère. Comment expliquez-vous cela? Je n’ai pas une mais plusieurs techniques de prédilection. Je me pose d’abord la question du sujet : de quoi est-ce que je veux parler ? Qu’est-ce que je veux convoquer dans un récit ? La technique suit. Je vais trouver un outil qui me permettra, de la façon la plus adéquate, d’en parler. Pour Gloria Lopez, qui traite de perception mentale et de flou de conscience, j’ai utilisé la technique du monotype, où l’image n’est jamais fixée et semble toujours pouvoir se diluer. Pour traiter cette question d’apparition/disparition du sujet, c’était la plus appropriée. Pour un autre de mes projets, lié à la danse, avec la chorégraphe Karine Ponties, qui parle de ces mouvements mentaux, j’ai utilisé la même technique, en continuité avec Gloria Lopez. Pour Vivre à Frandisco, qui traite de la ville, j’avais envie d’utiliser un outil d’architecte et de revenir à quelque chose de très simple. Je n’avais jamais travaillé au trait. C’était pour moi un très grand déplacement graphique et esthétique, mais qui correspondait bien au déplacement du sujet. Je suis donc parti sur cet outil que je n’avais qu’à peine expérimenté…