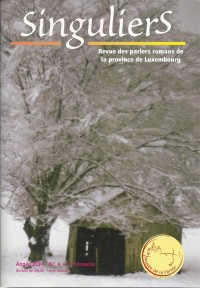
Rivêrè-t-i ? (commémoration ‘La 100 ans : aous’ 1914)
Ce poème fut écrit par Joseph Calozet le dimanche 18 juin 1916. Il fait partie d’un recueil d’une quinzaine de poésies, écrites durant la Première guerre mondiale, sous le titre de Fleûrs dès mwês djoûs . Ces poésies sont rééditées, avec bien d’autres textes écrits durant la Grande Guerre, par les Rèlîs Namurwès (février 2015) sous le titre de Kriegscayès . Renseignements : Guy Delvaux, secrétaire des Rèlîs Namurwès, Avenue Golenvaux, 23 bte 7 - B 5000 Namur - Belgique. T + (0)81 73 59 70 - Rivêrè-t-i ? Lès viyolètes èt lès muguèts Sintèt, sintèt, l’ bon dol fôsse vôye XX . Li djon.ne comère sondje ôs boukèts K’ èle atètchot su s’ taye di sôye XX . Mês lès muguèts ont bê flori, Li ci k’ a pris s’ keûr è-st-èvôy : Rivêrè-t-i ? Lès jérânioms èt lès jasmins Créchèt, créchèt dvant lès fignèsses : Li djon.ne mariéye sondje ô bê timps Cand s-t-ome lî fiot tant dès carèsses. Mês lès jasmins plèt bin flani XX , Lèye n’ a pus k’ one idèye al tièsse : Rivêrè-t-i ? Li solê lût, lès ptits-èfants Dansèt, dansèt tote li djoûrnéye : Li mére somadje XX a lès-oyant Gn-a onk ki n’ èst pus dins l’ nitéye... XX Èt lès-èfants ont bê couru, L’ moman s’ dimande bin tourmintéye : S’ i n’ ruvnot pus ! Lès-ôlouwètes èt lès archèts XX Volèt, volèt, bin hôt dzeû l’ tère Li vî grand pére va s’ porminè Èt bâchant l’ tièsse, i brêt XX tofèr, Lès-ôlouwètes ont bê tchantè, Li n’ sondje k’ ô ptit k’ èst vôy al guêre : Èst-c’ k’ i rvêrè ? Lès mitrayeûses èt lès canons Broûyèt, bouchèt dzeû lès tranchéyes Li ptit sôdâr si catche ô fond, A ratindant l’ fin dol nouwéye XX . Lès côps d’ canon ont bê pôrti, Li n’ sondje k’ ôs sin.nes k’ i vôrot rvéy : Lès rvêrè-t-i ? Joseph Calozet (1883-1968) (en wallon d’Awenne) Malêjis mots archèt = martinet noir (Apus apus) brêre = pleurer flani = faner fôsse vôye = chemin sans issue nitéye = nichée nouwéye = nuée, pluie d’obus somadjè = soupirer sôye = soie fôsse vôye = chemin sans issue sôye = soie flani = faner somadjè = soupirer nitéye = nichée archèt = martinet noir (Apus apus) brêre = pleurer nouwéye = nuée, pluie d’obus…
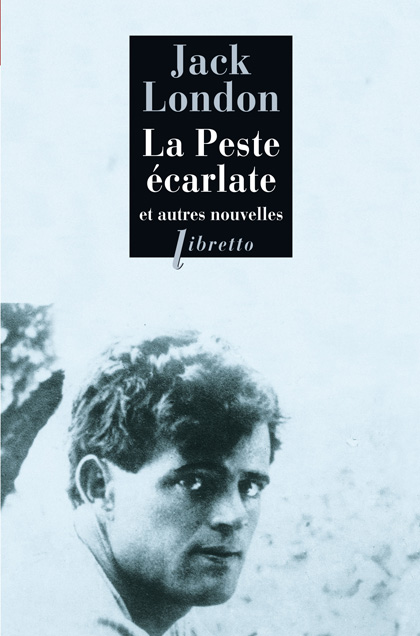
La Peste écarlate - modernité de Jack London
La Peste écarlate rassemble quelques nouvelles méconnues de Jack London, le formidable auteur du Loup des mers , de Croc-Blanc et de L’Appel…
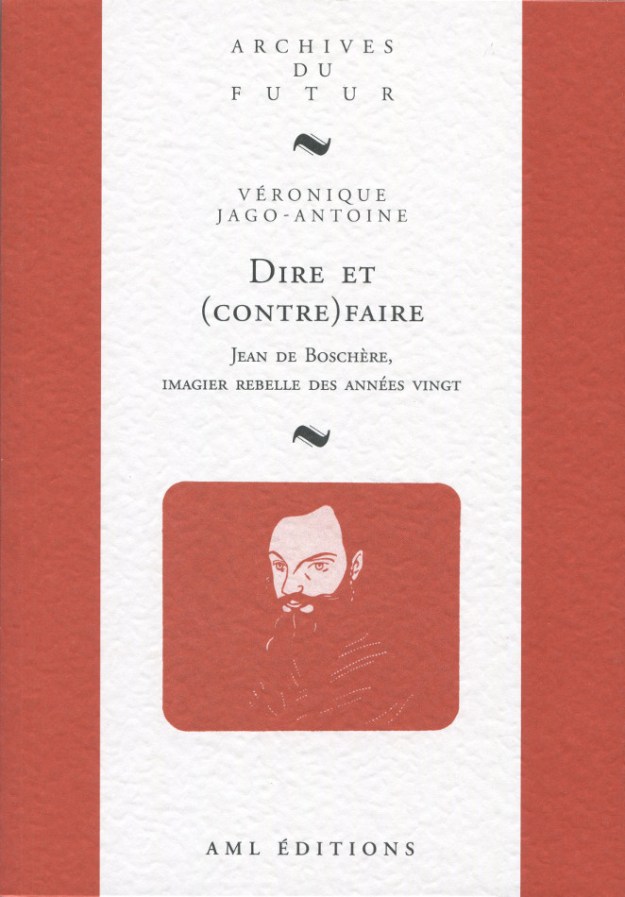
Dire et (contre)faire. Jean de Boschère, imagier rebelle des
Figure quelque peu oubliée de nos lettres, Jean de Boschère (1878-1953) fut poète, romancier, essayiste, critique d’art, mais aussi dessinateur, graveur, peintre, sculpteur.Personnage singulier, solitaire, révolté, s’inscrivant en marge des courants littéraires de son temps qu’il traversa sans y adhérer vraiment, il mena longtemps une existence itinérante.Né à Uccle, vivant dès l’enfance en Flandre, il quittait la Belgique occupée en 1915 pour Londres où il se liait aux imagistes anglo-américains groupés autour d’Ezra Pound et de T.S. Eliot ; habiterait quelques années en Italie, « le Pays du Merle bleu » ; s’établirait en 1926 à Paris, où il côtoierait les surréalistes ; et achèverait sa route vagabonde à La Châtre, petite ville de l’Indre où il s’éteindrait en 1953. Laissant une œuvre aux accents très personnels, aux registres variés, admirée par Valéry et par Antonin Artaud, portée par la recherche d’un absolu spirituel. Dans son essai Dire et (contre)faire. Jean de Boschère, imagier rebelle des années vingt , Véronique Jago-Antoine a entrepris de « ré-arpenter les chemins méandreux de cet univers de mots et d’images ». Son étude très dense et approfondie, abusant parfois de termes savants, qui paraît aujourd’hui aux AML dans la collection Archives du Futur, rend toute sa place à un écrivain-plasticien complexe, difficile, tourmenté, dont l’œuvre dès les débuts n’a cessé d’exercer une « incommode fascination ». Des débuts d’inspiration symboliste : les poèmes en prose Béâle-Gryne (1909), et, deux ans plus tard, Dolorine et les Ombres où il prend déjà ses distances avec la tentation de fuir dans le rêve.Suivait la trilogie des métiers, qui ravive, rajeunit une tradition ancienne. Trois petits recueils illustrés – Métiers divins (1913), 12 Occupations (1916), Le Bourg (1922) – souvent négligés, que l’auteur explore avec acuité, soulignant le dialogue textes-images ; nous faisant vivre la mue de l’écrivain, dès son exil Outre-Manche, entre le premier recueil, où percent encore les afféteries de la Décadence, et ceux qui suivront, toujours plus incisifs, dépouillés jusqu’à l’épure.Au cours du séjour londonien paraissent, en édition bilingue, deux recueils : The Closed Door (1917) et Job le Pauvre (1922), livre majeur, que Véronique Jago-Antoine scrute avec une attention passionnée. Un recueil âpre, véhément, douloureux (« Ces pages d’extrême détresse », écrivait Jean de Boschère à un ami, et, dans sa dédicace à Robert Guiette, « ce livre noir, sans ciel, sans oiseaux, sans fleurs ; mais malgré l’enfer ouvert, non sans espoir »). C’est celui dans lequel il reconnaissait un accomplissement : « J’atteignais à peu près mon but dans Job le Pauvre ». Commençant par ces deux vers intenses que Liliane Wouters citait comme la plus belle, la plus éclairante évocation de la poésie : « Et puis, enfin, un midi et à jeun, / La pensée se fend et s’ouvre ».L’auteur nous entraîne dans une analyse pénétrante, minutieuse, presque vertigineuse, des poèmes mais aussi des gravures, des collages qui les accompagnent et les prolongent. « Il me semble que ce livre ne concerne pas la littérature, et qu’il est difficile à classer. On n’en parlera pas, et tout sera parfait. C’est probablement le dernier que je publierai : ce qui me reste dans l’âme ne peut pas se dire », confiait le poète à André Suarès, un de ses amis les plus proches, avec Max Elskamp, René Daumal ou Audiberti…Véronique Jago-Antoine épingle certaines années, correspondant à des étapes. Telle 1913 où Jean de Boschère signe les proses poétiques des Métiers divins, mais aussi deux textes remarquables sur Bruegel l’Ancien, qui enthousiasmèrent Max Elskamp : « Sais-tu, mon cher Jean, que ces pages sont, selon moi, les plus belles que tu aies écrites… ». Ou encore 1927, quand paraît le roman largement autobiographique Marthe et l’Enragé , écho de son adolescence solitaire et rebelle en Flandre, à Lier, marquée par le sort tragique de sa sœur. Dans cette veine s’inscriront Satan l’Obscur (1933) et Véronique de Sienne . C’est également à partir de 1927 que les mots et les images, jusque là indissociables dans sa quête poétique, prennent des voies séparées. En témoigne l’absence de toute illustration lors de la réédition en 1929, dans Ulysse bâtit son lit , de The Closed Door et de Job le Pauvre .Véronique Jago-Antoine achève son étude par l’examen d’une facette méconnue de l’écrivain-artiste : ses écrits sur l’art. Des textes sur Bruegel, « élu comme un frère d’armes », aux monographies consacrées à Jérôme Bosch et à Léonard de Vinci.Et conclut son voyage au plus près de celui qui s’était dépeint un jour comme « un ouvrier solitaire et fiévreux, dont les mains seules ont réponse à la vie », par une certitude : « Nous pouvons nous sentir loin de ses formes, parfois. Son enjeu – oserions-nous dire sa brûlure – demeure…