
Bernard Debroux : Dans Métaphysique du bonheur réel XX , vous citez plusieurs fois cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Par association d’idée, elle m’a ramené à un des spectacles les plus marquants dans mon souvenir de spectateur, 1789 du théâtre du Soleil, découvert en 1969 (!) et dont le sous-titre était une autre phrase de Saint-Just : « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ». Dans ce même livre vous proposez une distinction entre différents types de vérité et les différentes formes de bonheur qui y sont liées : le plaisir pour l’art, la joie pour l’amour, la béatitude pour la science et l’enthousiasme pour la politique. Dans mon expérience de spectateur, il me semble que la réception de 1789 mêlait ces différents états : du plaisir bien sûr, mais aussi de l’enthousiasme ! Alain Badiou : Si l’on parle de ce spectacle en particulier, il est évidemment inséparable de l’enthousiasme flottant de l’époque toute entière, surgi en 1968. On allait de l’enthousiasme politique au théâtre et du théâtre à l’enthousiasme. Au théâtre, il y a une capacité singulière pour le spectateur qui consiste à transformer sa réception en quelque chose comme un bonheur, le bonheur du spectateur qui va faire l’éloge du spectacle à partir d’éléments qui peuvent être au contraire sinistres, tragiques, effrayants etc. C’est en ce sens que je dis que le théâtre reste dans le registre de l’art. Il y a un bonheur singulier qui est lié, non pas à ce qui est, mentionné, représenté mais au théâtre lui-même, le théâtre en tant qu’art. Dans le spectacle que vous évoquez, je suis d’accord avec vous, il y avait à la fois le bonheur du théâtre et l’enthousiasme qui vous mobilisait subjectivement pour changer le monde… B. D. : …et de la joie aussi … A. B. : Aussi, oui. B. D. : Peut-être pas la béatitude que procure la découverte scientifique! A. B. : Oh, sait-on ? Voyez la pièce de Brecht sur Galilée ! La singularité du théâtre est peut-être de produire un affect affirmatif avec des données qui, du point de vue de leur apparence ou de leur évidence, ne le sont pas du tout. J’ai toujours trouvé extraordinaire que les spectacles les plus effrayants, ceux dont on devrait sortir anéantis, arrivent à prendre au théâtre une espèce de grandeur suspecte qui fait qu’on sort de là illuminé, en un certain sens, par des crimes et d’infernales trahisons. B.D. : Les pièces de Shakespeare en sont un exemple frappant… A. B. : C’est la question paradoxale du plaisir de la tragédie. Aristote a tenté d’en donner une explication. Il a dit qu’au fond, nos mauvais instincts se trouvaient purifiés parce qu’ils étaient symbolisés sur la scène, et ainsi comme expulsés de notre âme. Il appelait ça « catharsis », purification. Nous sommes heureux au théâtre parce que nous sommes déchargés, par le spectacle réel, de ce qui empoisonne notre subjectivité. Le théâtre est une machine assez complexe. Il est toujours immergé dans son temps, donc il est traversé par les affects dominants du temps. C’est pour cela qu’il y a un théâtre dépressif ou un théâtre de l’absurde ou un théâtre épique etc. Mais d’un autre côté, quand il est réussi, quand il a la grandeur de l’art, il crée un affect qui est fondamentalement celui de la satisfaction, quelle que soit sa couleur, avec des matériaux on ne peut plus disparates. B. D. : En prolongement de cette réflexion, je voudrais faire référence à cette même époque (de l’après 68) et à mes débuts de travail dans l’action culturelle où j’aimais éclairer le sens de cette action en m’appuyant sur les concepts développés par Lucien Goldmann XX et repris à Lucacz de « conscience réelle » et « conscience possible ». C’était une idée très positive, très affirmative (qu’on peut bien sûr interroger et critiquer différemment avec le recul) qui supposait que l’art, la création, les interventions culturelles et artistiques pouvaient bousculer les habitudes sclérosées et produire du changement… Pourrait-on mettre en lien ces concepts et ces pratiques avec ce que vous appelez le « théâtre des possibles » que vous mettez en opposition avec le théâtre « théâtre » qui est dans la reproduction d’un certain réel édulcoré et où rien ne se passe…? A. B. : Je pense que le grand théâtre propose toujours une espèce d’éclaircie à la pesanteur du réel, éclaircie qui reste dans l’ordre du possible, et donc fait appel chez le spectateur à un type de conscience qu’il ne connaît pas immédiatement, qui n’est donc pas sa conscience réelle. Le théâtre joue en effet sur cette « possibilité ». Antoine Vitez répétait souvent que « le théâtre servait à éclairer l’inextricable vie ». L’inextricable vie, c’était le système d’engluement de la conscience réelle dans des possibilités disparates, des choix impossibles, des continuités médiocres. Le théâtre fait un tri, dispose tout cela en figures qui se disputent ou qui s’opposent, et ce travail restitue des possibilités dont le spectateur, au départ, n’avait pas conscience. Le problème est de savoir à quelles conditions cette conscience possible peut se fixer, se déployer, en dehors de la magie théâtrale. Y a-t-il réellement une éclaircie de l’inextricable vie ou simplement une petite parenthèse lumineuse ? C’est la question que vous posez : quelle est exactement la ressource d’efficacité du théâtre de ce point de vue ? Est-ce une capacité de transformation « réelle »? Est-ce que le passage de la conscience réelle à la conscience possible est lui-même réel ou simplement possible ? Je crois que lorsqu’on sort d’un spectacle, on demeure comme suspendu à cette difficulté… * B. D. : Le théâtre européen a été fortement influencé à partir des années 1970 et 1980 par l’irruption des sciences humaines dans l’espace social. A côté du metteur en scène on a vu apparaître le « dramaturge » au sens allemand. Celui-ci a pu même être considéré à un certain moment comme le « gardien » du sens. Le théâtre est un univers de signes (texte, jeu de l’acteur, scénographie, lumières, costumes) où tout fait sens. On entendait souvent lors de répétitions dire à l’acteur : « là, ce que tu fais, c’est juste ». Paradoxalement, je me souviens d’avoir assisté à des répétitions de pièces mises en scène par Benno Besson (qui avait pourtant travaillé de longue années avec Brecht à Berlin) encourager l’acteur en lui disant : « là, ce que tu fais, c’est beau ». A. B. : Je serai assez tenté d’admirer les deux approches et d’être dans une synthèse prudente afin d’éviter le choix. D’une certaine façon quand on disait « c’est juste », on emploie un mot qui est, soit du registre de l’exactitude, soit du registre de la norme. Juste est un mot équivoque. On peut en effet aussi bien dire : « Le résultat de cette addition est juste ». Le mot « juste » tire vers justice ou tire vers exact. Il est au milieu des deux. Je pense aussi que lorsqu’on disait « c’est juste » dans un contexte sournoisement politisé, c’était parce qu’on préférait dire juste que beau. Dire « c’est beau » était considéré comme trop intemporel… Les deux appréciations peuvent en vérité apparaître chez le metteur en scène à des moments et dans des contextes différents. « Juste » va tirer du côté de la conscience possible, de la fonction éducative du théâtre. « Beau », c’est autre chose, c’est le sentiment qu’on peut avoir d’être dans une lumière singulière, une éclaircie visible. « Beau » est une qualité intrinsèque de ce qui se voit, de ce qui apparaît, de ce…
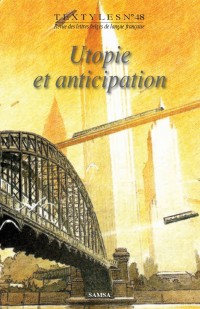
Un ouvrage critique se demandait récemment s’il existait un « style Minuit » XX . On peut…
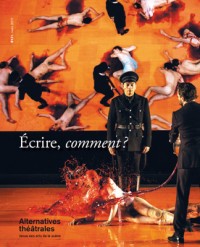
Derniers figurants d’une ville fantôme À propos de Zvizdal
(Tchernobyl – si loin si proche), collectif Berlin Le point de départ des spectacles de Berlin se situe généralement dans une ville ou une région de la planète. Fondé en 2003 par Bart Baele, Yves Degryse et Caroline Rochlitz, le collectif anversois se caractérise par l’aspect documentaire et interdisciplinaire de son approche. Ensemble, ils ont entamé un cycle intitulé Holocène XX , avec les spectacles Jerusalem, Iqaluit, Moscow, puis le cycle Horror Vacui avec Tagjish, Land’s End et Perhap’s All The Dragons. C’est avec la journaliste Cathy Blisson qu’ils ont choisi de poser leur regard et leur caméra sur Zvizdal et ses deux habitants. Portait filmique, performance théâtrale sur multi-écrans... Zvizdal s’attache à l’existence de Nadia et Pétro, dans une banlieue de Tchernobyl. Inspirés par leur vie hors norme en terre contaminée, le groupe Berlin et Cathy Blisson ont réalisé un projet entre théâtre, installation et documentaire – d’une profondeur abyssale. Cette création, qu’on a pu voir à Bruxelles dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts aussi bien qu’au Centquatre-Paris, pendant le Festival d’automne 2016, a laissé sans voix bon nombre de spectateurs. Touchés, émus, respectueux, affolés..., difficile pour le public de sortir indemne de ce récit tragique et réel. Impossible de ne pas être en empathie avec ce couple de vieillards du bout du monde, qui continue à vivre comme si de rien n’était, dans une nature étonnamment luxuriante. Robinson Crusoé d’un cataclysme invisible (la radioactivité ne se décèle pas à l’œil nu), Nadia et Pétro vivent reclus dans un territoire abandonné des humains. C’est après plusieurs voyages en Ukraine que Cathy Blisson a rencontré (par hasard) ce couple incroyable qui vit dans la zone interdite de Tchernobyl. Critique dans les champs de la création contemporaine hybride, à la croisée des disciplines scéniques et autres arts visuels XX , Cathy Blisson connaissait la quasi-totalité des spectacles du collectif Berlin. Elle poursuit aujourd’hui un travail d’écriture en tant que dramaturge auprès de plusieurs compagnies et s’attelle à des projets personnels d’écriture textuelle et sonore, notamment avec Anne Quentin (Collectif &.). Quand elle a rencontré pour la première fois Yves Degryse et Bart Baele, après un de leur spectacle programmé au théâtre de la Cité Internationale, c’était sans arrière-pensée : « Nous avons commencé à discuter et j’ai évoqué ma rencontre avec Nadia et Pétro, qui vivaient comme seuls au monde dans un village déserté car soumis aux radiations. J’avais envie d’en faire un projet et il (Yves) m’a demandé si j’avais une équipe... et c’est parti comme cela. Bart et Yves ont cette capacité à rentrer par la petite porte dans les grandes histoires ou à voir les grandes choses dans de petites histoires, sans être intrusifs. Le premier tournage a commencé en 2011.» XX Pour mémoire, cela fait déjà une trentaine d’années (le 26 avril 1986, accident classé 7 sur l’échelle internationale des événements nucléaires) que le plus grave accident nucléaire (avec Fukushima) a eu lieu, dans cette ville du nord de Kiev, en Ukraine. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, 350.000 personnes ont été déplacées, des dizaines de villages rasés et des zones d’exclusion délimitées (voir Pierre Le Hir, « Retour à Tchernobyl », Le Monde du 25-04-16). Après plusieurs voyages dans cette région, Cathy Blisson a pu pénétrer dans la zone interdite grâce à un ami photographe et a découvert les nonagénaires : deux vieux magnifiques aux gueules burinées. Solaires, malgré leurs bouches édentées et leurs silhouettes amaigries et bancales. Nadia, dite Baba ou La Vieille – par celui qu’elle nomme le Vieux –, avance en boitant, miraculeusement. Ce projet s’est donc naturellement construit autour d’eux et de leur rythme lent. Par nécessité et respect pour ces deux personnes, qui sont aussi les personnages principaux du récit, avec leurs animaux : « Partir à la rencontre de Pétro et Nadia, âgés respectivement de quatre-vingt-six et quatre-vingt-cinq ans à l’époque, nécessitait un travail sur le long terme. C’était clair que nous devions rentrer dans le rythme de leur vie et suivre les saisons » XX , explique Yves Degryse. Filmés au fil du temps, 4 ans durant, le couple se révèle progressivement aux interviewers. Baba et son Vieux se confessent très simplement à la caméra. Philosophes en détresse, survivants de guerre lasse, ils n’ont jamais voulu quitter cet endroit malgré la radioactivité... Pour aller où ? C’est le plus bel endroit du monde. C’est là qu’ils sont nés et qu’ils ont grandi. Ils se connaissent et s’aiment depuis la tendre enfance. Ils ne connaissent pas d’Ailleurs. Cathy Blisson rappelle ces paroles sidérantes de Pétro : « Regardez-nous, on marche, on est debout ; ce sont les gens qui sont partis qui sont morts. Mon corps s’est adapté et si je partais, je mourrais. » XX La caméra du collectif Berlin les a accompagnés pendant tout ce temps au rythme de deux visites par an. D’une année (et d’une saison) sur l’autre, faute de moyens de communication, les créateurs ne savaient pas s’ils les retrouveraient. Lors des premiers temps du film documentaire, monté de manière chronologique, nous les voyons en compagnie de quelques animaux dont la présence est essentielle. Vache, cheval et chien faméliques ont des fonctions vitales dans cette existence précaire : l’un aide au champ, l’autre donne du lait, ils se tiennent chaud... Tournées en extérieur (le couple ayant interdit l’accès à sa maison), les images traduisent le drame d’un coin de planète anéanti. Autrefois, le village était habité, des gens y travaillaient, il y avait de l’eau et de l’électricité... Basiques, rares et sommaires, les mots de Baba et Pétro s’attachent à décrire le quotidien. Tels des personnages beckettiens, ils semblent frappés d’immobilité et d’essentialité. Devenus étrangers au danger qui les environnent, ils parlent de la vie, l’amour et la mort – qu’ils côtoient constamment et emporte progressivement les bêtes, puis le Vieux. Inexorable dépeuplement. Images de Baba dans sa cahute isolée qui croule sous la neige. Quintessence de l’immense solitude, inexorable dépeuplement... Autant de signes arrachés au monde insensé de Tchernobyl qui font à nouveau songer à l’univers de Beckett et plus précisément au Dépeupleur. Cette œuvre frappante de la littérature contemporaine propose en effet le modèle réduit d’un monde possible (ou pas), un curieux microcosme caractérisé par l’épuisement de son peuple... Au plateau, au milieu d’un dispositif bi-frontal, les images défilent sur un grand écran surélevé qui sépare l’aire de jeu centrale. Trois maquettes alignées en-dessous représentent l’environnement du couple : cour, jardin et champ environnant leur maison, l’une aux beaux jours, l’autre en automne et la dernière en hiver... Avec humanité et sans pathos, Berlin a su recueillir les témoignages troublants et presque irréels de Baba et Pétro, et les restituer sur les différents supports de cette scénographie. Leur spectacle (le mot ne convient guère) sans acteurs vivants, se déroule donc dans ce dispositif proche des arts plastiques : l’entièreté du documentaire est projetée sur le grand écran la plupart du temps ; et des extraits choisis sont présentés à l’intérieur des maquettes - qui sont elles-mêmes filmées en direct. Ces inserts du monde réel dans des décors de carton-pâte, tendent à déréaliser la vraie vie des survivants de Zvizdal : vie filmée dans monde truqué : illusion sur illusion... Les images de Baba et Pétro, enchâssées dans ces maquettes de territoires, donnent l’impression qu’ils sont les derniers figurants d’une ville fantôme. Bien que le recours à cette scénographique soit fait de manière parcimonieuse, l’effet produit…