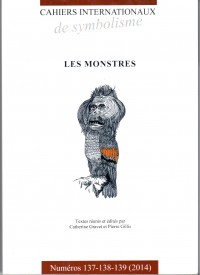
Introduction [page 37 de la version papier] Dans son essai Fiction : l’impossible nécessité, Vincent Engel XX signale que « le discours sur la littérature de la Shoah est dominé par une insistance sur l’incapacité de ce discours et plus particulièrement sa déclination artistique » XX . De fait, le judéocide fut une expérience d’une monstruosité telle qu’elle paraît se situer au-delà de tout ce qui est humainement imaginable, dicible et transmissible. Cependant, ces trois concepts, Engel les qualifie comme des mots qui ne trahissent que notre incapacité à imaginer, dire et transmettre, « des mots qui ne disent rien sur ce qu’on entend qualifier à travers eux » XX . Méditant sur le caractère toujours inédit et unique de l’expression de l’indicible, Engel montre comment le parcours du narrateur imaginé par Jean Mattern dans Les Bains de Kiraly XX (2008) atteste que, s’il est possible de surmonter la détresse en construisant un discours sur un événement apparemment inimaginable, indicible et intransmissible, le dépassement de cet inénarrable passe nécessairement par l’élaboration d’un récit personnel. Dans cette étude, nous nous proposons de nous faire l’écho des témoignages de deux voix majeures des lettres belges actuelles, deux romanciers [page 38 de la version papier] appartenant à des générations différentes mais dont les familles, juives, éprouvèrent dans leur chair et leur âme les atrocités nazies : Vincent Engel (°1963) et Françoise Lalande-Keil (°1941). Vincent Engel: Respecter le silence des survivants – Vous pourriez le laisser en prison, l’envoyer en Allemagne, dans un camp... – Vous ne connaissez pas les camps, monsieur de Vinelles ; sans quoi, je crois que vous me supplieriez de le fusiller sur-le-champ plutôt que de l’y envoyer XX ... Cette réplique de Jurg Engelmeyer, un officier allemand qui a ordonné l’exécution d’un jeune garçon en représailles aux actes commis par son père résistant, ne montre-t-elle pas que la monstruosité du nazisme hante le parcours romanesque de notre auteur pratiquement depuis son début ? Dans son article intitulé « Oubliez le Dieu d’Adam » XX , Engel relate qu’au cours de ses études de philologie romane à l’Université catholique de Louvain, son père lui offrit Paroles d’étranger d’Élie Wiesel, une lecture qui le bouleversa : Par le silence de mon père, par son indifférence à la chose religieuse, je redécouvre le judaïsme. Dans les livres, d’abord, au CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif) ensuite. Et Dieu se voile d’un drap sombre : celui de la souffrance à la puissance infinie d’Auschwitz. Toutes les souffrances se mêlent : celle de ma mère [décédée d’un cancer quelques années plus tôt], celle de la famille de mon père disparue dans les camps. (Idem, p. 72) Pourquoi parler d’Auschwitz ? Cette question, Engel s’astreindra à y répondre dès que cette réalité s’imposera à lui comme une « expérience marquante » bien que non vécue personnellement. La lecture et l’étude approfondie de l’œuvre de Wiesel imprimeront sur sa vision de la Shoah « un vocabulaire et des évidences : un monde était mort à Auschwitz, une société y avait fait faillite, et plus rien ne pouvait être comme avant » XX . D’où la nécessité, poursuit Engel, de « repenser le monde, refonder la morale, instaurer des conditions nouvelles pour la création artistique – pour autant qu’elle fût encore possible XX –, forger des mots neufs pour prononcer l’imprononçable [page 39 de la version papier] [...] » (idem, p. 18-19). D’autres évidences surgiront progressivement dans l’esprit de celui pour qui Auschwitz deviendra vite « une obsession » : celles de constater que la masse des documents publiés « n’ont guère servi à éduquer les gens » (idem, p. 20-21) et que les descendants des survivants, qui ont pour tâche de reprendre le flambeau du témoignage, doivent « trouver d’autres moyens d’expression, car ils n’ont pas vécu l’épreuve » (idem, p. 19). Si ses travaux scientifiques XX lui permirent d’« épuiser » la question « épuisante » de la responsabilité de Dieu devant le génocide juif ou, en tout cas, de tourner une page (ODA, p. 72), par après, c’est principalement à travers la fiction qu’Engel poursuivra cette interrogation sur la Shoah. Une interrogation qui trouve donc sa source directe dans la tragique histoire familiale et dans une identité juive ashkénaze fort ancienne. Comme il le détaille dans quelques interviews et articles XX , ses ancêtres paternels, polonais, étaient des juifs religieux appartenant à la bourgeoisie aisée. Bien que la situation dût se dégrader après la Première Guerre mondiale au cours de laquelle la famille se réfugia à Budapest où son père naquit en 1916, ils sont une famille juive inscrite dans le processus d’assimilation propre à cette période et à leur classe sociale ; les enfants fréquentent des écoles où ils côtoient la bourgeoisie polonaise catholique. Une intégration donc plutôt réussie mais qui n’empêchera pas leur déportation au début des années quarante. De toute la famille paternelle survivront un seul oncle, communiste avant la guerre et rescapé des camps, qui s’en ira faire sa vie à Los Angeles et y deviendra religieux orthodoxe, ainsi que le père de Vincent Engel, parti poursuivre ses études en Belgique vers 1938 et qui, après avoir passé la guerre dans les forces belges de la R.A.F, décidera de s’y installer définitivement : « Plus tard, il me dirait : “N’oublie pas que, pendant la guerre, des Juifs se sont battus”. » (Idem, p. 70.) Quand, à quarante ans, il rencontre son épouse, celle-ci, bien qu’appartenant à une bourgeoisie catholique bruxelloise imbue de solides préjugés, propose de se convertir au judaïsme. Une proposition qui sera rejetée par l’intéressé pour des raisons sur lesquelles l’écrivain ne peut que conjecturer : [page 40 de la version papier] Son athéisme s’était certainement renforcé à l’épreuve de la guerre et des camps. Ou bien, comme d’autres, refusait-il d’inscrire dans une telle tradition de martyre des enfants à venir. Ou bien, plus pragmatiquement, avait-il jugé que les meilleures écoles, à son avis, étaient catholiques. Hypothèse que conforte non seulement le refus de la conversion de sa femme, mais aussi le fait que ses enfants seraient baptisés, inscrits dans des écoles catholiques et feraient leur profession de foi. (Idem, p. 70-71) Une profession de foi qui, chez l’adolescent Engel, ne va pas de soi ! La découverte de l’œuvre de Wiesel et la relecture de Camus lui permettront de régler progressivement le conflit qu’il entretient avec ce christianisme qui prône la soumission, ferme les yeux sur les injustices les plus flagrantes – « Questionner Dieu sur la souffrance, celle d’Auschwitz ou celle de ma mère, accroît l’obscénité de la souffrance, puisque Dieu n’intervient pas et ne répond pas » (idem, p. 74) – et transmet à tous un goût certain pour la culpabilité. Ce qu’Engel (re)découvre dans Camus, la fausseté de la question de Dieu tout comme le devoir pour tout un chacun de suivre un cheminement éthique exigeant, n’est-ce pas en définitive ce que son père lui a transmis ? Évoquant ailleurs la figure paternelle, Engel insiste d’une part sur la certitude de celui-ci « qu’il n’y a pas de droits de l’homme sans le respect de devoirs, et de liberté sans responsabilité » ; d’autre part, sur « [son] impossibilité de dire à ses proches qu’il les aimait ». Et, ajoute-t-il, « pour ce qui est du judaïsme, un silence réduit à l’essentiel. [...] Mais un silence capable de faire passer le judaïsme, le sien, auquel son cadet au moins adhérera pleinement après ses vingt ans » XX . Car ce qui séduit Engel dans le judaïsme, c’est le fait qu’il représente « un rapport à…

