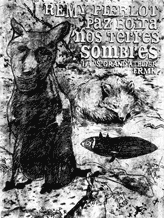
Située à Vielsalm, au coeur des Ardennes belges, La «S» Grand Atelier propose une série d'ateliers de création pour des artistes mentalement déficients et fonctionne comme un laboratoire.Depuis 2007, La «S» met l'accent sur une approche narrative de l'image et la rencontre entre le Frémok et La «S» a débouché sur un ouvrage collectif qui va donner son nom à l'ensemble du projet : «Match de catch à Vielsalml». Le projet se poursuit depuis avec une nouvelle série de récits créés en binôme. Paz Boïra a été accueillie en résidence entre 2009 et 2010. Nos terres sombres constitue le troisième round de ce match de catch.Certaines rencontres sans bruits. En choisissant de travailler avec Rémy Pierlot, Paz Boïra se rend rapidement compte qu'héritier d'une éducation irréprochable, il cache ses réflexions derrière des formules de bienséance et se protège en s'entourant de phrases toutes faites, adaptées à toutes les situations. Il s'avère nécessaire de trouver un terrain de dialogue autre que la parole. Rémy nourrit une fascination et une curiosité insatiable pour la nature, (qu'il a déjà dessinée avec Vincent Fortemps quelques temps auparavant dans Match de catch à Vielsalm), et montre à la dessinatrice les photos qu'il prend lors de ses promenades au bord des routes. La nature est une thématique chère à Paz Boïra, le sujet de son prochain livre, et ce terrain familier devient dès lors le lieu de rendez-vous des deux artistes. Les animaux, premiers habitants de ce territoire sauvage, commencent à peupler l'atelier silencieux et éloigné qu'ont choisi d'occuper Paz et Rémy pour travailler calmement. Face à face, leurs tables à dessin se remplissent de monotypes où apparaissent de grands ours, que Rémy dessine d'après photo. « Je trouve que dans sa façon de les dessiner il y a quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'est l'animalité (...) et ses animaux ont une présence bien plus vivante que quand je les fais moi ». Les échanges de dessins et le passage d'une main à l'autre permettent peu à peu à Paz Boïra de cerner ce dont elle va pouvoir se saisir pour armer leur récit. Elle perçoit, dans le charme que produit l'évocation des animaux chez Rémy, un lien très fort de ce dernier avec l'animalité et l'inconscient, une proximité qu'elle lutte pour retrouver dans son propre travail. Et c'est autour de cette perception instinctive qu'elle choisit d'articuler leurs travaux. Dans les sous-bois, où de splendidesoiseaux et mammifères se dressent entre de lumineuses clairières et les feuillages densifiés par le monotype, un homme et un ours arrivent à l'entrée d'un souterrain aux mille ramifications, une constellation de terriers. On devine que c'est…
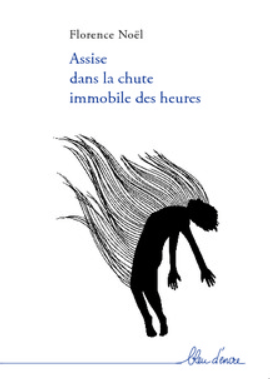
« des siècles tremblants de tant de vie… »
Un coup de cœur du Carnet Florence NOËL , Assise dans la chute immobile des heures , Bleu d’encre, 2021, 117 p., 12 € , ISBN : 978-2-930725-39-0En…
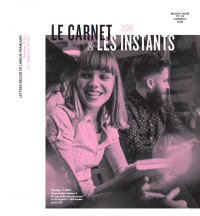
Pierre, papier, pinceau: Alechinsky à l’atelier [Rencontre]
De la peinture à l’image imprimée, de l’huile à l’acrylique, de la calligraphie japonaise à l’écriture personnelle, des vieux papiers de jadis aux livres d’artiste, l’univers créateur de Pierre Alechinsky ne cesse de déborder du cadre, traçant ses sinuosités, promenant dans les marges un trait de crayon, un coup de pinceau. L’exposition de ses «Travaux d’accompagnement» à la galerie Gallimard à ParisXX et la parution d’Ambidextre, recueil de textes dans la collection Blanche chez Gallimard XX , nous offrent l’occasion d’un entretien avec lui. * Il nous a donné rendez-vous dans l’un de ses lieux de prédilection: à l’atelier de lithographies Clot, Bramsen et Georges, quartier du Marais, à Paris. Une maison avec laquelle il travaille depuis des décennies, fondée par Auguste Clot en 1896, où Alechinsky s’est lié dès les années 1960 avec l’imprimeur lithographe danois Peter Bramsen. Aujourd’hui, c’est le fils, Christian Bramsen, épaulé par une petite équipe où se trouve aussi son fils Victor, qui continue de faire marcher la Voirin. Une grande et ancienne presse à lithos, imposant sa masse de métal gris dans l’atelier. Alechinsky est déjà à l’ouvrage, grand tablier bleu, pinceau dans la main gauche, bol d’encre de chine dans la main droite, une pierre à litho devant lui, sur laquelle il dépose, par petites touches, des traits, des points, des ponts. Attention soutenue, geste mesuré de « l’autre main », la bonne, l’instinctive, la main gauche, celle qui peint et dessine. Que dessine-t-il? « Je ne fais que suivre ce que j’imagine être la logique de ce qui est en train de se passer », confie-t-il. « Il n’y a pas d’accident, juste l’imaginaire. Je travaille ainsi parce que c’est ce que je veux qu’il advienne, en connaissant ce que peut produire le contact entre le geste, la pierre, l’encre, l’acide. » C’est dans cette imprimerie, doublée aujourd’hui d’une maison d’édition, qu’ont été réalisées plusieurs des nombreuses lithographies présentées à la galerie Gallimard, sous le titre de «Travaux d’accompagnement». Des images d’Alechinsky, pour des livres de poètes ou écrivains : Apollinaire, Proust, Yves Bonnefoy, Michel Butor, Octavio Paz, Joyce Mansour, Amos Kenan… et, côté belge, Christian Dotremont, Louis Scutenaire, les frères Piqueray, Pol Bury, Hugo Claus, Jean-Pierre Verheggen, Marcel Moreau… Vous dites ne pas aimer le mot illustration. Pourquoi? C’est un mot qui ne dit pas ce qui se passe dans le dialogue entre l’auteur des mots et l’artiste, peintre ou dessinateur. Exemple entre tous : Proust. Je n’ai pas illustré Un amour de Swann. On ne peut pas se permettre de dire qu’on « illustre » Proust, il s’illustre lui-même, et n’a besoin de personne. On peut dire, peut-être: orner. Matisse, lui, usait du mot: décorer. Disons qu’Un amour de Swann, j’en ai décoré les marges, les abords. Mes images pour des livres sont des travaux d’accompagnement. Mais le lien avec chaque livre, ou chaque livre d’un même auteur, diffère à chaque fois. Vous avez maintenant derrière vous plus d’une centaine de livres ainsi ornés ou décorés. Un livre des débuts? L’un de mes tout premiers travaux d’accompagnement, c’est une petite linogravure que j’ai faite quand j’étais encore étudiant à La Cambre, en 1947. Cela s’appelait Menu, à partir d’un extrait d’un recueil de Blaise Cendrars, Kodak. J’ai dû tirer ça à douze ou quinze exemplaires, pas plus, car à l’époque ça coûtait cher. J’ai orné plusieurs autres livres de Cendrars par la suite, Le Cirque, ses Carnets inédits de Mon voyage en Amérique, et aussi Le Volturno, un autre inédit de 1912. Au départ, il s’agissait de réaliser quelques images pour l’édition du texte. Puis ça s’est amplifié, j’ai dessiné des tas de bateaux et de rafiots. Et ça a donné finalement lieu à un ensemble de lithographies, imprimées ici à l’Atelier Clot, en 1989. Cendrars est un bon exemple de ce dialogue que vous avez établi avec le texte, au-delà du décès de l’auteur, pour La légende de Novgorode. C’était un livre absolument mythique, avec un texte russe, caractères cyrilliques, imprimé à Moscou en 1907. Existait-il vraiment? Personne n’avait jamais vu l’un des quatorze exemplaires … jusqu’à ce qu’on en découvre un, presque un siècle plus tard, en 1995. Ce livre-là, le premier de Frédéric Sauser avant qu’il ne s’appelle Blaise Cendrars, sa fille Miriam l’a fait restituer en français, et m’a demandé si je voulais l’accompagner de mes images. J’ai hésité, et bien failli renoncer. Accompagner le tout jeune Cendrars, alors qu’on a encore sous les yeux l’édition de la Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France enluminée sur deux mètres par la grande Sonia Delaunay… Mais bon. J’avais reçu autrefois, pour la commande d’une affiche à réaliser, un fonds de vieux papiers de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits – qui a des origines belges, comme on sait. Et donc pour Cendrars, j’ai travaillé à partir de ces archives, où l’on retrouvait parfois des lieux qu’il citait lui-même. Il y a un réel plaisir à découvrir toutes ces écritures, tous ces papiers du passé, c’est une stimulation visuelle incomparable… J’ai fini par réaliser des images, du bout du pinceau, pour l’édition de La légende de Novgorod qu’en a tirée Bruno Roy en 1997, chez Fata Morgana. Justement, dans ces collaborations avec des écrivains, l’écriture manuscrite du poète peut elle-même susciter la naissance de l’image… Parfois, oui. C’est ce que j’ai fait il y a quelques années avec Marcel Moreau, d’abord pour son texte Insolations de nuit, qu’a édité en 2007 Jean Marchetti à Bruxelles, dans sa collection de La pierre d’alun. Et puis pour un livre d’artiste avec Moreau, Pointes et feutres, également imprimé et édité en 2013, ici à l’Atelier Clot. Les manuscrits de Moreau sont extraordinaires, il écrit sur la feuille, en tout sens, dans toutes les directions. Cela constitue des blocs, des allongements, des formes étirées… Ensuite, son manuscrit est retranscrit, relu, corrigé, avant d’être donné à l’éditeur. Il m’a confié des feuilles manuscrites, je n’ai eu qu’à m’en saisir… ... Cela n’a l’air de rien, mais je n’y arrivais pas, j’avais le trac, je craignais de bousiller ses pages. Ça a duré des mois. Et puis, d’un coup j’ai trouvé, j’ai déposé des feuilles de papier calque, ça m’a libéré, et j’ai commencé à dessiner par dessus avec un feutre. Les images sont nées des formes de son écriture. Ce sont des rencontres évidemment complètement inattendues, je ne sais jamais dire à l’avance ce que ça va donner. Et il faut – parfois – compter avec l’imprévu. On est arrivé au bout d’une journée, on croit que l’image en restera là. Et puis avant de quitter l’atelier, on a une impulsion, on remet le pinceau dans l’encre, et on trace une ligne, un signe. C’est ce moment-là qu’il fallait attendre. Dans Ambidextre, édition revue et augmentée de trois recueils parus autrefois, les premières pages s’ouvrent sur Titres et Pains perdus, un texte que vous aviez publié initialement en 1965 chez Denoël. Quel rôle le titre joue-t-il pour vous? J’ai toujours accordé une grande importance aux titres, à la fois pour mes peintures et pour mes livres. D’ailleurs, le mot « titre » revient par trois fois dans mes livres: il y a eu en effet Titres et Pains perdus, qui porte un sous-titre à ne pas minimiser: Notes sur les disparitions, les pertes de sens, les difficultés de transmission, les oublis, les manques et les persistances inutiles. Par après, j’ai réalisé Le Test du Titre, un portfolio de six eaux-fortes, qui est ensuite devenu un livre publié par Éric Losfeld en 1967. Pour celui-ci, j’avais convié 61 « titreurs d’élite » de mes amis, chargés de donner un titre à ces images. Et puis il y a eu Le Bureau du Titre…