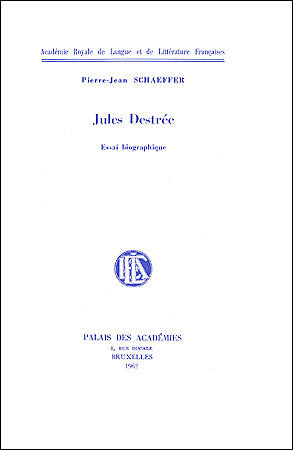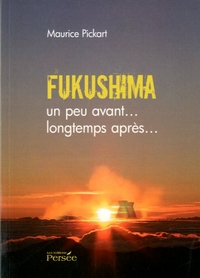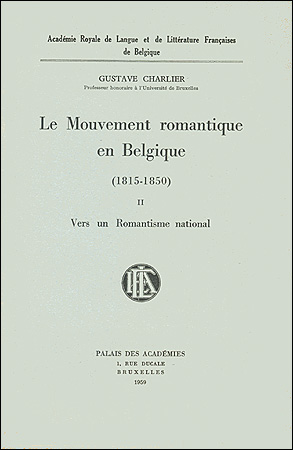
Le mouvement romantique en Belgique (1815-1850). II Vers un romantisme national
À propos du livre Nonum prematur in annum L'exigeant précepte d'Horace a trouvé, cette fois, sa rigueur dépassée, puisque c'est de 1948 qu'est daté le premier tome du présent ouvrage. Bien malgré nous, il est vrai : des occupations professorales absorbantes, la maladie ensuite, puis de cruelles épreuves familiales ont, trop longtemps sans doute, retardé la rédaction, la mise au point et l'achèvement de ce tome II et dernier. On s'en excuse. Après un tel délai, peut-être n'est-il pas inutile de rappeler à cette place le dessein qui n'a pas cessé d'être le nôtre. C'est de poursuivre, dans le milieu belge, entre 1815 et 1850, une enquête attentive sur l'évolution des idées, des tendances et des réputations littéraires. La suivant à la trace, nous avons cherché à en préciser la marche dans les esprits et dans les écrits de ce temps. Revues et journaux, préfaces et critiques nous ont fourni l'essentiel de notre documentation. Nous avons tenu le plus grand compte des influences étrangères, et singulièrement de celle du romantisme français, dont la contrefaçon multiplie alors les oeuvres parmi nous. Et nous n'avons pas négligé de mesurer, quand il y avait lieu, les répercussions des événements politiques ou sociaux sur le devenir, en nos provinces, de la «chose littéraire». Notre propos a donc été, dans l'essentiel, l'étude d'un mouvement d'idées. On aurait tort de chercher ici un relevé complet des auteurs belges de l'époque romantique et un catalogue de leurs ouvrages. Nous avons, pour notre modeste part, essayé de tracer un tableau abrégé de cette époque de notre passé littéraire dans quelques chapitres de la grande Histoire illustrée des lettres françaises de Belgique, dont nous avons naguère dirigé la publication avec notre savant confrère et collègue, M. Joseph Hanse. On nous permettra d'y renvoyer. Ici, la production nationale nous intéresse avant tout dans la mesure où elle rend témoignage de la marche des idées littéraires ou en illustre le cheminement. Volontairement réduites au minimum, nos indications bibliographiques sont, strictement, celles des textes qui ont fourni nos citations ou autorisé nos conclusions. En d'autres termes, notre dessein a été ici, avant tout d'apporter une contribution valable à l'histoire des idées, er souhaitant qu'elle puisse servir à illustrer un jour ce que notre regretté maître Fernand Baldensperger appelait «une sorte de philosophie de la vie et du mouvement en littérature». Nous ne nous flattons pas d'y avoir réussi. Du moins espérons nous qu'on pourra trouver aux pages du présent tome, comme à celles du précédent, des citations nouvelles ou peu connue: et des témoignages inédits,…