
Septentrion - n°1 - 1er mars 2018 - 1er trimestre 2018
Sommaire • Leeuwaarden, trois fois capitale par Daniel Cunin • Un bric-à-brac à la Jan Steen ? Luc Devoldere • Une…
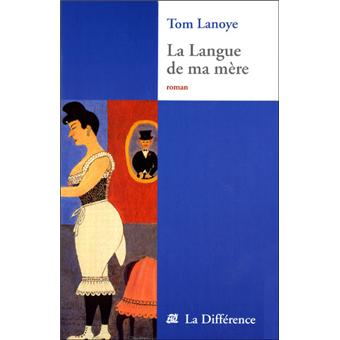
Grâce à la campagne « Lisez-vous le belge ? », nous avons eu l’occasion de découvrir ou de rafraîchir…
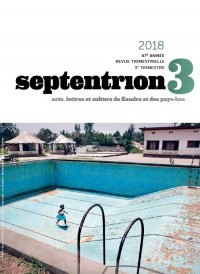
Les langues en indonésie. Pas de néerlandisation, mais une anglicisation
[ Traduit du néerlandais par Marcel Harmignies.] Les indonésiens sont extrêmement susceptibles quand il s’agit de leur territoire, mais n’ont jamais éprouvé le besoin de se battre pour leur propre langue. néanmoins, le néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer dans les anciennes indes néerlandaises. * * * Une évolution de la langue indonésienne me chiffonne et me met mal à l’aise, il s’agit du mélange avec l’anglais. Au cours des quarante dernières années, de plus en plus de mots et d’expressions anglais ont été introduits, mais on éprouve moins le besoin de les transposer en indonésien. Les personnes que je qualifie d’anglicisées (keminggris en javanais) sont de plus en plus nombreuses. Comme si tous ces emprunts étaient généralement acceptés et compris par tout un chacun. Pourquoi les Indonésiens font-ils un tel méli-mélo de leur langue et sont-ils à ce point dépourvus de nationalisme linguistique? Pourtant, les Indonésiens ne sont-ils pas réputés pour le nationalisme qui les a délivrés du colonialisme néerlandais? Les réponses à ce genre de questions, on ne les obtient qu’en analysant plus de trois cents ans d’histoire coloniale. Colonisés par une entreprise Qui connaît l’histoire de l’Indonésie supposera peut-être que l’indonésien est plus proche du néerlandais que de l’anglais. Les Néerlandais ont quand même régné sur l’archipel trois siècles durant. Alors pourquoi les Indonésiens ne parlent-ils donc plus le néerlandais, tandis que dans le Timor oriental, petit pays voisin, le portugais est toujours utilisé ? Quand on appelait encore «malais» la langue indonésienne, elle cohabitait bien avec les langues locales et le néerlandais. J’ai été élevé par mes grands-parents à Malang, Est de Java, dans les années 60 et 70 du siècle dernier, et je baignais dans trois langues: le néerlandais, le javanais et l’indonésien. Mes grands-parents parlaient néerlandais entre eux car ils avaient fréquenté des écoles néerlandaises, et ils m’apprirent à le parler et à l’écrire. Mes premiers petits mots furent peut-être du néerlandais et non du javanais. Le javanais, je l’ai appris dans la rue, et il me fut ensuite enseigné à l’école, avec l’indonésien. J’ai appris cependant aussi à ne pas mélanger ces langues. Ma grand-mère soulignait que beaucoup de ceux qui parlaient javanais et indonésien ne comprenaient pas du tout le néerlandais. Plus tard, j’ai appris également à l’école l’anglais et l’allemand, mais les professeurs veillaient à nous éviter que nous mélangions les langues. Le faire était pécher par insuffisance linguistique. Je suis convaincu que ma maîtrise du néerlandais est une exception. Les gens de ma génération et de celle de mes professeurs ne le parlent guère. Seule la petite communauté des Indos, métis ayant choisi de rester en Indonésie après l’indépendance, l’utilise encore. Je parlais aussi néerlandais avec mes trois camarades de classe indos quand nous étions entre nous. Quand je suis parti en 1980 à l’université de Salatiga, Java central, j’ai pu continuer à le pratiquer avec les Indos et les enseignants néerlandais qui travaillaient là. Mais j’ai déjà remarqué alors que le nombre d’Indonésiens parlant encore le néerlandais diminuait rapidement, tandis que l’usage de l’anglais était précisément en plein essor. Lorsqu’en 1987 je me suis installé aux Pays-Bas pour travailler au département indonésien de Radio Pays-Bas internationale, je n’ai eu aucune peine à pratiquer le néerlandais. Il m’a suffi de deux semaines de cours chez les chanoinesses de Vught, dans le Brabant-Septentrional. Dans le cadre de mon travail, je n’avais pas à écrire en néerlandais. Je devais seulement être capable de traduire des dépêches du néerlandais en indonésien. Mon expression écrite en néerlandais s’en est trouvée négligée. Si je l’avais aussi appris à l’école, il en aurait sans doute été autrement. Aux Pays-Bas, je me suis consacré de plus en plus à l’histoire, surtout à ce que nous appelons l’époque néerlandaise (zaman Belanda). J’ai découvert que l’Indonésie est le seul pays où l’on ne parle plus la langue de l’ancien colonisateur. Dans les anciennes colonies britanniques de Malaisie et Singapour, on continue à parler l’anglais et beaucoup d’auteurs locaux écrivent dans cette langue. Aux Philippines aussi, qui furent cédées au XIXe siècle par les Espagnols aux Américains, de nombreux auteurs publient en anglais. Le Timor oriental, à la fin de l’occupation indonésienne, a choisi le portugais comme première langue nationale. De même, dans les anciennes colonies françaises du Maghreb, l’enseignement supérieur est toujours bilingue: arabe et français. L’auteur marocain Bensalem Himmich écrit ses romans en français et en arabe. En Indonésie, il n’est plus un seul auteur qui écrive en néerlandais. C’était déjà un peu ce qui se produisait durant l’époque néerlandaise. En néerlandais ne publièrent guère que Raden Adjeng Kartini (1879-1904), Noto Soeroto (1888-1951) et Soewarsih Djojopoespito (1912-1977). Leurs livres furent reconnus aux Pays-Bas aussi comme des œuvres littéraires, mais on peut les considérer comme des accidents de l’histoire. Je croyais initialement, conformément au fanatisme historique que j’avais apporté d’Indonésie, que le nationalisme indonésien avait évacué tout ce qui évoquait les Néerlandais. Le Soempah Pemoeda (Serment de la jeunesse), prêté en 1928 par les jeunes nationalistes, joua un rôle majeur en la circonstance. Il exhortait à: une terre, une nation et une langue. Mais peu à peu cette conviction disparut qui, à mon avis, est dépourvue de tout fondement historique. Ainsi je découvris que Soewarsih Djojopoespito publia son roman Buiten het gareel (Au-delà du harnais) en 1940, douze ans après le Serment de la jeunesse. Soewarsih aurait-elle dû l’écrire en indonésien pour rester fidèle à ce serment? Pourquoi a-t-elle pourtant rédigé son roman nationaliste dans la langue de l’oppresseur? Je me rendis compte alors aussi que mes grands-parents avaient continué de parler néerlandais jusqu’à leur décès. Par conséquent je suis convaincu que le Soempah Pemoeda n’est pas une raison suffisante pour expliquer la disparition du néerlandais en Indonésie. Au beau milieu de cette recherche, j’ai vu une interview de Benedict Anderson* à la télévision néerlandaise. Cette spécialiste réputée du nationalisme relevait que l’Indonésie est la seule colonie à avoir été administrée sans utiliser une langue européenne. Par ailleurs, l’Indonésie avait été colonisée non par un État, mais par une entreprise, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oost-Indische Compagnie ou VOC). Cette interview m’ouvrit les yeux. Pour la VOC, l’optimisation des profits était importante et les charges de la colonie devaient être contenues à un bas niveau. Naturellement, la VOC possédait aussi d’autres moyens pour générer des profits, comme le monopole des épices. Diffuser la langue néerlandaise aurait cependant aussi coûté de l’argent. Il revenait moins cher d’enseigner le malais, embryon de la langue indonésienne, aux proches collaborateurs que le néerlandais à toute la population. Quand la VOC fit faillite vers 1800, l’État néerlandais prit le relais, mais la politique linguistique de la compagnie fut poursuivie. Les Européens parlaient bien le néerlandais dans la capitale Batavia, et le portugais se trouva relégué derrière le malais en position de seconde langue utilisée, mais l’usage du néerlandais ne fut pas encouragé. On invoquait comme prétexte le fait que les Indes néerlandaises possédaient déjà…