
Virginia Woolf, écrire dans la guerre
De Virginia Woolf nous ne connaissons que peu de portraits. À vrai dire, toujours le même, présenté sous différentes nuances de gris. Fantomatique, transparente, Woolf nous apparaît sous un angle unique. Dans cet essai concis et parfaitement maîtrisé, Pascale Seys et Carine Bratzlavsky ajoutent une dimension à l’image fatiguée de l’autrice anglaise : on l’y découvre mouvante, mordante, habitée d’un feu que ni les conventions ni l’épouvantable marche du monde ne parviennent à étouffer. Il est rare, au cours de l’Histoire, qu’un homme soit tombé sous les balles d’un fusil tenu par une femme ; la vaste majorité des oiseaux, des animaux tués, l’ont été par vous et non par nous. À travers l’étude rigoureuse des écrits de l’autrice, plus particulièrement celle de son Journal d’écrivain et de sa correspondance prolifique avec sa sœur adorée, Vanessa Bell, l’ouvrage prend le parti de l’intime et trace une géographie intérieure toute de braises et de colère, de mouvements d’âme orageux, excessifs, voguant d’un extrême à l’autre de la carte, amour et haine mêlés avec la même intensité dans un quotidien pétri d’injustices personnelles et collectives. On connaît l’engagement de l’autrice pour les droits des femmes à disposer tant d’elles-mêmes que de leur temps, mais on oublie souvent l’insolence et la radicalité avec laquelle Woolf revendique ses positions politiques – hésitant, par bravade, à se déclarer Juive russe auprès d’une assemblée de bourgeois antisémites, « mais je garde cela pour le prochain concert ». Écrire dans la guerre révèle une amertume bien éloignée de la douce mélancolie que l’on suppose à l’autrice, perdue sous les voiles de tristesse apposés par les années sur son visage. Dans ce visage flamboie pourtant un regard acerbe, posé notamment sur les libations populaires qui entourent l’annonce de l’armistice du 11 novembre 1918, dans lesquelles Woolf ne voit qu’une « fête pour domestiques conçue pour pacifier et satisfaire les gens, quelque chose de calculé, de politique, d’hypocrite » ; un écran de fumée mystifiant la sphère publique comme privée au détriment du seul sujet digne de valeur à ses yeux (car salvateur autant que destructeur) : la littérature. Virginia Woolf dira souvent qu’entre le rire et l’angoisse, son corps est comme coupé en deux. Aussi, pour réparer et réconcilier les lambeaux épars, plongera-t-elle son corps tout entier dans l’écriture . Nulla dies sine linea . Écrire dans la guerre est un titre habile, qui réunit le moteur de l’autrice et l’objet de sa lutte : une guerre qui se matérialise sous des formes multiples, une colonie de « démons noirs et velus » qu’elle s’acharnera à combattre – jusqu’à choisir la mort. Si cette cinquantaine de pages voit se chevaucher maladie mentale, violences sexuelles et deux guerres mondiales, un espace comme une dimension parallèle y est réservé pour que fleurissent un amour sororal vertigineux, une myriade de petits animaux, des convictions défendues au point de s’en brûler les entrailles et une ironie jubilatoire.Au gré d’un minutieux assemblage de détails, Pascale Seys et Carine Bratzlavsky tracent les contours d’une femme vivante, ambivalente, dont le désespoir n’a d’égale que la force de caractère avec laquelle Virginia Woolf a défendu tout ce qu’elle aimait. […] la vie continue. C’est à la fois sa démesure et sa petitesse qui la rendent possible. …
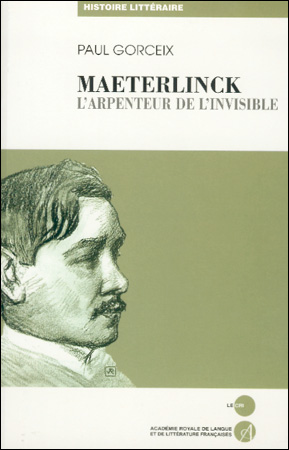

Le cri du public. Culture populaire et chanson dialectale au pays de Liège (XVIIIe-XIXe siècles)
À propos du livre Que peuvent nous apprendre les prédictions de l' Almanach de Mathieu Laensbergh en matière d'éveil aux idées de Lumières, au XVIIIe siècle? Quel changement de mentalité à l'égard des pratiques magico-religieuses laissent entrevoir les commentaires du livret de pèlerinage à Saint-Hubert en Ardenne? C'est à de telles questions que tâchent de répondre les essais contenus dans le présent ouvrage, à partir d'une documentation associant littérature « populaire », journaux, catalogues de libraires, chansons, etc. La communication orale y trouve une place importante, notamment quand elle se fait dialectale. La diffusion de valeurs et d'interrogations communes s'opère aussi par le théâtre, où drames sérieux, vaudevilles et opéras-comiques nous sommes au pays de Grétry composent un véritable «paysage culturel» moyen. On verra ainsi comment le Laensbergh ou les mémoires rédigés à l'occasion de procès opposant des communautés rurales aux autorités manifestent le progrès du rationalisme critique, à travers un lexique où le bourgeois sensible côtoie l'aristocrate éclairé . De leur côté, les livrets de pèlerinage offrent une mutation du regard sur la «neuvaine» contre la rage, la protection sacrée cédant la place à la conception du contrat marchand et à l'hygiénisme. La réflexion sur l'«amélioration de l'espèce humaine», avec les questions de l'eugénisme, de l'alimentation des enfants et de la vaccination, entrent dans le débat qu'entretiennent le Journal encyclopédique et le Giornale enciclopedico di Liegi . Comment s'étonner de la vigueur avec laquelle les classes populaires verviétoises vont combattre l'ancien régime dans les années qui précèdent sa chute? Une figure d'exception domine intellectuellement et pratiquement l'événement : Nicolas Bassenge. La chanson «patriotique» donne la mesure de son charisme et de l'évolution que connaît celui-ci, quand se développera l'aspiration à une société pacifiée. Une même exigence de conciliation et de pragmatisme s'observe dans le traitement accordé au wallon sous un régime français moins jacobin qu'on ne l'a parfois dit. Y a-t-il continuité ou rupture entre le catalogue de la lecture à la fin du XVIIIe siècle et celui de l'époque romantique? Quelles nouveautés foncières se font jour, à côté d'une tradition persistante du livre «utile» visant désormais l'entrepreneur balzacien? Quelle réception pour un romantisme souvent jugé «dégoûtant»? Avec Georges Sand et les Vésuviennes de 1848, la revendication féministe fera irruption sur la scène locale, tandis qu'alterneront dans la chanson de conscrit complaintes de la fille-mère et gaietés de l'escadron, émaillées de…