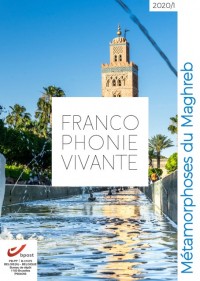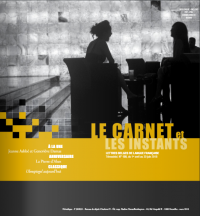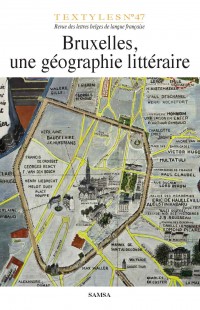
Le fonds Jean Muno ( in La chronique des Archives & musée de la littérature )
Mon héros – le seul que je puisse comprendre de l’intérieur – sera [...] cette part décriée de moi-même et de mon lecteur, le « petit bourgeois » d’aujourd’hui, le petit homme occidental. Mon sujet : son inquiétude, son inadaptation, sa rébellion larvée, sa souffrance. XX Les archives de Jean Muno (1924-1988), léguées aux AML en 2008 par sa veuve, Jacqueline Burniaux, sont à l’image de son auteur : discrètes mais passionnantes. Désormais entièrement dépouillées et encodées sous les cotes ML 11140 à ML 11173, elles proposent au chercheur des manuscrits, des articles, les fragments d’un journal, des correspondances, des photographies,... qui touchent au plus près à l’identité complexe de ce natif de Molenbeek-Saint-Jean (« Ni Flamand ni Wallon ni même Bruxellois. Un mélange des trois, oui, une addition bizarre, assez inopportune, d’appartenances imparfaites » XX ) dont le destin se fixe dès les années 1950 dans une commune symptomatiquement dénommée Malaise, à cheval sur la future frontière linguistique. Sur cette identité « en creux » vient se greffer une blessure plus profonde, née du lien qui unit Jean Muno, de son vrai nom Robert Burniaux, à ses parents, Constant Burniaux et Jeanne Taillieu, tous deux instituteurs et écrivains. Une relation envahissante, entre rejet et ressemblance (père et fils siégeront, notamment, au sein de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique), autour de laquelle se sont échafaudés la plupart de ses écrits. Si ceux-ci échappent au tragique, c’est parce que Muno s’est très vite emparé de deux armes de distanciation essentielles : l’humour et le fantastique. Le fantastique est avec l’humour une dimension constante, d’ailleurs très belge, de mon œuvre. Ce sont deux manières de prendre ses distances par rapport au réel sans rompre avec lui, sans cesser de l’appréhender. XX C’est en 1949 que, parallèlement à son travail d’enseignant, la carrière littéraire de Jean Muno démarre. Il écrit alors une pièce radiophonique intitulée Un petit homme seul, dont les archives, hélas, ne gardent pas trace. Qu’à cela ne tienne, on retrouvera ce personnage, sorte de double littéraire, de manière récurrente dans toute son œuvre, aussi bien dans les romans écrits à partir de 1955, que dans les nombreuses nouvelles qui paraissent en revues (dans Marginales et dans Audace, pour ne citer qu’elles). Le fonds, riche en manuscrits, propose au chercheur différentes versions des romans comme L’homme qui s’efface (1963), L’île des pas perdus (1967), Le Joker (1972) et Ripple-marks (1976), ainsi que des manuscrits de nouvelles plusieurs fois retravaillés pour les recueils La Brèche (1973), Histoires singulières (Prix Rossel 1979, rééd. 2015), Contes naïfs (1980) et Entre les lignes (1983, avec les étonnants dessins de Royer). Le fonds compte également quelques inédits ainsi que les manuscrits d’exploitations radiophoniques, théâtrales ou cinématographiques de certains textes. Ainsi, l’exemple de Comptine en 1966, tiré de la nouvelle Fumées sans feu et qui obtint le Grand Prix international de la fiction radiophonique Paul Gilson. À côté des manuscrits, le fonds présente aussi de nombreuses notes de travail ainsi qu’un fragment de journal (pour la période du 31 août 1952 au 7 avril 1957). Ils constituent une source précieuse pour le chercheur puisqu’ils plongent aux sources de la création et illustrent les conflits intérieurs, voire les révoltes de l’écrivain. Des documents à mettre en parallèle avec Rages et ratures, les pages inédites d’un journal de 1975 à 1986, dont un dossier retrace les étapes de l’édition posthume aux Éperonniers, en 1998. Des « dossiers d’édition » existent également pour certaines œuvres. C’est le cas pour le roman Histoire exécrable d’un héros brabançon qui, à défaut de manuscrits, reprend les maquettes de la couverture des éditions Jacques Antoine, avec les illustrations drolatiques de Jacques Faton en 1982. Caméléon, l’adaptation scénique de Patrick Bonté d’après plusieurs romans de Muno, est un cas similaire : pas de manuscrits, mais un dossier fort complet de la tournée du Théâtre de l’Esprit frappeur en Belgique, en Suisse et au Canada. L’œuvre fictionnelle ne doit pas faire oublier le Muno essayiste. S’il s’est souvent penché sur le statut de l’écrivain belge et, par extension, sur son propre statut – songeons, notamment, à ses interventions dans les Cahiers du Groupe du Roman –, la collaboration de Muno avec Robert Frickx a abouti à deux essais sur la littérature belge, l’un dans la collection Que sais-je ? en 1973 (rééd. 1980) et l’autre aux éditions québécoises Naaman en 1979. Quant aux lectures attentives du Muno critique, elles laissent entrevoir ses goûts littéraires et, notamment, sa grande estime pour les romans de Conrad Detrez. Un échantillon d’articles est bien entendu présent dans le fonds. Celui-ci se clôt par des dossiers de correspondances qui restituent, à travers des lettres d’auteurs amis comme Gaston Compère, Jacques Crickillon, Marcel Moreau ou Paul Willems... l’écho de la voix de Jean Muno. Mettons en exergue la volumineuse et désopilante correspondance de Jacques-Gérard Linze à Muno qui, avec plus d’une centaine de lettres – à compléter avec les lettres de Muno à Linze déjà présentes aux AML – nous content l’histoire d’une amitié savoureuse et indéfectible. Rappelons qu’une sélection de ces archives Muno est mise en valeur dans les locaux des Archives et Musée de la Littérature jusqu’en septembre 2015. Elle s’intitule « Jean Muno et l’ironie » XX : juste regard sur celui qui feignait de s’excuser : « Est-ce ma faute si le rire existe ? » XX Saskya Burens Muno (Jean), « Le blanc cassé », dans Le Groupe du Roman, cahier 1, 1967, p. 38. Muno (Jean), « J’habite Malaise, Belgique », dans Le Groupe du Roman, cahier 23, 1989, p. 141. Jean Muno cité dans Denis (Marie), « Le Vampirologue », dans Le Groupe du Roman, cahier 23, op. cit., p. 77. Titre inspiré par l’essai de Moreels (Isabelle), Jean Muno. La subversion souriante de l’ironie, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, pie-Peter Lang, 2015. Muno (Jean), Histoire exécrable d’un héros brabançon,…